
ABéCéDaire :
Photos de vacances
L'orgue de l'église
Saint Gervais - Saint Protais
GISORS

 La
première église paroissiale Saint-Gervais Saint-Protais
de Gisors a été consacrée en 1119. Ravagée
par un incendie, elle est reconstruite en 1160.
La
première église paroissiale Saint-Gervais Saint-Protais
de Gisors a été consacrée en 1119. Ravagée
par un incendie, elle est reconstruite en 1160.
En 1249, un choeur gothique est financé par la Reine Blanche de
Castille.
Par la suite, au XVe siècle, ce sont des confréries de charité
et des corporations de métiers qui la doteront de chapelles rayonnantes
et d'un déambulatoire au niveau du choeur.
Les travaux se poursuivent au XVIe siècle avec la reconstruction
de la nef en style gothique flamboyant et de la façade ornée
de motifs Renaissance.
LES ORGUES
Il ne semble pas que l'église de Gisors ait été
pourvue d'orgues avant la fin du troisième quart du XVe siècle.
Le premier instrument fut acquis en 1472 par la confrérie de l'Assomption,
pour être placé dans la chapelle qu'elle possédait
dans l'église Saint Gervais ; en 1477, les trésoriers de
Notre Dame de l'Assomption accordaient un subside pour aider à
faire les orgues de l'église ; ces orgues avaient été
données par Geoffroy de Contens , un bourgeois de Gisors. Nous
ne savons où elles furent placées ; la seule chose certaine,
c'est qu'on n'établit pas de tribune pour elles.
Nous ignorons tout de la composition de ces premières grandes orgues.
Mais, dès 1568, il était déjà question d'édifier
de nouvelles orgues.
La dépense parut-elle trop lourde ? Toujours est-il que l'on renonce
à poursuivre les négociations, et, en 1573, le facteur Nicolas
Votier travaillait à la réfection des Orgues de 1477.
Quatre ans plus tard, en septembre 1577, les trésoriers de la fabrique
reprenaient le projet abandonné, et décidaient de consacrer
désormais un des bassins de la quête à cet effet et
de réduire le nombre des ouvriers maçons qui travaillaient
alors à la reconstruction de la nef, afin de pouvoir réunir
la somme nécessaire à l'aménagement d'un instrument
digne de l'immense vaisseau que les Grappin achevaient de parer
des magnificences les plus raffinées de la Renaissance.
En 1578, le bassin des orgues avait produit 113 livres et les quêtes
à domicile avaient permis aux trésoriers de réunir
1413 livres.
Un traité était passé le 11 mai 1578 avec le facteur
laonnais Nicolas Barbier , qui avait déjà prouvé
son grand talent par la construction des orgues de Nesle et de Saint-Quentin
et qui s'occupa dès lors et jusqu'en 1580 de la construction du
nouvel instrument, et même jusqu'en 1582, de son aménagement
complet. Un second marché fut fait avec le menuisier Philippe
Fortin pour la construction du buffet et Jean Grappin était
chargé d'élever la tribune de pierre qui devait supporter
les orgues.
On ne marchanda pas sur les moyens pour que l'œuvre fût en
tous points parfaite ; Fortin et Barbier furent envoyés à
Rouen pour s'inspirer des beaux buffets de style Renaissance que l'on
pouvait admirer alors dans diverses églises de cette ville ; de
ce buffet qui fut installé au mois de décembre 1579 , il
ne nous reste que la description qu'en fait, vers 1629, le poète
gisortien Dorival dans sa description de l'église
de Gisors ![]() .
.
Au travers des périphases de ces mauvais vers, on distingue les
traits essentiels de ce buffet qui rappelle beaucoup ceux que l'on peut
admirer aujourd'hui encore à Saint-Maclou et Saint Vivien de Rouen.
La tribune, construite par Jean Grappin, en pierres de Vernon, est celle
qui existe encore aujourd'hui.
En avril 1580, le ravissant escalier qui conduit aux orgues était
achevé. Le mois suivant, l'orgue était terminé et
la fabrique invitait le grand musicien ébroïcien Guillaume
Costeley à venir visiter l'instrument.
Il ne restait plus qu'à achever la décoration et notamment
la peinture du buffet et de la balustrade.
Nous connaissons la composition de l'orgue de
Barbier ![]() par le devis qu'il présenta à la fabrique en 1577, et dont
il a réalisé les différents articles en 1579-1580.
L'instrument comprenait vingt-trois jeux.
par le devis qu'il présenta à la fabrique en 1577, et dont
il a réalisé les différents articles en 1579-1580.
L'instrument comprenait vingt-trois jeux.
La soufflerie ne donna pas longtemps satisfaction et dès le début
de l'année et jusqu'en juillet 1584, nous revoyons Nicolas Barbier
y travailler encore.
Le peintre Louis Poisson, au mois d'août 1585, peignait les piliers
des orgues.
L'année suivante, I'organiste Étienne Aubriot réparait
à nouveau la soufflerie ; en 1591, il devait remanier les tuyaux,
y faire des pieds neufs et réparer les porte-vents, mais son travail
parut vite insuffisant et une révision totale de l'orgue fut confiée
au facteur parisien Roch Dargillières : celui-ci, d'octobre
1593 à juin 1595, travailla sans discontinuer.
En 1598, la soufflerie nécessitait une révision complète
et le facteur d'orgues Ysacq Aubriot, avec le concours du menuisier
Roland Mauvoisin entreprenait cette restauration qui ne fut terminée
qu'en novembre 1601.
Après une nouvelle réfection de la soufflerie en 1615, une
rénovation complète de l'instrument parut à nouveau
nécessaire, et, par le marché du 24 octobre 1618, le grand
facteur rouennais Crépin Carlier fut chargé du travail.
Tous les jeux furent refaits et Carlier ajouta au grand orgue un bourdon
de bois de 8 pieds bouché sonnant à I'unisson du 16 pieds,
un jeu de flûte traversière de plomb et une petite quinte
(petit nasard ou flageolet).
En outre, Carlier fit construire un buffet de positif reproduisant en
dimensions réduites le buffet du grand orgue ; trois statues :
la Sainte Vierge, Saint-Gervais et Saint-Protais le couronnaient.
Les travaux commencés en septembre 1619 furent terminés
en juillet 1620.
Dix ans après la restauration de Carlier, l'organiste Claude Aubriot
devait, en 1630, faire quelques réparations à son instrument
L'année suivante, l'organiste de Saint-Jacques de la Boucherie
de Paris venait visiter les orgues de Gisors et exécutait toute
une série de révisions et de transformations.
Nous ne connaissons pas le devis de son ouvrage et c'est seulement par
l'état dressé vers 1680 que nous pouvons inférer
que l'adjonction au positif de deux nouveaux jeux, une flûte
allemande et une fourniture, doit lui être attribuée.
Les orgues de Gisors ne réclamèrent aucune réparation
jusqu'en 1651, année où fut refaite la soufflerie. L'année
suivante, l'organiste de la Cathédrale de Beauvais visitait l'instrument,
et, le 8 mars 1654, marché était passé par les Trésoriers
de la Fabrique avec Claude de Villers , ce facteur rouennais qui
s'était acquis une belle réputation en restaurant les grandes
orgues de la cathédrale de Rouen.
Tous les tuyaux des grandes et des petites orgues furent démontés
et révisés, la soufflerie fut réparée.
En 1682, l'instrument demandait une nouvelle révision, mais ce
fut au rival de Claude de Villers, le facteur, rouennais lui aussi, Robert
Ingout , que s'adressa la fabrique. Par le contrat du 2 janvier 1684,
Ingout s'engageait à démonter, nettoyer et réviser
tous les tuyaux, à refaire complètement la soufflerie, remplacer
par des tuyaux d'étain divers tuyaux de bois, à faire deux
tremblants, à transformer en nasard la flûte du positif et
le larigot en tierce.
Après une légère réparation, effectuée
en 1705 par le facteur Deslandes et la redorure du buffet faite
en 1719, il fut procédé en 1724 par Ie facteur Labour
à une nouvelle révision des jeux, complétée
et généralisée l'année suivante par le facteur
Jean Regnault qui refit encore la soufflerie et les sommiers.
Regnault et le facteur parisien Nicolas Collard étaient
encore occupés à remanier l'instrument en 1728.
Depuis sa construction par Nicolas Barbier, l'orgue de Gisors avait subi
maintes révisions qui, en somme, l'avaient peu modifié ;
il pouvait passer pour archaïque et nécessitait de fréquentes
réparations. Nous possédons une lettre de l'organiste Hugot
de 1731 où il déplore cet état de choses. "Cet
orgue qui peut à juste titre passer pour l'un des plus beaux de
Normandie et même du royaume, pêche néanmoins dans
ses parties essentielles".
Hugot ne demande pas une pédale de bombarde ni un jeu de hautbois
au positif, mais seulement le strict nécessaire, faute de quoi
l'orgue de Gisors ne tarderait pas à mériter à peine
le toucher d'un musicien de la dernière classe.
Après une visite de l'organiste de la cathédrale de Rouen,
d'Agincourt et du facteur rouennais Charles Lefebvre , un
devis est demandé à ce dernier ; ce devis, dressé
le 13 septembre 1737, prévoit, pour 2.800 livres, la révision
totale de l'instrument et des modifications à la composition des
jeux.
La somme parut trop élevée et Charles Lefebvre fut seulement
chargé de quelques légères réparations en
1732 et 1746.
Le 4 juillet 1751, les trésoriers approuvaient un marché
pour la réparation des orgues passé avec Jean-Baptiste-Nicolas
Lefebvre , de Rouen, à la condition toutefois que la dépense
ne dépasserait pas 1800 livres. Le facteur parisien Bessart
approuva le devis proposé par Lefebvre, un marché ferme
fut signé, le 5 septembre 1751, et les travaux suivants furent
effectués de septembre 1751 à octobre 1752 :
Révision de tous les jeux, remise en état des sommiers du
grand orgue, remplacement du flageolet et de la tiercelette par une flûte
allemande de 8 pieds, suppression de la voix humaine, contrairement à
l'avis de Bessart.
Au positif, adjonction d'un jeu de larigot.
A la pédale, adjonction d'un clairon.
Construction d'un cinquième soufflet.
Remplacement des claviers et du sommier du positif.
 Ce
fut encore à Jean-Baptiste-Nicolas Lefebvre que la Fabrique
recourut le 2 avril 1769 pour la plus importante transformation que Ies
orgues de Gisors aient subie depuis leur construction.
Ce
fut encore à Jean-Baptiste-Nicolas Lefebvre que la Fabrique
recourut le 2 avril 1769 pour la plus importante transformation que Ies
orgues de Gisors aient subie depuis leur construction.
Le 7 avril, Lefebvre déposait entre les mains des Trésoriers
son devis.
Marché fut conclu le 8 septembre 1769, mais les travaux avancèrent
lentement, et le 16 septembre 1772, la fabrique avait à se prononcer
sur une nouvelle proposition de Lefebvre, vu le mauvais état de
la plupart des tuyaux du grand orgue, I'état de vétusté
et l'architecture démodée de son buffet, le facteur estimait
qu'il y aurait avantage à reconstruire complètement le grand
orgue.
Le Duc de Penthièvre, le dernier seigneur de Gisors, prit à
sa charge la dépense de la construction du buffet du grand orgue.
Ainsi fut fait ; la pose du nouveau buffet du positif nécessita
la démolition de la balustrade de pierre et du pupitre de Fortin
; le serrurier gisortien Beauquesne les remplaça par une rampe
de fer forgé pour laquelle on utilisa les deux anciennes grilles
du cimetière.
Le buffet du grand orgue comme celui du positif fut l'œuvre des menuisiers
Carbonnier et Greslez et du sculpteur Louis. Trois consoles décorées
de feuilles de palmier supportaient de chaque côté, et au
centre du buffet du grand orgue, les faisceaux de tuyaux de 16 pieds,
la tourelle du centre dépassant d'un tiers les deux autres. De
grandes urnes d'où s'échappaient de gros feuillages couronnaient
le sommet de ces tourelles. Dans l'intervalle, au-dessus des huit pieds
de montre, un amoncellement de feuillages stylisés montait jusqu'au
pied de l'urne de la tourelle centrale.
Le buffet du positif présentait la même disposition, sauf
que les tourelles du côté étaient au contraire plus
hautes que celles du centre. L'ensemble était d'une bonne venue,
un peu austère peut-être.
Les travaux de J.B.Nicolas Lefebvre ne furent terminés qu'à
la fin de 1774.
Composition de l'orgue de JEAN-BAPTISTE NICOLAS
LEFEBVRE ![]()
Le 13 décembre, le grand facteur parisien Francois Henri Cliquot,
l'organiste de Saint-Germain-en-Laye, Lafont, et Dardel, le maître
menuisier de Magny-en-Vexin, ne signalaient dans leur procès-verbal
de visite que quelques vétilles auxquelles il était facile
de remédier. La Fabrique donna décharge de son orgue à
Lefebvre et remit une gratification de 150 livres au commis de Lefebvre,
le facteur Dubois, pour le jeu de hautbois qu'il avait ajouté
et pour la réfection des cinq anciens soufflets .
Après quelques réparations sans importance effectuées
par Lefebvre en 1778, il n'est plus question de travaux aux orgues de
Gisors avant l'an X de la République.
Pendant la Révolution, I'instrument ne s'était jamais longtemps
tu, il participa plusieurs fois aux fêtes qui furent célébrées
dans l'église, devenue Temple de l'Être suprême, et
notamment aux fêtes de la fondation de la République.
L'organiste Girod, en I'an X et l'an Xl, effectua diverses réparations
aux tuyaux de certains jeux.
Vingt ans devaient pourtant s'écouler encore avant qu'on ne songeât
à la restauration complète que le manque d'entretien rendait
chaque année plus indispensable ; le 25 avril 1833, le conseil
de fabrique faisait remarquer au conseil municipal que l'orgue "dont
la beauté faisait l'admiration de tous les connaisseurs"
se trouve dans un tel état de dégradation que s'il n'est
prochainement réparé, I'on se trouverait dans la douloureuse
nécessité de cesser d'en faire usage.
Le conseil municipal resta sourd à cet appel et pour parer au plus
urgent, on fit faire par le facteur Gorin les réparations
les plus indispensables.
Au cours de l'année 1840, on dut renoncer à se servir de
l'instrument et pendant plus d'un an, I'orgue se tut. Le 2 janvier 1842,
la fabrique demanda à la Maison Daublaine et Callinet l'établissement
d'un devis de restauration.
Le juge Hamel, de Beauvais écrivait le 8 février
à un des fabriciens : "Vous possédez un instrument
fort beau mais qui est dans un état de délabrement tel que
la restauration en est devenue indispensable et malheureusement on a attendu
si longtemps que c'est plutôt une reconstruction qu'une réparation
qu'il s'agit de faire maintenant".
Trois devis successivement établis par Danjou, I'organiste de Saint-Eustache
de Paris, et le facteur Girard, au nom de la Maison Daublaine,
prévoyaient la remise à neuf des 2900 tuyaux de I'orgue.
Le deuxième devis fut accepté par la fabrique le 19 mars
1842.
Ce devis comprenait la réfection du sommier du grand orgue disposé
pour contenir 20 jeux, la confection d'un sommier de récit pour
9 jeux, d'un sommier de pédales pour 7 jeux et d'un sommier de
positif pour 16 jeux, la révision de tout le mécanisme,
la fourniture d'une boîte expressive pour contenir le récit,
l'établissement d'un nouveau système de soufflerie, la réparation
de tous les tuyaux, l'adjonction d'une flûte de 16 pieds au pédalier,
le remplacement de la troisième trompette du grand orgue par une
de 8 pieds et d'une de 4 pieds, I'adjonction au récit d'une flûte
harmonique, d'une trompette de forte taille et d'une voix humaine, adjonction
au positif d'un salicional de 8 pieds et d'un de 4 pieds.
Grâce à de fructueuses quêtes à domicile et
à un prêt consenti par la municipalité, ce programme
fut entièrement réalisé.
Le 25 juin 1844, I'orgue était reçu solennellement par les
experts désignés, Hamel, l'expert de Beauvais, Pierre Honoré
Danainville, le facteur parisien, et Gautier, I'organiste de St-Etienne
du Mont ; un beau programme musical fut exécuté par Danjou,
alors organiste de Notre-Dame de Paris, les deux organistes de Saint-Roch,
Lefebvre-Wély et Dierth, Boulanger et Duwarlet, les organistes
des Cathédrales de Beauvais et d'Evreux, par Gautier, enfin, I'organiste
de Saint-Etienne du Mont.
La restauration de Daublaine permit à l'orgue de Gisors de fonctionner
d'une manière satisfaisante pendant près de cinquante ans.
Vers 1870, les sommiers avaient dû cependant être refaits
par Merklin et Schütze.
En 1892, une nouvelle restauration s'imposait.
Des devis furent dressés par Kreicher, de Rouen, Abbey, de Versailles,
Godefroy, de Paris , mais sur le conseil d'un musicien de talent, mal
avisé en l'occurrence, l'Abbé Cresté, ce fut au facteur
Anneessens, d'Halluin, qui ne pouvait se recommander que du prix
modique de ses travaux, que la Fabrique recourut.
Par le marché conclu le 13 septembre 1894, Anneessens s'engagea
à réparer et réharmoniser tous les jeux, à
remplacer la soufflerie par un réservoir système Cumens,
à 2 pompes, à faire un nouveau sommier de récit d'après
son fameux système tubulaire pneumatique, à ajouter enfin
au récif 4 nouveaux jeux, flûte harmonique de 8 pieds, viole
de gambe de 8 pieds, voix céleste de 8 pieds et trompette harmonique
de 8 pieds, à faire une boîte expressive avec pédale
à bascule pour le récit, à réparer tous les
sommiers, à mettre une sousbasse de 16 pieds à la pédale,
à faire enfin des entailles harmoniques aux principaux jeux de
fond.
Le 24 mars 1895, l'orgue était inauguré par Alfred Josset,
organiste de l'École Sainte-Geneviève, les organistes Marie
Voizard, Coling, Cabel et le titulaire de l'orgue de Gisors, I'éminent
M. Jules Rousscau. Le travail d'Anneessens présentait déjà
bien des défauts qui, sur les remontrances de Josset, furent en
partie corrigées par le facteur en 1896.
Les modifications subies par le récit avaient été
mal conçues et beaucoup de tuyaux furent rapidement hors de service.
La nouvelle restauration des orgues de Gisors que M. Ie Chanoine d'Hostel
a confiée à l'habileté de M. Gutschenritter
a eu tout d'abord pour objet de parer à ces défectuosités
de l'ouvrage d'Anneessens.
M. Gutschenritter, outre une révision complète de tous les
jeux, et l'application généralisée d'entailles harmoniques,
a réalisé l'application d'une machine pneumatique pour adoucir
les claviers, adjonction de pédales d'accouplement pour réunir
les claviers à main au pédalier et les accoupler entre eux,
remplacement des tuyaux d'anches du grand orgue, complément des
jeux de pédale portés à 30 tuyaux, d'où agrandissement
des sommiers, application d'appel des jeux de combinaison, électrification
de la soufflerie avec ventilateur appliqué, établissement
de nouveaux claviers à mains de 54 à 56 notes et disposés
d'une façon plus commode pour l'organiste, installation de réservoirs
à double pli, modifications dans les jeux, transformation du prestant
du récit en flûte octaviante, de la cymbale du positif en
un piccolo, du salicional en une unda maris, de la gambe de 4 pieds du
grand orgue en une dulciane, de la grosse flûte en flûte harmonique,
déplacement des jeux de sous-basse et du bourdon de 16 pieds qui
encombraient le corps de l'instrument, adjonction d'une flûte de
32 pieds à la pédale ; d'un octavin et d'un basson-hautbois,
un récit, transfert au positif du cromorne du récit, groupement
par claviers des boutons de tirage des jeux, pose des tuyaux de façade
sur de petits sommiers pneumatiques.
Les orgues de Gisors, avec leurs 3288 tuyaux parlants et leurs 70 tuyaux
de façade, formerent alors un instrument de 55 jeux ![]() .
.
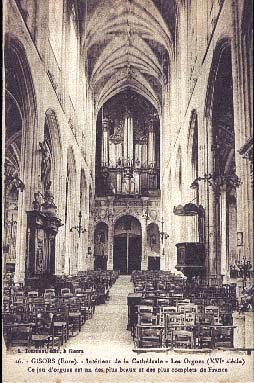 Les
grandes orgues de Gisors avaient été tant de fois remaniées
et renouvelées de fond en comble qu'on n'y pouvait plus guère
reconnaître de parties très anciennes, à part le buffet
édifié, nous l'avons vu, en 1773.
Les
grandes orgues de Gisors avaient été tant de fois remaniées
et renouvelées de fond en comble qu'on n'y pouvait plus guère
reconnaître de parties très anciennes, à part le buffet
édifié, nous l'avons vu, en 1773.
Cependant si l'on considère la composition et la répartition
des jeux, on ne peut manquer de remarquer qu'elles témoignaient
des œuvres des divers facteurs qui ont travaillé à
l'instrument du XVIe siècle au XIXe siècle.
Au grand orgue, douze des jeux se trouvaient déjà dans l'orgue
primitif de Barbier en 1579, le bourdon de 16 pieds et la tierce témoignaient
de la réfection de Carlier, la flûte et la deuxième
trompette de celles de Lefebvre, en 1751 et en 1774 ;
au positif, cinq des jeux existaient déjà dans I'orgue de
1579 : la flûte et la fourniture témoignent de l'œuvre
de l'organier de 1631 ; la tierce et le nasard de celle d'Ingout ; la
montre de 8 pieds, la trompette et le cornet, de la réfection de
1870 ;
le bourdon et la trompette du pédalier faisaient partie de l'orgue
de Barbier, le clairon a été introduit par Lefebvre, en
1751, ainsi que la bombarde, la flûte de 8 pieds en 1770 ; Seuls
les jeux du récit ne remontaient pas au-delà du XIXème
siècle.
L'orgue est inauguré le 3 juin 1928 par André MARCHAL.
D'après la notice historique publiée par
MARCEL BAUDOT
Archiviste départemental de l'Eure.
Après la restauration de Gutschenritter.
Document intégral sur: http://orgue.gisors.free.fr/
Par la suite ...
Les 6, 7 et 8 juin 1840, sous les bombardements, un incendie détruit
dans sa totalité la toiture de l'église et l'orgue.
En octobre 1946, le grand pignon occidental de l'église, mal étayé,
s'effondre durant une tempête, détruisant ce qui restait
de la tribune.
En 1957, le relevage de la grande nef est entrepris, travaux qui dureront
plus de 10 ans, entraînant le cloisonnement intérieur de
l'église.
Le 8 octobre 1964, le conseil municipal décide la reconstruction
d'un orgue "pouvant répondre à l'importance de l'édifice".
Les crédits ne permettent pas une reconstruction à l'identique.
Le 16 novembre est établi un cahier des charges particulières.
Deux projets sont proposés et soumis à cinq facteurs : Boisseau,
Haerpfer-Erman, Gutschenritter, Kern, Schwenkedel.
Le 1er mars 1965, une commission se constitue, avec Francis Chapelet comme
conseiller technique privé. Elle approuve à l'unanimité
le projet Haerpfer-Erman correspondant au 2e projet-type : un orgue
de 35 jeux, 3 claviers et pédale. La traction sera mécanique
pour les notes et éléctropneumatique pour les jeux, il y
aura des chamades et un tremblant.
Cependant, Francis Chapelet parvient à imposer les modifications
suivantes : la traction des jeux sera mécanique ; les principaux
et les mixtures seront en alliage à 75% d'étain (au lieu
de 52% prévu), la console sera de type classique avec accouplement
à tiroir.
 1965-1967
: Querelles au sujet de l'esthétique du buffet : projets divers,
hésitations et lenteurs administratives.
1965-1967
: Querelles au sujet de l'esthétique du buffet : projets divers,
hésitations et lenteurs administratives.
Le 26 juin 1967, L'architecte en chef des Monuments Historiques autorise
la reconstruction du buffet à l'identique de l'ancien. Il invite
le facteur d'orgues à construire le bas du buffet, précisant
que le haut serait reconstruit avec des sculptures lors du remontage de
l'instrument en tribune : les Beaux Arts prendront en charge le financement
de ces travaux.
Soutenu par l'architecte en chef des Monuments Historiques, le facteur
supprime les chamades initialement prévues, celles-ci n'étant
pas conformes à l'esthétique classique française
et qui ne figuraient pas dans l'ancien orgue détruit.
En 1968, l'orgue est prêt à être livré. Placé
contre le mur provisoire de plâtre masquant la tribune encore en
chantier, l'instrument est installé sur le dallage en attente de
l'achèvement des travaux.
La tribune est prête à recevoir l'instrument en 1982. L'équipe
Haerpfer démonte l'orgue et le remonte sur la tribune rénovée.
Le buffet est alors complété de certaines parties ornementales
qui lui manquaient jusque là. Un cornet de cinq rangs est ajouté.
Par contre, il est dommage que le Positif n'ait pas été
doté d'une Montre de 6 ou de 8 pieds (même postiche) descendant
jusqu'au niveau du sol de la tribune, l'actuelle semblant posé
sur la rambarde, le dessous mal camouflé par un vilain contreplaqué.
L'orgue est inauguré le 16 octobre 1982 par sa future titulaire
Sarah Soularue.
En 2006, un accord général est confié à Denis
Lacorre. À cette occasion, la Mixture de Pédale est
transformée en Théorbe de IV rangs. Des tremblants sont
ajoutés au Positif et au Pectoral.
L'orgue HAERPFER-ERMAN aujourd'hui
| Positif (56 notes) | Grand-Orgue ( 56 notes) | Pectoral (56 notes) | Pédale (32 marches) |
| Bourdon 8 Flûte 4 Prestant 4 Doublette 2 Nasard 2 2/3 Tierce 1 3/5 Larigot 1 1/3 Fourniture-Cymbale V Cromorne 8 |
Bourdon 16 Bourdon 8 Grosse tierce 3 1/5 Montre 8 Prestant 4 Doublette 2 Nasard 2 2/3 Tierce 1 3/5 Cornet V Fourniture IV Cymbale III Trompette 8 Clairon 4 |
Bourdon 8 Flûte 4 Doublette 2 Sesquialtera II Cymbale III Voix humaine 8 |
Principal 16 Soubasse 16 Flûte 8 Flûte 4 Flûte 2 Théorbe IV Bombarde 16 Trompette 8 Clairon 4 |
| Tremblant | Tremblant Rossignol |
tirasses : Pos/Péd ; GO/Péd
accouplements : Pect/GO ; Pos/GO
D'après le très beau site consacré à cet
orgue: http://orgue.gisors.free.fr/
... et merci à Sarah Soularue qui le joue si joliment.
DGW - Juin 2007