 ABéCéDaire
de l'orgue
ABéCéDaire
de l'orgueA
comme
Aubervilliers
C'est dans
le "neuf-trois" !
(93, Seine-Saint-Denis)

 En
l'an 1242, il n'y avait à Aubervilliers qu'une simple chapelle,
une "succursale" de Saint-Marcel-lès-Saint-Denis. Elle
fut érigée en paroisse vers l'an 1300 sous l'invocation,
qu'elle avait déjà, de Saint Christophe.
En
l'an 1242, il n'y avait à Aubervilliers qu'une simple chapelle,
une "succursale" de Saint-Marcel-lès-Saint-Denis. Elle
fut érigée en paroisse vers l'an 1300 sous l'invocation,
qu'elle avait déjà, de Saint Christophe.
De 1336 à 1607, les nombreuses guérisons qui se produisirent dans cette chapelle lui firent donner le nom de Notre-Dame des Vertus qu'elle n'obtint officiellement qu'en 1866. Au sens étymologique du terme, "Notre-Dame des Miracles". Ces guérisons provoquèrent la renommée et la reconstruction de l'édifice. Construit en pierres tendres, du XIVe au XVIIe siècle, il a 40 mètres de long sur 22 mètres de large et présente un clocher monumental. La façade de l'église a été construite vers 1628 dans un parfait style Jésuite.
En 1411 les Armagnacs pillèrent l'église.
En 1459, les Anglais occupèrent la région jusqu'à
la pais d'Arras.
En 1529, devant les progrès du protestantisme, "toutes
les paroisses de Paris s'assemblèrent en l'église Cathédrale
(de Paris) et allèrent en procession à Nostre-Dame-des-Vertus
à la clarté d'un si grand nombre de torches et de flambeaux
que ceux qui estoient vers Montlhéry pensaient que le feu fut dans
Paris" Un vitrail illustre cet épisode. On y voit la tour
de Montlhéry tout au fond. ->
En 1567 une bataille opposa l'armée catholique d'Anne de Montmorency
aux troupes du Prince de Condé.
En 1590, pendant le siège de Paris, Henri IV campa à proximité
du village.
En 1614, Louis XIII, victorieux des Protestants, y fit vœux de bâtir
une église et en présenta la maquette : ce sera Notre-Dame
des Victoires ! (A Paris).
Avec l'établissement des Oratoriens au XVIIe siècle, Aubervilliers
devint un centre spirituel important et reçut d'illustres visiteurs
parmi lesquels on note Jean-Baptiste de la Salle (qui y a sa statue).
L'Orgue de Notre-Dame des Vertus, à Aubervilliers.
L'orgue ne peux pas être antérieur à l'achèvement du portail derrière lequel il se trouve, en 1628.
| Composition d'origine probable : | |
|
Grand-Orgue
|
Récit
|
| Montre 8' Bourdon 8' Prestant Doublette Fourniture Cymbale Flûte 4' Nasard Tierce Flageolet 1' Cornet V (25 notes) Trompette Clairon Voix Humaine |
Cornet V |
| Tremblant fort, Rossignol (?), Tambour (?). | |
Il est vraisemblable de dater l'érection de l'Orgue vers 1630-1635.
Le style du grand buffet l'apparente plus ou moins étroitement
à ceux de Pont de l'Arche (1605), Meaux (1627), et surtout Notre-Dame
de Pontoise (1638) et Mitry (1641).
le nom du facteur reste dans le doute. Un des derniers ouvrages de Pescheur ?
De Valeran de Héman ? Ce dernier est plus probable
puisqu'un relevage est demandé en 1657 à Pierre Desenclos,
ex associé et successeur des neveux Héman, eux-mêmes
successeurs de Pescheur.
Le devis-mémoire que Pierre Desenclos présente le 23 novembre
1657 permet de supposer que l'orgue a déjà une trentaine
d'années.
Cet orgue était à deux claviers : un Grand-Orgue de
14 jeux sur 48 notes et un Cornet d'Écho, sur 32 notes (?)
A l'occasion du relevage, faute de Positif, Desenclos complète l'Écho en deuxième plan sonore en y ajoutant une Cymbale de deux rangs et un Cromorne. Il ajoute un second tremblant à vent perdu et un pédalier en tirasse de 29 notes.
Une tradition (comme il en est trop) veut qu'une réfection complète
de la tuyauterie soit attribuée à "Clicquot".
En fait, le buffet du positif ajouté à cette occasion, le
clavier et le sommier de Positif avec 1er Ut#, les tirants de registres
(ceux ajoutés, les autres sont authentiques), le pédalier
et les tuyaux trahissent une intervention au début du XIXe siècle.
Les claviers, reconstruits, sont montés à 51 notes (au ré).
Les deux rangs de Cymbale du Récit sont descendus au Positif.
Le style tardif du petit buffet de Positif semble être plutôt
de Dallery. Certainement pas de Clicquot dont le style est assez
bien défini, comme on peut le voir sur les positifs de Poitiers
ou de Saint
Nicolas des Champs. Les flancs du Positif d'Aubervilliers sont composés
de panneaux plus anciens encore. Pendant cette période de 150 ans
entre 1657 et 1800, n'y aurait-il pas eu d'autres travaux ? La question
reste sans réponse d'autant plus que le Plein-Jeu du positif ne
semble pas issu de celui, disparu, du Grand-Orgue et est trop complet
pour être issu des seuls deux rangs de cymbale de l'Echo.
| Positif, 51 notes | Grand-Orgue, 51 notes | Récit expressif, 39 notes (au Do 2) |
| Dessus de Flûte 8' Bourdon 8' Montre 4' Nasard Tierce Plein-Jeu Cromorne Raugel aurait oublié la Quarte et le dessus de Hautbois ? |
Bourdon 16' / Dessus flûte 16' Montre 8' Bourdon 8' Dessus Flûte 8' Prestant Nasard Octavin Tierce Cornet V Trompette Grande Trompette Clairon |
Flûte 8' Bourdon 8' Gambe Céleste Flûte Octaviante 4' Pleureuse (Voix-Humaine) Clarinette Clairon |
| Pédale en tirasse 24 notes Ut à Si, Accouplement à tiroir II / I, Appel P.J. Positif et Anches GO, | ||
La seconde moitié du XIXe siècle et le goût Romantique ont imposés des modifications que décrit Félix Raugel avant 1927 dans "Grandes Orgues du département de la Seine". L'orgue y est décrit au ton moderne :
Quelques modifications ont été faites avant 1939 par Louis-Eugène
Rochesson :
la Pleureuse descend au Grand-Orgue sous forme de dessus de 16',
Le Hautbois de Récit fut prolongé en Trompette dans la basse,
Disparition du Clairon de Récit,
Descente de la Flûte 8' au Grand-Orgue,
...
Et à la fin de la guerre, il entreprend une restauration très
limitée laissée inachevée :
Calottes mobiles aux Bourdons,
Oreilles à la Montre en façade,
Prolongation du Hautbois du Positif par un Basson dans le grave, copié
sur celui de Dallery à Saint Gervais,
Pose d'un Octavin 2' et d'un Nasard d'occasion au Récit,
Repose des restes de la "Pleureuse" au Récit, complétée
par des jeux à bouche,
Décalage de la Grande Trompette en Dessus de Bombarde 16'.
La restauration de 1990.

La restauration de l'orgue a été abordée avec le
plus grand respect, de par l'intérêt présentés
par les mécanismes et sommiers anciens ainsi que par sa tuyauterie,
même si cette dernière a subi des amputations et des altérations
dues au changement de goût et à une mise au ton moderne.
L'essentiel de la tuyauterie remonte au XVIIe siècle, probablement
à l'orgue d'origine.
Cromorne, Trompette et Clairon sont du XVIIe siècle, en étain
martelé.
Trois jeux d'anche sont de facture fin XVIIIe (Dallery ?) :
un dessus de Bombarde 16', la Voix-Humaine et le Hautbois.
Les jeux à bouches présentent un grand intérêt.
Il sont du XVIIe siècle également, bien que certains fassent
penser à une facture milieu du XVIIIe siècle. Les déplacements
et les recoupes pour la mise au ton les ont laissés dans le plus
grand désordre.
Quelques jeux ont disparu : le Plein-Jeu du Grand-Orgue, la Flûte
de 4', le Larigot, le Flageolet, le Cornet du Récit. Mais certains
de leurs tuyaux ont servi à compléter les dessus des autres
jeux, ce qui a rendu leur restitution possible en les copiant à
l'identique.

Lors de la restauration, un retour à l'orgue d'avant la révolution
a été adopté. Enfin..., le retour à l'orgue
de Dallery, en considérant que ce dernier, s'il en est l'auteur
au début du XIXe siècle, travaillait encore comme Clicquot.
Seule l'option pour un Récit XVIIIe a été préférée
à un retour à un Écho XVIIe.
Retour au ton (1/2 ton sous le diapason moderne*) et tempérament
(à 5 tierces pures) anciens retrouvés après reclassement
de la tuyauterie.
(*) Le ton de chapelle était, en France, plus
bas d'un ton par rapport au diapason moderne. Seul Thierry appliquait
ce diapason au "ton de cour" (???).
Les travaux furent confié au Facteur d'Orgues Robert Chauvin, avec l'aide des Facteurs Benoist et Sarrelot.
| Positif de dos, 51 notes | Grand-Orgue, 50 notes sans 1er ut# | Récit, 32 notes. |
| Montre 8', Dessus de Flûte (au sol 2) Bourdon 8' Prestant 4' Doublette Nasard Tierce Larigot Fourniture III Cymbale II Cromorne |
Bourdon 16' Montre 8' Bourdon 8' Prestant Flûte 4' Doublette Nasard Tierce Flageolet Fourniture IV Cymbale IV Cornet V Trompette Clairon Voix Humaine (en B & D) |
Bourdon 8' + Prestant 4' Cornet III Hautbois Trompette |
| Pédale 25 notes en tirasse, Accouplement à tiroir Pos/GO, Tremblant doux. | ||
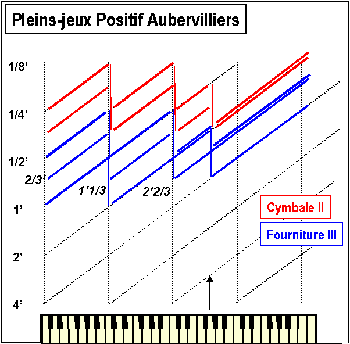

Une soufflerie à trois soufflets cunéiformes superposés a été installée sur le côté gauche de l'orgue, côté de l'entrée de l'ancien porte-vent.

Page rédigée à partir de l'article
publié par Pierre Hardouin et Jean Fonteneau dans "Connaissance
de l'Orgue" N° 7/8 en 1973, et
la plaquette éditée en 1990 par le Centre Culturel et le
Service des Archives Municipales d'Aubervilliers.