 ABéCéDaire
de l'orgue
ABéCéDaire
de l'orgueP comme PARIS
Saint Séverin
L'orgue soixante-huitard

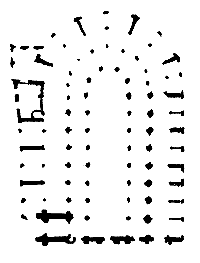 L'église
Saint Séverin est un des plus beaux joyaux du Gothique flamboyant.
Elle est célèbre pour son pilier axial à nervures
torses du déambulatoire sur lequel viennent se greffer les 14 arêtes
de la voûte..
L'église
Saint Séverin est un des plus beaux joyaux du Gothique flamboyant.
Elle est célèbre pour son pilier axial à nervures
torses du déambulatoire sur lequel viennent se greffer les 14 arêtes
de la voûte..
Elle tire son vocable d'un solitaire qui avait établi
là son ermitage sur la rive gauche de la seine, au VIe siècle.
C'est de lui que le petit-fils de Clovis voulut recevoir l'habit monastique
en 526.
Plus tard, on associa dans une même vénération un
autre Saint Séverin, Abbé lui, venu à Paris pour
guérir Clovis d'une fièvre maligne et qui mourut à
Château-Landon.
L'oratoire qui fut bâti là, on ne sait pas trop en l'honneur
duquel des deux, fut détruit par les Normands.
Il ne subsiste aucun vestige antérieur au XIIIe siècle.
La rive gauche étant "l'Université",
par opposition à la "Cité", l'importance de la
paroisse allait toujours croissant. On commença par élargir
l'église en lui adjoignant de nouveaux bas-côtés.
Détruite, puis reconstruite au XVe siècle, il ne subsiste
que le deuxième bas-côté méridional et les
trois premières travées de la nef. A quelques détails
près, l'église est telle que nous la voyons aujourd'hui
depuis le début du XVIe siècle. Du XIIIe siècle subsiste
aussi le portail qui n'est pas d'origine. Il vient d'une église,
détruite, de la Cité et a été transplanté
sous Louis-Philippe.
L'église voit, pendant six siècles, tout ce que l'Université
de Paris compte d'hommes illustres. Aujourd'hui encore, Saint Séverin
est une paroisse d'étudiants.
L'Orgue
Des orgues sont connues à Saint Séverin depuis 1368, don du Maître Regnault de Douy, "Escolier en Théologie de Paris et gouverneur ès grans escoles de la parouesse Saint Séverin". Elles sont petites mais d'une sonorité si agréable que l'on "cuydait ouîr les Anges du Paradiz".
Cet orgue fut remplacé au début du XVIe siècle, dans l'église reconstruite. Cet instrument de la Renaissance était placé sur le côté du chœur et clos de volets peints.
Au début du XVIIe siècle, Valeran de Héman,
qui travaille à l'orgue de Notre-Dame, le dote d'un clavier de
Récit commandant le Cornet du grand clavier.
Ce n'est qu'en 1626 que l'organiste Duprez obtient la construction
d'un Positif dans lequel Valeran de Heman place 9 jeux et en profite pour
polir la Montre, refaire la Voix-Humaine sur un registre coupé,
installer une Pédale de 12 notes sur un sommier neuf : Flûte
8' en bois, Trompette.
Successeurs de Valeran De Heman, les Thierry entretiennent l'orgue. En 1670 les fils refont les 5 soufflets du vieil instrument alors que Jean Denis, organiste récemment agréé, réclame la réfection totale de l'instrument. Le marché est passé le 9 novembre avec Charles et Alexandre Thierry mais l'orgue ne sera livré qu'en avril 1673 après une longue procédure qui opposa facteurs et experts, notamment au sujet de sommiers longs de six pieds que le buffet ne pouvait contenir.
|
Positif, 48 notes
|
Grand Clavier 48 notes
|
Récit 25 notes
|
Écho 27 notes
|
| Bourdon 8' Prestant Flûte 4' Nasard Doublette Tierce Fourniture III Cymbale III Traversine Cromorne |
Bourdon 16' Montre 8' Bourdon 8' Prestant Flûte 4' Nasard Doublette Quarte de Nasard Tierce Fourniture Cymbale Trompette Clairon Voix-Humaine |
Cornet (du GO par 25 gravures ajoutées au sommier) | Cornet |
| Pédale 30 notes, ravalement
au La : Flûte 8' Trompette 8' |
|||
| 2 tremblants, 2 Rossignols, Tirasse mobile, Accouplement. | |||
 XVIIIe
XVIIIe
En 1729, c'est un instrument fort délabré qui échoit à Michel Forqueray qui abandonne pendant plusieurs années la moitié de son traitement pour les réparations les plus urgentes.
Il faut attendre 1745 pour que la construction d'un orgue
neuf sur une tribune au fond de la nef soit décidée. La
menuiserie du buffet est confiée à François Dupré
et la sculpture à Jean-François Fichon. Tribune,
buffets et balustrade sont d'une magnifique unité de style Louis
XV.
Sur la tourelle centrale du Positif est couché l'Agneau pascal.
Le Facteur Claude Ferrand fournit un instrument neuf en réutilisant les jeux anciens en bon état. Ce "Grand Seize pieds" fut considéré comme l'un des plus beaux de la capitale, ce qui fournit à Voltaire matière à raillerie :
"Votre sotte voisine et votre voisin, plus sot encore, vous reprochent sans cesse de ne pas penser comme l'on pense rue Saint Jacques. ... Prenez alors une mappemonde ... vous opposerez l'univers à la rue Saint Jacques. Peut-être auront-il alors quelque honte d'avoir cru que les orgues de Saint Séverin donnaient le ton au reste du monde".
Nicolas-Gilles Forqueray succéda à son oncle et se retira à son tour peu après en faveur de son neveu Nicolas Sejean qui tint les claviers jusqu'à la chute de l'Ancien Régime.
XIXe
La Convention fit de Saint Séverin un dépôt de poudres et salpêtre.
Au sortir de la tourmente, l'Orgue refuse tout service.
Appelé, Dallery père remet l'orgue en état,
refait les pieds et les écussons de la grande Montre. Il refait
à neuf deux Trompettes, le Clairon de la Pédale, le Cromorne
du Positif et dote le Récit d'un Hautbois.
Il en alla ainsi jusqu'à la dernière décennie du
siècle.
L'orgue classique avait cessé de plaire depuis longtemps et les églises se dotaient d'instruments Romantiques et Symphoniques.
En 1889 les fils de John Abbey furent chargés de
la reconstruction de l'Orgue dont seuls 25 jeux furent réutilisés,
mais après une réharmonisation irréversible.
Abbey refit totalement les sommiers, la soufflerie et la mécanique.
Il installa une console séparée dans le Positif vidé
et scié. Pour placer un sommier supplémentaire, la paroi
du fond est reculée.
L'organier est habile, la facture est impeccable mais l'orgue est désormais
"symphonique". Albert Périlhou est très
attaché à l'instrument qu'il tient pendant 25 ans. Sa tribune
est ouverte à Gabriel Fauré et à Camille
Saint-Saens qui se font une joie d'improviser dans un aussi joli cadre.
XXe
Entre les deux guerres mondiales l'orgue fut déterioré
à la suite de la réfection de la grande verrière
de la façade.
La guerre de 40 suspendit pour longtemps les travaux envisagés
et ce n'est qu'en 1958 que le Père Aumont élabora
avec Michel Chapuis un beau projet :
"... Nous avons un buffet classique avec sa façade de Positif séparée. Par conséquent, que le Positif soit rétabli est une condition première et essentielle. Il faut voir le travail dans un grand plan d'ensemble qui soit une reconsidération de l'instrument dans une conception classique et une restitution des plans sonores séparés. Il ne s'agit pas de faire un plagiat du XVIIIe siècle. ...".
Les travaux, terminés en 1964, furent confiés à Alfred Kern et à Philippe Hartmann.
Le plan classique est repris. Le buffet du Positif est reconstruit
et abrite un sommier neuf commandé par le premier clavier.
La paroi de fond du Grand-Orgue est remise à sa place. A l'étage,
les deux sommiers de Grand-Orgue portent le grand plenum et les anches
fortes qui répondent au deuxième clavier.
Au dessus, au centre, le sommier de Récit porte le grand jeu de
Tierces et les anches de détail qui répondent au troisième
clavier. Le troisième clavier est à la fois complémentaire
du Grand-Orgue et de la Pédale, en reprenant l'idée de Jean-Esprit
Isnard à Saint Maximin qui a doté le sien de basses servant
de Pédale.
Au rez-de-tribune, de part et d'autre de la mécanique des claviers,
les deux sommiers de l'Echo sont enfermés dans une boite expressive
constituée par le soubassement dont les parois latérales
sont munies de jalousies.
Les sommiers de Pédale sont dans les grandes tourelles latérales,
perpendiculaires et les grands tuyaux au fond.
Tous les sommiers de Abbey ont été réutilisés
et la Pédale dotée de deux sommiers complémentaires,
neufs.
Le Plenum est à l'échelle du 16 pieds au Grand-Orgue et au 8 pieds aux claviers secondaires. Aux neuf rangs sur le plan de Dom Bedos du Grand Clavier se joignent ceux de la Cymbale-Tierce de style nordique. La fourniture de Pédale comporte aussi une Tierce.
La tuyauterie ancienne réutilisée par Abbey
a été "reclassicisée" : entailles
rebouchées et accord au ton. Pour certains aussi peut-être
dents grattées.
Les jeux d'anches ont été remaniés en les dotant
de rigoles ouvertes.
D'une façon générale, la tuyauterie a été
traitée à pieds ouverts avec une pression du vent très
modérée : 55 mm pour l'Echo, 60 mm pour les autres
claviers et le Pédalier.
La mécanique a été conçue par
Philippe Hartmann à partir de la console revenue "en fenêtre".
Elle offre la possibilité de l'accouplement de 3 claviers sans
que le jeu ne devienne impossible. Il reste même d'une souplesse
incroyable bien qu'il faille tirer des doubles soupapes dans le grave.
Les rouleaux d'abrégé sont en alliage léger et les
accouplements à "fourchettes" sont constitués
de leviers de bois dont les frottements sont réduits au minimum.
"Tenter de décrire le monde sonore de cet instrument ne serait qu'inutile verbiage; l'auditeur jugera sans idées préconçues. ... C'est dans la discipline librement consentie qu'une oeuvre d'art s'épanouit pleinement. ... Ainsi tourné vers l'avenir mais respectueux de son passé, l'art de l'Orgue a retrouvé sa nouvelle jeunesse", écrit Jean Fellot à qui j'ai emprunté l'essentiel de ce texte.
|
Positif, 56 notes
|
Grand-Orgue, 56 notes
|
Résonance, 56 notes
|
Echo, 56 notes
|
| Quintaton 8' Montre 8' Bourdon 8' Prestant 4' Flûte à cheminée 4' Nasard 2' 2/3 Doublette 2' Tierce 1' 3/5 Larigot 1' 1/3 Fourniture 1' V-VI Cromorne 8' |
Montre 16' Montre 8' Flûte conique 8' Prestant 4' Doublette 2' Fourniture 2' - V Cymbale 2/3' - IV Cymbale-tierce II Cornet V Bombarde 16' Trompette 8' Clairon 4' |
Bourdon
16' Bourdon à cheminée 8' Flûte conique 4' Grosse tierce 3' 1/5 Nasard 2' 2/3 Quarte 2' Sifflet 1' Tierce 1' 3/5 Cornet V Musette 16' Voix Humaine 8' Hautbois 4' |
Viole 8' Unda Maris 8' Bourdon 8' Principal 4' Flûte à fuseau 4' Doublette 2' Quarte 2' Sesquialtera II Cymbale 1' - V Trompette 8' Clairon 4' |
|
Pédale, 30 notes
|
Tremblant positif Tuyaux : +/- Ancien - Ancien remanié - Abbey - Neuf. |
||
| Flûte
16' Soubasse 16' Bourdon 8' Principal 8' Principal 4' Nachthorn 2' (à cheminée) Fourniture V Cymbale IV Douçaine 32' Bombarde 16' Trompette 8' Clairon 4' |
|||
Bien sûr, ce travail n'eut pas l'heur de plaire aux
Mandarins de la commission des Orgues de l'époque et, en 1967,
"une plume fort autorisée" déversa son
venin dans un article mettant en cause les "facteuraillons"
et les "amateurs" à la base de cette "restauration".
Les "Organistes de Saint Séverin" apportèrent
une réponse sur cette oeuvre apparemment mal comprise. En résumé,
nous en tirons les lignes suivantes :
"Saint Séverin n'a jamais
été un instrument historique. Parler de restauration
à propos de cet orgue, c'est vouloir fausser les données
d'un problème qui préoccupe aujourd'hui tous les
organistes ou amateurs d'orgues. Il n'y subsistait ni mécanique
ni sommiers anciens, le positif avait été vidé de
son contenu. Un certain nombre de jeux anciens avaient été
entièrement revus et corrigés par Abbey. Seuls le buffet
et la Montre pouvaient être considérés comme historiques
et il n'est qu'à l'égard de cette façade que l'on
peut parler de restauration.
Nous ne l'avons jamais caché, Saint Séverin est un instrument
neuf. Pour lui conviendrait parfaitement l'appellation de néo-classique
si celle-ci n'avait pas été, hélas, passablement
galvaudée au cours des années passées. Les concerts
que nous organisons à Saint Séverin ne sont pas bloqués
sur une esthétique unique. Toutes les écoles sont interprétées
sur cet orgue, voire des pages romantiques. La musique contemporaine y
trouve aussi fort bien sa place".
(Sauf erreur, "Volumina" de Ligeti y fut créé,
entre autres).
On était en mai 1968 !
Composition des Pleins-Jeux :
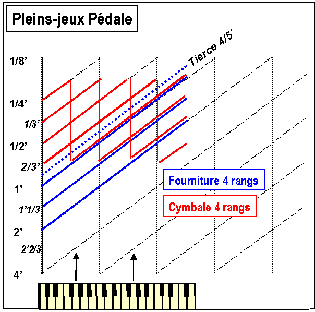
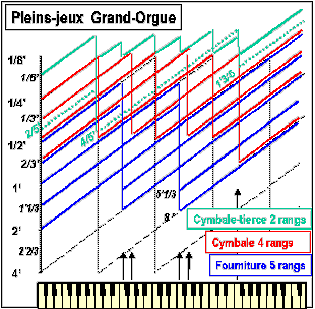
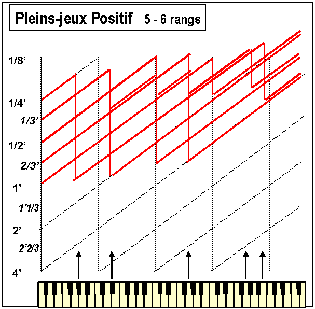
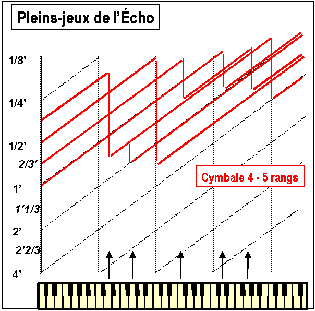
Ecouter le grand plein-jeu : Lobt Gott, ihr Christen
allsugleich - JS Bach - OrgelBuchlein - ![]()
Michel Chapuis, en mars 1964 - Harmundia Mundi, Musique de tous les temps.
- Positif : M8, P4, D2, Plein-Jeu 5-6 rangs
- G.O. : M8, P4, D2, Cymbale 4 rangs, Cymbale-tierce 2 rangs.
- Pédale : S16, Pr8, Pr2, Fourniture, Cymbale, Bombarde 16