 ABéCéDaire
de l'orgue:
ABéCéDaire
de l'orgue:
La cathédrale de Rodez renferme certainement un des plus beaux buffet d'orgue de France, avec Aire sur la Lys. Tiens ? j'aurais pu faire R comme Aire ... J'y penserai !
La cathédrale de Rodez est une véritable forteresse
dans laquelle, en cas d'invasion, la population de la ville pouvait être
abritée en sécurité. Sur le toit, plat, pouvait se tenir une garnison
et un certain nombre d'artisans. On y reconnaît une boulangerie avec son
fournil et une forge.
Souvenir d'un concert débile que j'ai occupé à tout visiter, y compris
le buffet d'orgue qui était alors vide. C'est ainsi que j'y ai vu aussi
un polyphone Debierre, au fond. Je ne sais pas s'il y est toujours.
Entrons dans la cathédrale par la porte sud en venant
de la petite place Albert Rozier, marchons quelques mètres, puis, levons
les yeux. Nous découvrons un superbe buffet renaissance d'un équilibre
parfait, s'inscrivant dans l'arc du transept nord. Cet orgue a été construit
en 1629 par Antoine Vernholes, de Poitiers, avec le concours de Raymond
Gusmond, maître sculpteur de Périgueux.
 |
Vernholes a réemployés des parties de boiseries d'un
orgue plus ancien, gothique, sur les côtés et à l'arrière. L'ensemble
de la tribune et du buffet a 63 pieds de haut et 32 pieds de large, le
tout en noyer poli.
En partie haute, des anges et des armoiries étaient rehaussées de couleurs
vives.
Jusqu'à la fin du 18e siècle le grand buffet pouvait être caché par un
rideau et le positif était équipé de volets. C'est tout ce qui nous reste
de l'orgue de Vernholes.
En 1676 Jean de Joyeuse entreprend une restauration complète. Il y introduira la mode "parisienne". Il y privilégie la finesse et l'élégance plutôt que la puissance : peu de jeux d'anches mais des plein-jeux et des jeux de tierce à tous les claviers.
En 1728 François L'Espine, de Toulouse, refait la
montre à neuf, remplace la voix humaine de l'écho par un cromorne, ajoute
un bourdon 16, une grosse tierce et un cromorne au grand orgue, remet
en état les sommiers, refait à neuf celui de "l'écho de cornet" sur 3
octaves ainsi que les 3 claviers.
Il baissera l'ensemble de l'orgue d'un demi ton, en si bémol, celui de
Jean de Joyeuse étant en si.
En 1775, J Isnard refait les sommiers du Grand orgue en 4 parties, celui du positif en 2 parties, ceux de pédale et place le cornet d'écho en récit.
En 1776 il ajoute un clavier de bombarde et porte l'étendue des claviers à 50 notes.
 |
L'orgue fut laissé à l'abandon pendant la période révolutionnaire.
En 1837 les frères Claude pavillonnent les tuyaux mais ne changent pas la composition. (Pavillonner : on allonge le tuyau afin de pouvoir pratiquer une languette que l'on roule afin de faciliter l'accord).
En 1858 Pagès effectue des travaux avec une lenteur telle que Félix Clément s'en inquiète. D'ailleurs, il meurt entre temps et c'est la maison Puget qui les achève.
L'instrument aborde le 20e siècle avec une grande majorité de tuyaux du 17e et du 18e siècle, mais la mécanique montre de grands signes de fatigue.
En 1902 le chanoine Servières parle "d'un orgue fossile".
Face à la réticence du ministère des cultes à entreprendre à nouveau des
travaux, l'évêque de Rodez prend à sa charge la réfection de l'orgue ...
par Anneessens qui pose une traction entièrement tubulaire. (Traction
pneumatique. On y reviendra). Cette intervention radicale sonne la mort
de l'instrument de Jean de Joyeuse.
Entretenue périodiquement, la traction tubulaire fonctionnera jusqu'en 1970, date à laquelle elle rendra l'âme.
En 1975 Paul Manuel démonte entièrement l'orgue et
essaie de reclasser la tuyauterie.
Le buffet vide menace ruine et doit être consolidé. Il l'a été,
mais d'une façon assez peu orthodoxe!
Finalement le tri des tuyaux s'avère assez cohérent, et on arrive à reclasser
les tuyaux restant de Vernholes et ceux de Jean de Joyeuse.
L'idée d'une restitution est agréée à la commission des orgues historiques et c'est Yves Koenig qui se chargea de ce délicat et miraculeux travail.
Composition de l'orgue restauré:
| Positif | Grand-Orgue | Récit | Echo | Pédale |
|
Montre 8' |
Montre 16' (22 dess.JJ) Bourdon 16' (41 L) Montre 8' (31 dess.JJ) Bourdon 8' (39 JJ) Prestant 4' (43 JJ) Flûte 4' (44 JJ) Grande Tierce (9 M) Nasard (20 JJ) Doublette (46 JJ) Quarte (37 18e) Tierce (11 JJ) Flageolet (25 V) Fourniture V (PJ:124 JJ) Cymbale IV 1e Trompette (34 pav.I) 2e Trompette (35 pav.JJ) Clairon (25 pav.JJ) Cornet (122 JJ) |
Cornet (39 JJ) Trompette Hautbois (34 P) |
Bourdon 8' (cornet:13 JJ) Prestant 4' Nasard Doublette Tierce Cymbale III (10 V?) Voix Humaine |
Flûte 16' |
| Accouplement à tiroir Pos./GO Tremblant doux général Tremblant doux positif Tremblant fort |
Tuyaux anciens: V: Vernholes 1629, JJ: Jean de Joyeuse 1676, L: L'Espine 1728, I: Isnard 1776, M: Micot ?, FC: Frères Claude 1839, P: Pagès 1860. |
|||
L'effet des Pleins-Jeux vient de leur composition assez particulière.Il s'agit de plein-Jeux cymbalisés sauf pour le rang grâve qui reprend en octave, non pas sur les FA mais sur les UT. Le deuxième rang, une quinte, est doublé de FA à SI sur presque toute l'étendue du clavier.
Au Grand-Orgue, la résultante de 32' apparaît à partir du 4e UT. Au Positif, c'est le 16' qui apparaît au même endroit. Cela devait, selon Jean de Joyeuse, "faire un grand effet au plein jeu du grand orgue" et " lui donner une belle harmonie au positif".
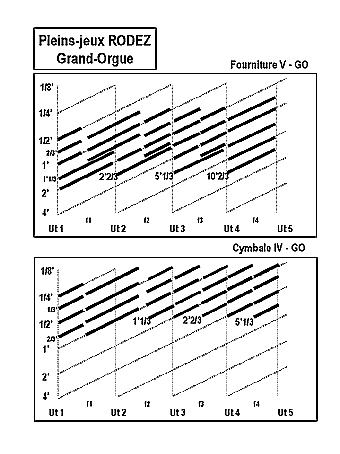
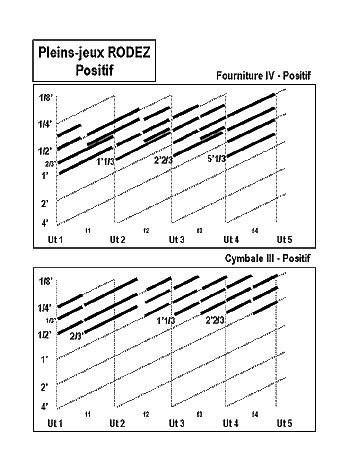
Ah ! Si on avait fait la même chose pour Auch qui,
lui, était intact !