
Traité de l'Orgue de Marin Mersenne.
PROPOSITION XXIX.
Expliquer la manière & la méthode d'accorder les Orgues tant justes que tempérées.
Pour ce sujet il faut premièrement remarquer que l'on a besoin d'une bonne oreille pour juger des consonances et reconnaître si elles sont justes. L'on ne peut tailler tous les tuyaux si justes et leur accommoder le vent si égal, et avec tant d'adresse, que tous les tuyaux se trouvent d'accord sans qu'il soit nécessaire de se servir des oreilles pour les accorder. Puisque ceci dépasse l'industrie des hommes qui ne peuvent prévoir une grande multitude de circonstances, je suppose que les oreilles sont entièrement nécessaires pour accorder les tuyaux.
Il faut remarquer que l'oreille aperçoit plus aisément l'imperfection des consonances que celle des dissonances d'autant que la perfection est plus éloignée de l'imperfection. De là vient que l'on accorde plutôt par les consonances que par les dissonances : c'est pour cette même raison que l'on choisit les plus agréables et les plus aisées à comprendre.
On commence plutôt l'accord par les touches du milieu parce que les sons du milieu de l'Orgue sont mieux proportionnés et plus conformes à la voix et à l'oreille que ceux du commencement ou de la fin qui sont trop graves ou trop aigus pour en remarquer les différences assez exactement.
L'on commence l'accord par le second C sol ut fa ou par le second F ut
fa qui servent de base ou de fondement à l'oreille. Ou d'autres
notes, au choix.
Quant aux notes, je les mets sous la clef de F ut fa afin que l'on comprenne
mieux la suite de l'accord. Parce que les octaves doivent être justes
et les quintes faibles, j'use de deux caractères pour montrer de
quel côté de tient la faiblesse et la justesse. Le premier
est une virgule courbée en haut (qui ressemble
à un c couché sur le dos) car elle est déjà
en usage pour signifier les syllabes brèves et peut semblablement
être appliquée aux intervalles faibles et diminués.
Cet autre caractère - qui consiste en une ligne droite et qui signifie
les syllabes longues montrera les intervalles justes. On peut ajouter
encore le caractère fait de deux lignes droites fait en forme de
V à l'envers pour signifier les intervalles qui sont forts, par
exemple les quartes qui sont toujours d'autant plus fortes que les quintes
sont faibles.
La première ligne des notes montre l'accord des principales touches,
que l'on appelle diatoniques. La seconde fait voir l'accord des autres
touches, que l'on appelle feintes, ou chromatiques, parce qu'elles font
les demi tons dans tous les endroits du clavier, en divisant chaque ton
en deux parties.
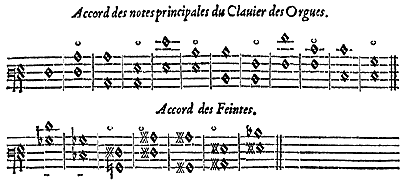
Premièrement il faut faire la première quinte depuis F
ut fa jusqu'à G ré sol en haut dont on prend après
l'octave en bas de sorte que l'on accorde trois tuyaux en même temps
et d'une même main. (L'auteur a voulu dire qu'on
va du F au C, et non G puisqu'on va continuer sur cette note).
En second lieu on fait la quinte depuis le C sol ut fa d'en bas jusqu'au
G ré sol aigu, duquel on prend l'octave en haut avec l'autre main,
et puis on la divise en Fa quinte et en Fa quarte en accordant D la ré
sol à la quinte du premier G ré sol.
En troisième lieu on prend l'octave en bas dudit D la ré
sol avec lequel on accorde A mi la ré à la quinte en haut.
Puis on prend son octave en haut que l'on divise après en faisant
la quinte en E mi la, dont on prend l'octave en bas.
Finalement on accorde le B carre mi à la quinte dudit E mi la de
sorte que l'on a toutes les touches qui suivent toutes l'accord C, D,
E, F, G, A, B carre, C, D, E, F, G, A, c'est à dire une neuvième
comprise par la première ligne des notes.
Quant à la seconde ligne qui contient les feintes, la première
quinte commence en B mol fa et a sa quinte en haut dans le fa d' F fa
ut. Le signe de dessous montre qu'il faut tenir la note de dessous un
peu forte, aussi bien que la seconde quinte qui suit et qui fait la quinte
avec ladite note de la quinte précédente.
La troisième quinte commence en B carre mi et finit sur la quinte
de F ut, laquelle fait la quatrième quinte avec la quinte de C
sol ut fa qui a son octave en bas sur la quinte de B carre mi.
La cinquième quinte commence sur la feinte d' A mi la ré
et finit sur celle de G ré sol ut. Cette dernière n'a pas
sa quinte en haut, c'est pourquoi les Epinettiers appellent le défaut
de la corde parce que la feinte de D la ré sol n'a point de quinte
en bas. De là vient que quelques uns la coupent en deux afin de
trouver la quinte en cet endroit, auquel on rejette l'imperfection du
tempérament.
Nota : Cette description du tempérament mésotonique
à huit tierces pures est assez ambiguê et mérite qu'on
y apporte les précisions nécessaires. Soulignons l'erreur
sur la dernière quinte qui n'est pas sol# - sol mais sol# (la feinte
d' A mi la ré) - mib (la feinte de D la ré sol), ce que
l'on comprend d'ailleurs à la ligne suivante. En effet c'est bien
la quinte du loup.
Par contre, on peut comprendre que les quintes en descendant fa - sib
et sib - mib soient "fortes". Il n'en n'est rien et le texte
est clair: c'est la note du dessous qui est forte, c'est à dire
un peu haute. Donc ces quintes sont petites, comme les autres (-1/4 de
comma). Ceci est d'ailleurs confirmé à la proposition 37
: "Et pour les deux qui restent, il faut prendre f et descendre en
b mol, et de b mol descendre en #e. Il faut que #e soit un peu plus haut
que la justesse car l'on aura par ce moyen toutes les consonances requises,
à savoir les tierces et les sixtes tant majeures que mineures".
On peut représenter cet accord dans une seule ligne afin de montrer
comme l'on accorde en faisant toujours deux accords qui comprennent trois
cordes comme l'on voit ici.
|
Accord
des trois premieres octaves du clavier d'Orgues.
|
|
| C D # E F # G # A A# Bcarre C # D # E F # G # A # Bcarre C # D # E F # G # A # Bcarre C |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
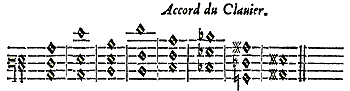
Dans la manière 2 dont on use pour accorder, on prend C sol ut
fa pour fondement, mais je veux expliquer la méthode sans notes
afin que ceux qui n'en savent pas la valeur puissent comprendre l'accord.
Pour ce sujet je mets les lettres de la main harmonique depuis le premier
C sol ut fa qui est sur la première marche, jusques à la
troisième octave (que fait le premier C sol ut fa avec le premier)
et les nombres vis à vis de chaque lettre et de chaque feinte,
afin que le discours en soit plus court et plus intelligible.
Il faut toujours remarquer que l'on peut commencer par telle marche que
l'on veut, aussi bien par le C sol ut fa que par le F fa ut.
On fait premièrement l'octave de 12 à 24 , puis la quinte
de 12 à 19. (C2 à C3 et C2 à G2)
Secondement l'octave de 19 à 31 puis la quinte de 19 à 26.
(G2 à G3 et G2 à D3)
En troisième lieu on fait l'octave de 26 à 14 et la quinte
de 14 à 21. (D3 à D2 et D2 à A2)
En quatrième lieu on prend l'octave de 21 à 33 et la quinte
de 21 à 28. (A2 à A3 et A2 à E3)
En cinquième lieu on fait l'octave de 28 à 16 et la quinte
de 16 à 25. (E3 à E2 et E2 à C#3)
En sixième lieu on prend l'octave de 25 à 13 et de 13 à
20 la quinte. (C#3 à C#2 et C#2 à G#2)
En septième lieu on fait l'octave de 20 à 8 et la quinte
de 8 à 15. (G#2 à G#1 et G#1 à
D#2)
En huitième lieu on prend l'octave de 15 à 27 et la quinte
de 15 à 22. (D#2 à D#3 et D#2 à
A#2)
En neuvième lieu on prend l'octave de 22 à 10 et la quinte
de 10 à 17. (A#2 à A#1 et A#1 à
F2)
L'on fait enfin l'octave de 17 à 5. (F2 à F1)M
mais les Facteurs et les Organistes ont l'habitude de faire les tierces
après les quintes de cette manière.
Après avoir fait l'octave de 12 à 24 (C2 - C3) et
la quinte de 12 à 19 (C2 - G2) comme j'ai dit, ils font
la tierce majeure de 12 à 19 (je pense qu'il
a voulu dire ; de 12 à 16) (C2 - E2) et conséquemment
la mineure de 16 à 19 (E2 - G2).
Et puis une autre tierce majeure de 19 à 23 (G2 - Bcarre2)
et la mineure de 19 à 22 (G2 - A#2) .
Et puis après avoir fait la quinte de 22 à 29 (A#2 -
F3), ils font la tierce majeure de 22 à 26 (A#2 - D3)
et la mineure de 22 à 25 (A#2 - C#3) , puis de 25 à
29 (C#3 - F3) ils font encore la majeure.
Et puis ils font la tierce majeure de 17 à 21 (F2 - A2)
et la mineure de 21 à 24 (A2 - C3).
Finalement ils font la majeure de 18 à 25 (F#2 - C#3) et
de 23 à 17 (Bcarre2 - F2).
L'on accorde tout d'un coup et d'une même main 12, 16, 19, et 24,
ou 12, 15, 19, et 24, ou 12, 17, 20, et 24, etc.
Mais il faut avoir une meilleure oreille pour accorder par tierces que
par quintes.
Je laisse les autres manières que l'on peut s'imaginer par les tons et les demi tons, afin d'expliquer que l'on peut apercevoir si les quintes sont bien tempérées dans l'accord, c'est à dire si elles sont assez affaiblies, car, comme j'ai montré ailleurs qu'il faut les affaiblir d' 1/4 de comma, néanmoins il est difficile d'apercevoir cette diminution à raison qu'elle dépend d'une bonne oreille dont plusieurs sont privés.