 UNE
HISTOIRE DU PLEIN-JEU
UNE
HISTOIRE DU PLEIN-JEU
II. LE RIPIENO
Dès le début du XIVe siècle apparaît dans de
petits instruments un type d'orgue mécaniquement très
nouveau. Les répercussions sur le Plenum seront importantes.
C'est encore Arnaut de Zwolle qui nous en décrit un exemple
assez précisément: "simplicia principalia in duo
divisa et quelibet principalis duas quintas et unam octavam habet, et
sunt ibi quinque registra ut tu scis".
Pour les Principaux, il peut s'agir de 2 Principaux normaux sur
un clavier sans ravalement (tel est le sens de simplicia chez Arnaut
pour un autre orgue) et la nouveauté est que ces deux rangs sont
séparables (divisa), chacun ayant son registre.
Les autres registres sont deux Quintes (2' 2/3, 1' 1/3 et une Octave (2').
Cet orgue a donc un petit plenum 4' régulier à V rangs sans
doublures. Il sonne en 8' grâce à sa Quinte 2' 2/3.
Ces V rangs sont disposés en jeux, grâce à
un type nouveau de sommier, probablement à glissières, d'où
le nom de registres (ou tirants) issu du réjectoire qui
désignait, dès l'orgue de Théophile, les ressorts
de rappel des glissières de note, puis dans le Blockwerk,
les ressorts de soupape de note.
Nous ne retrouvons
ce type d'orgue que cinquante ans plus tard, transplanté en Italie
par des Allemands du Sud et trouvant là sa patrie en quelque sorte
définitive. Devenu orgue fixe d'église, il a seulement,
incorporé à son clavier les Bourdons formant l'octave
grave et un 8' réel, ce qui rend moins utile et peut faire disparaître
la Quinte 2' 2/3.
L'apparition des rangs de 1' 1/3 et 1' a posé un problème
aux constructeurs : les dessus dépassent ce qui était considéré
comme la limite des sons agréables (environ le 1/6'). Aussi déjà
la 19e (1' 1/3) reprend-elle en 12e à l'Ut 4, et la 22e (1') en
15e dès Sol 3, avec obligation de sauter encore (en 4') si le clavier
dépasse Sol ou La 4.
Le dernier rang sans reprise du clavier normal (le 2') restera-t-il toujours
sans sauter, même au-delà de La 4?. Apparaissent alors sur
ce rang des tuyaux plus courts que la règle : 1/12' avec Antegnati
(1626), 1/16' avec Serassi (XIXe) à la limite de l'audible.
 Les
rangs à reprises se multiplient: en 1495 à Lucques,
Saint-Pierre, orgue de 8'. On a la 26e (2/3' à reprise sur
Ut3 et 4).
Les
rangs à reprises se multiplient: en 1495 à Lucques,
Saint-Pierre, orgue de 8'. On a la 26e (2/3' à reprise sur
Ut3 et 4).
A Rome, Sainte-Marie-de-la-Paix, Léonard ajoute une 33e
(2/3' d'un orgue de 16') et une 36e (1/2') qui est en fait une doublure
de la 29e (1').
On trouvera plus tard la 40e et la 43e qui sont en fait des doublures
de 33e ou 29e par une sorte de fiction, comme si ces rangs avaient repris
avant même l'Ut3, du clavier.
Un tel schéma ne peut être augmenté sans changer de
nature, d'où la remarquable fixité de ce type de Plenum,
appelé Ripieno. La seule variété réside
dans la progression des plafonds (1/6' à 1/16') variable selon
les rangs, ce qui permet, par exemple, de maintenir les plus nombreuses
doublures dans la zone de la meilleure audition (un peu en dessous du
plafond, vers 1/3', 1/4' le plus souvent) et de les doser.
La richesse de registration intérieure d'un tel Plenum réside
dans la liberté pour l'organiste de construire la pyramide harmonique
à son gré: mélanges incomplets, mélanges creux.
Elle impose une facture particulière : tuyaux assez pauvres en
harmoniques par eux-mêmes, tous de même type et sur les mêmes
tailles. D'où rapidement l'éviction hors du Plenum du 2e
Principal, appelé alors Flûte, à cause
de sa taille plus large. On le réserve alors aux emplois de mutation.
Comme d'autres jeux annexes, il semble que ce soit la doublure du 1er
Principal (commençant à l'Ut 2) qui soit à l'origine
(difficulté d'accord des unissons) du Fifaro bientôt
appelé Vox humana, jeu ondulant caractéristique de
la facture italienne. Il va sans dire qu'ainsi harmonisé et isolé,
ce rang de Principal est exclu lui aussi du Ripieno.

![]() Ecouter le Ripieno de S. Guiseppe de Brescia, toccata N°2 du 2e livre
de Frescobaldi.(400 Ko)
Ecouter le Ripieno de S. Guiseppe de Brescia, toccata N°2 du 2e livre
de Frescobaldi.(400 Ko)
Ce type d'orgue, on le retrouve naturellement à Avignon:
SaintSymphorien, 1539, par J. Affin (5 registres sive tirans) et
à Aix: Saint-Sauveur, 1513, par P. Perrini, Italien.
A Montpellier: Notre-Dame-des-Tables, 1504, par J. Torrian de
Venise. Mais aussi dans le sud-ouest de la France, spécialement
à Bordeaux dès avant 1510.
Il semble qu'il ne soit pas venu là directement d'Italie mais,
d'après l'origine des facteurs qui le construisent (Gaudet,
Cormier), des bords de la Loire où vit la Cour. On pourrait
penser à l'héritage direct de la cour de Bourgogne du siècle
précédent. Il n'en n'est probablement rien. La mode est
alors à l'Italie.
Les orgues construits à Bordeaux par des facteurs des bords de
Loire sont bien du type italien.
Celui de Saint-Michel (Louis Gaudet, 1510) est maintenant précisément
connu :
Principal 16', Principal 8', Flûte 8', Octave 4', 2' 2/3, 2',
1'1/3, 1', 4/5' ou 2/3'.
Gaudet a indiqué à l'organiste comment se servir
de ces ressources, comment registrer:
La Flûte seule est dite Flûte à 9 trous (Flûte
à bec),
avec le Principal 8' : Chantres,
avec l'Octave : Papegai (perroquet, peut-être nom d'une serinette),
avec la 15e : Flûte allemande (traversière),
avec la 19e (ou la 26e) : Cymbale (les fameuses clochettes médiévales),
avec la 22e : Fifres,
avec la 24e (4/5') ou 26e et la 19e : Cornets-Hautbois ou dans
le grave Sacqueboutte (Trombone).
Nous rappelons ces registrations parce que, devenues traditionnelles et
utilisées sur des orgues de type différents, elles ne seront
pas sans influence (Cymbale et Cornet en particulier) sur
les synthèses et les Plenums postérieurs.
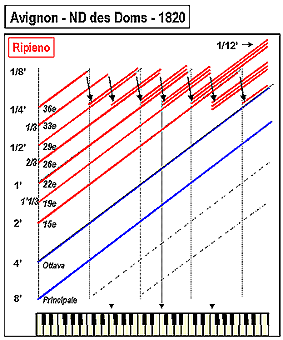
 A
titre d'exemple sur le graphique, le Ripieno de l'orgue Piantanida
de Notre-Dame d'Avignon. Bien que de 1820, (1832 pour le buffet) cet
orgue est un fidèle représentant de la facture Italienne
ancienne.
A
titre d'exemple sur le graphique, le Ripieno de l'orgue Piantanida
de Notre-Dame d'Avignon. Bien que de 1820, (1832 pour le buffet) cet
orgue est un fidèle représentant de la facture Italienne
ancienne.
C'est parce que le clavier monte au FA5 que le plafond du 1/8e de pied
est "crevé". A l'origine, les claviers d'orgue s'arrêtaient
au SI4, UT5 ou RE5. D'ailleurs, ici, la 15e (Doublette) reprend en 4'
sur UT5, mais pas les recoupes des autres jeux plus aigus. On n'a plus
un "Plein-Jeu progressif" mais l'esprit médiéval
des recoupes subsiste.