 ABéCéDaire
de l'orgue
ABéCéDaire
de l'orgueP comme PARIS
Saint Gervais
L'orgue des Couperin
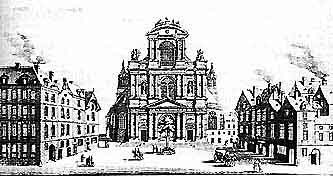
La
première église Saint Gervais & Saint Protais
a été bâtie à l'époque Mérovingienne.
Située entre la place de Grève et la Maison aux Piliers
(l'hôtel de ville), les ports marchands et le quartier du Marais,
ce premier lieu de culte de la rive droite est dédié à
deux jumeaux martyrisés sous Néron parce qu'ils s'étaient
insurgés contre le pouvoir impérial. Les Parisiens qui voyaient
périodiquement les barbares piller la rive droite de la Seine se
sont mis sous leur protection*.
* Pour ma part, je pense que les fortifications de Philippe-Auguste
ont été plus efficaces.
Du 11e au 15e siècle
Saint Gervais devient le siège de puissantes confréries
de marchands, telle que celle des « marchands et vendeurs de vin
». Du 13e au 15e siècle, celles-ci font reconstruire l'église
devenue trop petite.
De la fin du 15e au début du 17e siècle il faudra à
nouveau l'agrandir. L'édifice actuel a été construit
en 130 ans, de 1494 à 1620, période qui conserve jusqu'à
l'achèvement le plan gothique et le style flamboyant choisi au
15e siècle. En juillet 1616, Louis XIII posa la première pierre
de la façade de style classique où les trois ordres antiques se superposent
: dorique, ionique et corinthien au dernier étage.
Alors qu'éclosent la Renaissance et les lendemains du concile de Trente, Saint Gervais est le foyer spirituel d'un renouveau théologique et de son expression artistique au service de la prière : Guillaume Budé, Philippe de Champaigne, la dynastie des Couperin dont les membres se succèdent à l'orgue depuis le 17e siècle jusqu'en 1830.
L'étude
qui suit est compilée d'après celle de Pierre Hardouin
« Le Grand Orgue de Saint Gervais à Paris »
N° spécial de la revue de l'AFSOA - « Connaissance de
l'Orgue » - 1975
Le premier orgue de Saint Gervais fut donné par plusieurs frères de la confrérie des marchands de vin en 1397. Orgue dont le fonctionnement est toujours attesté en 1414.
C'est seulement près d'un siècle plus tard que la paroisse achète un orgue, celui du prieuré Sainte-Catherine du Val des Écoliers qui datait de 1421. Ces orgues comportaient une mitre encadrée de deux tourelles et, considérées comme trop petites, elles ont été vendues à la paroisse Saint Gervais peu avant 1513.
En 1545, un marché de reconstruction d'un orgue en remployant du matériel antérieur est passé avec un certain Hébart. Le facteur abandonna sa tâche qui fut reprise par Antoine Dargillières qui devait faire le fût de neuf et la soufflerie incorporée afin que l'orgue fut déplaçable. Il devait s'agir de l'orgue primitif, transformé pour être transportable, et non de l'instrument de Sainte Catherine qui, lui, a du être agrandi vers 1560 pour 400 livres.
Pendant ce temps, la reconstruction
de la nouvelle église avançait.
En 1596 les premiers fonds disponibles furent réservés au
renouvellement des ornements, puis du mobilier. C'est donc probablement
vers 1600 que fut commandé un orgue neuf.
La Fabrique de Saint Gervais profita du passage de Mathieu Langhedul*,
le fils même de Jean, qui revenait d'Espagne vers sa Flandre natale,
pour commander son orgue définitif, quitte à le disposer
sur un emplacement provisoire, l'édifice n'étant pas encore
achevé.
* Le marché est perdu mais la signature de «
Langhedul 1601 » est toujours portée sur les petits tuyaux
de la Montre de 16 et du Bourdon de 8 du Grand-Orgue.
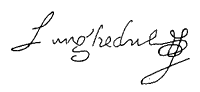
L'orgue de Mathieu Langhedul
L'instrument fut
placé dans le transept sud sur la haute tribune qui y est encore.
Le buffet avec des pilastres cannelés délimitant 3 tourelles
presqu'égales en hauteur, celles des côtés moins hautes
qu'aujourd'hui, la Montre ne dépassant pas le 12 pieds. La Montre
du positif décorait le soubassement.
Les deux claviers de 45 touches, de UT1 à UT5 avec octave courte,
étaient sur la face arrière et commandaient deux abrégés
distincts.
| Positif | Grand-Orgue | Pédale (9 notes ?) |
| Bourdon 8 Montre 4 Doublette Fourniture III Cymbale III Flageolet 1 Cromorne |
Montre 16 (du Fa1) 8' ouvert Bourdon 8 Prestant Doublette Fourniture (?) Cymbale III Flûte 4 Nasard Flûte à 9 trous 2' Flageolet 1 Cornet V (25n) Trompette Clairon |
1e octave en tirasse Flûte 8' (?) |
Tremblant fort. Pas d'accouplement des claviers.
Le Cornet, dit « Cornet de Flandre », et le Cromorne étaient alors deux jeux typiquement flamands.
Langhedul ayant regagné la Flandre, l'entretien de l'orgue est confié à Paul Maillard.
 L'orgue
de Louis Couperin
L'orgue
de Louis Couperin
La construction de l'église
s'achevait.
En 1628 la tribune au revers de la grande façade ouest était
achevée. Aussitôt marché fut passé pour le
transfert de l'orgue. Maillard parti pour Angers, les Marguilliers firent
appel à Pierre Pescheur, son ami et élève.
Le travail ne fut pas qu'un simple transfert. La tribune permettait une
disposition plus normale, ce qui entraîna une réfection complète
de la mécanique. Le Positif devint dorsal et la fenêtre des
claviers s'ouvrit par devant.
L'organiste Robert Buisson en profita pour obtenir la correction
de quelques insuffisances, comme l'octave courte. Les nouveaux claviers
accédèrent à 48 notes, noires comme l'exigeait la
mode, et purent être accouplés, ce que nécessitait
la pratique Française pour laquelle la fourniture du Positif faisait
partie intégrante du Plenum.
Le volume de l'église
avait presque doublé, nécessitant un renforcement général.
Ce qui fut obtenu par :
- augmentation de la pression en ajoutant 20 livres par soufflet,
- ravalement de la Montre de 12' en 16' avec des tuyaux en bois
placés à l'intérieur du buffet,
- remplacement du Nasard et de la Cymbale III pour renforcer
le Plenum,
- ajout d'une Tierce « à mettre dans le Plein-Jeu
» en remplacement du Flageolet 1',
- remplacement des résonateurs en fer blanc des tuyaux d'anches
par de l'étain.
Pescheur a également
posé un demi clavier de Récit résultant d'une double
alimentation du Cornet de Grand-Orgue au moyen de petites soupapes
et ajouta une Tierce large à côté de la Tierce
étroite en retaillant la Flûte de 2'.
Il aurait également complété la Pédale à
24 ou 28 notes avec la première octave complète (sauf l'Ut#)
et ajout d'une Flûte de 8 en plomb, métal que n'utilisait
pas Langhedul. (C'est pour ça qu'on ignore si Langhedul en avait
posé une).
A la succession de Buisson
par son propre fils Robert (lui aussi) en 1649 à la tribune,
il y eut visite de l'orgue et prise de décision d'un relevage.
Les travaux furent confiés à Pierre Thierry qui remplaça
le dessus de Flûte de 8 de Pédale en plomb par des
tuyaux de bois et ajouta une Flûte de 4'.
Le fils Buisson en profita peu.
La diminution des gages imposée au successeur afin de verser une rente viagère au frère de Buisson qui, faible d'esprit, ne pouvait accéder à la succession, convint au jeune Louis Couperin qui s'en contenta et qui fut retenu en 1653.
En 1659, désirant faire
évoluer son instrument dans le style alors à la mode, Louis
Couperin obtint le complément du Positif qui n'avait pas de jeu
de Tierce:
- échange du Bourdon Flamand trop étroit, ce dernier
étant recoupé en Flûte de 4'.
- Ajout d'un Nasard et d'une Tierce neufs.
Il fit ajouter un Écho destiné à servir de 3e plan
sonore, sorte de positif interne comme on en a toujours l'exemple à
Aubervilliers, avec fonds, plenum, jeu de tierce et anche: Bourdon,
Prestant, Doublette, Cymbale III, Nasard, Tierce, Cromorne, le tout
sur 3 octaves complètes.
Positif et pédale furent complétés d'un La grave
(A0) joué sur le premier UT#.
Plus rare encore, ajout d'une tirasse mobile
Louis Couperin non plus ne
profita guère des ces modifications puisqu'il mourut prématurément
en 1661. L'orgue passa aux mains de son cadet, Charles, qui vivait
avec lui et qui garda logement et traitement toujours amputé des
67 livres en faveur de Pierre Buisson à l'esprit un peu perturbé.
L'innocent* vivra encore longtemps.
* En Provence, on dirait « le ravi » !
L'orgue de François Couperin.
Ce n'est que vers la fin de
sa vie que Charles Couperin dût recourir à un facteur
pour effectuer un relevage. Ce ne fut pas Pierre Thierry mais son fils
Alexandre Thierry, plus célèbre encore que son père.
Le marché fut passé le 21 février 1676. On y dit
l'orgue fort fatigué mais la composition n'a guère à
être retouchée. Seulement la pose d'un Cornet de Récit
indépendant, harmonisé en vue de son usage en soliste, la
double alimentation du Cornet du Grand-Orgue ne suffisant plus.
En 1678, à la mort de Charles Couperin, l'intérim est confié à Michel Richard Delalande à charge pour lui de ne laisser jouer quiconque d'autre « de crainte de la gâter ». L'orgue était donc en état et il n'a certainement pas demandé de travaux jusqu'à ce qu'il laisse l'orgue à François Couperin lors de ses 18 ans.
En fait, compte tenu de la
confiance qui régnait entre le facteur et la Fabrique, des travaux
successifs et plus conséquents ont été réalisés.
On n'en n'a pas la preuve mais les doutes ne sont pas permis, au vu des
registrations indiquées par François Couperin pour l'interprétation
de sa « Messe des Paroisses ».
La pose d'un cornet de Récit indépendant a dû
nécessiter un sommier à gravures intercalées, ce
qu'atteste par la suite la réfection du châssis d'abrégé
et la pose d'une Trompette de Récit après avoir libéré
une chape du GO, en 1714. De plus, il est fait état d'un LA grave
joué sur l'UT# au Grand-Orgue alors qu'il n'existait qu'au Positif
et à la Pédale. En toute vraisemblance Alexandre a aussi
augmenté le GO d'un Bourdon de 16' et il est alors difficile
d'admettre qu'il n'ait pas refait le grand sommier.
En 1714 on a donc un orgue ainsi constitué depuis au moins 1685, date de la « messe des paroisses »:
| Positif 49 notes, La-Ut-Ré à Ut |
Grand-Orgue (id) | Récit 25 notes Ut à Ut |
Écho 37 notes, Ut à Ut |
Pédale 29 notes La-Ut-Ré à Mi |
| Bourdon 8' Montre 4' Doublette Fourniture Cymbale Nasard Tierce Larigot Cromorne |
Montre 16' Bourdon 16' Montre 8' Bourdon 8' Prestant Doublette Fourniture Cymbale Flûte 4' Nasard Tierce Quarte Cornet V Trompette Clairon Voix Humaine |
Cornet V Trompette (en 1714) |
Bourdon Prestant Nasard Doublette Tierce Cymbale III Cromorne |
Flûte 8' Flûte 4' Trompette |
 Les
jeux en gras sont nommément cités par Couperin mais
les registrations telles que : fond d'orgue, petit et grand plein-jeu,
jeux d'anches, grand-jeu, plein-jeu en taille, supposent à
peu près tous les autres à l'exception de l'Écho.
Couperin semble répugner à son usage si goûté
auparavant et l'on ne s'étonnera pas qu'en 1714 il en supprime
toute l'octave grave afin de faciliter le réglage de la mécanique
des autres sommiers.
Les
jeux en gras sont nommément cités par Couperin mais
les registrations telles que : fond d'orgue, petit et grand plein-jeu,
jeux d'anches, grand-jeu, plein-jeu en taille, supposent à
peu près tous les autres à l'exception de l'Écho.
Couperin semble répugner à son usage si goûté
auparavant et l'on ne s'étonnera pas qu'en 1714 il en supprime
toute l'octave grave afin de faciliter le réglage de la mécanique
des autres sommiers.
Après la mort d'Alexandre Thierry l'entretien a été confié à Pierre-François Deslandes qui, à son tour, mourut en 1709. L'entretien fut alors confié à François Thierry, neveu d'Alexandre.
Pour le relevage de 1714 Couperin attache beaucoup d'importance au toucher qu'il veut « libre et prompt ». Pour faciliter l'entretien de la mécanique, l'Écho perd son octave grave avec ses postages encombrants. Seule addition au plan, une trompette de Récit pour laquelle on sacrifie la Flûte de 4' du GO.
Bien que nous n'ayons pas
de musique d'orgue de François Couperin après ses deux messes
de jeune homme, il tînt avec gloire les claviers de Saint Gervais
jusqu'en 1723 faisant accourir les disciples au pied de la tribune d'un
orgue considéré comme « un des meilleurs du royaume
». Lassé par les conditions financières de sa charge,
il fit recevoir comme survivancier son cousin Nicolas afin qu'il
le remplace en temps ordinaires.
A sa mort, Nicolas devint titulaire en 1733 et à son tour, Armand-Louis
lui succéda normalement en 1748.
A 21 ans, Armand-Louis était déjà un virtuose connu
et l'orgue de Couperin-Le-Grand cessa tôt de le satisfaire à
cause de son usure certaine après 35 ans de service. Mais surtout
par suite de l'évolution du goût, la mode ayant remis en
cause le bel équilibre classique.
L'orgue d'Armand-Louis Couperin.
Le jeune organiste mit cependant
dix ans à obtenir la grande réfection souhaitée.
Il avait vu François Thierry mourir dès 1749 et l'entretien
était passé à un modeste ouvrier, Louis Bessart.
Dans les derniers mois de 1757 lui furent commandés les grands
travaux de réfection dont la direction était confiée
à Mouchet, architecte de la Fabrique. Ce dernier fut certainement
l'auteur des plans et des dessins d'un buffet nouveau de par ses dimensions
et le style.
Pour satisfaire l'organiste et sa femme, Élisabeth Blanchet
(les clavecins...) également organiste, le plan de l'orgue fut
modifié pour abriter deux Bombardes et une pédale
à deux seize pieds ainsi que pour descendre le diapason d'un demi
ton. En effet, Alexandre Thierry l'avait remonté au « ton
de cour » en coupant les tuyaux (sauf le Nasard conique qu'il
déplaça), peut-être moins pour adopter à Saint
Gervais le diapason qu'on lui avait demandé d'appliquer à
tous les orgues royaux (voir Versailles)
que pour grossir les tailles trop fines (pour le goût Français)
des tuyaux de facture flamande.
Ainsi les messes de Couperin ont toutes
les chances d'avoir été composées sur un orgue en
Si Bécarre et non en Si Bémol.
La nécessité de modifier toutes les charpentes donnait l'occasion
de mettre la décoration au goût du jour.
Il fallait agrandir le buffet en hauteur pour abriter une Montre de 16
pieds réelle et les nouveaux sommiers à double gravure qui
exigeaient plus de largeur et de profondeur. Force était de refaire
la carcasse en utilisant au mieux les vieux bois. Les pilastres cannelés
furent déplacés, retournés et certains prolongés
pour encadrer la nouvelle Montre. Le menuisier Pierre-Claude Thiessé
sous-traita la partie sculptée en la confiant à Jacques
François Fichon, sculpteur du buffet de Saint Séverin.
La modestie du prix à lui alloué explique le peu de recherche
dans l'exécution et que ce grand corps harmonieux dans ses proportions
ne vaille guère par les détails. De plus un badigeon général
couleur noyer, afin d'uniformiser les parties anciennes et neuves, vira
assez vite à la couleur chocolat.
 Dès
le début de 1758 le grand orgue avait donc été démonté
et le service était assuré sur le seul positif.
Dès
le début de 1758 le grand orgue avait donc été démonté
et le service était assuré sur le seul positif.
L'année suivante l'architecte Mouchet s'occupa du petit buffet
qui n'avait pas à être démonté car il s'agissait
d'un nouveau meuble. Ce n'est qu'en 1763 que l'échange eut lieu.
Là, au contraire, le prix élevé est expliqué
par la richesse et la qualité des sculptures de Charles Rebillé.
Bessart avait certainement préparé tout ce qui devait être
neuf dans ce positif quand survint sa mort en 1764. Sa veuve n'étant
pas en état de faire assurer l'entretien par un ouvrier selon la
coutume corporative, ce fut à François-Henri Clicquot
que cette charge échoua.
Les travaux achevé par Bessart consistaient en la réfection de toute la partie mécanique y compris les sommiers, que le nouveau plan forçait à faire de neuf, « modernes »: 51 notes de ut à ré avec Ut# grave aux cinq claviers manuels, blancs; double gravure pour une Bombarde à main, et sans doute quelques jeux plus ou moins préparés. Le successeur de Bessart sera chargé d'achever le même programme.
D'après la tuyauterie, on peut faire remonter à Bessart la réfection complète du positif en raison du remploi maximum du matériel ancien, bien au delà de ce que fait Clicquot en général. 37 gravures chromatiques et 7 basses diatoniques de chaque côté, 11 chapes.
Puis les travaux suivirent leur cours sans hâte et Clicquot n'annonça leur achèvement que le 17 avril 1768. Non satisfait de certains remplois prévus, Clicquot avait envisagé de fournir de neuf « 6 rangées de tuyaux et un Hautbois de Récit ». D'après l'état actuel, nous essaierons d'identifier, en rouge, les « 6 rangées (+ le Hautbois) ».
Derrière la tourelle centrale avec abrégé propre, un Récit de 32 notes avec le Hautbois de Clicquot sur la chape prévue pour la trompette.
Dans le soubassement un Écho sur un sommier neuf à 27 notes et 3 chapes.
Mystère à la Pédale qui comporte 32 gravures pour 28 notes, 4 gravures à l'aigu ne sont par percées et les basses sont du côté de la nef de l'église.
| Positif | Grand-Orgue | Bombarde | Récit | Écho |
| Montre 8' Bourdon 8' Prestant Nasard Doublette petit jeu (flûte de 4'?) Tierce Larigot Plein-Jeu VI Trompette Cromorne. |
Grand Cornet V Montre 16' Bourdon 16' Dessus de Flûte 8' Montre 8' Bourdon 8' Prestant Nasard Doublette Quarte Tierce Grosse Fourniture II Fourniture III (1') Cymbale IV (1/2') Trompette Clairon Voix Humaine |
Bombarde |
Cornet V Hautbois |
Flûte 8' Trompette |
A la pédale,
sur 25 notes, un Bourdon de 16' neuf
est posté à l'extérieur pour les basses, une Flûte
8' de remploi, une Flûte 4' de remploi.
Sur 28 notes, de La0 à Ut3, des anches neuves de Clicquot: Bombarde,
Trompette et Clairon.
A la réception Daquin et Balbastre se plaignirent de la mauvaise qualité du vieux Cromorne et le facteur se hâta d'en fournir un neuf.
Somme toute l'intervention de Clicquot a été beaucoup moins radicale que dans bien d'autres instruments.
Par la suite de petites mises
au point ont dû être faites et une seule divergence avec le
relevé du Citoyen Molard en l'an III nous laisse à
penser que la Flûte de 4' du positif a été
remplacée par un Clairon,
Armand-Louis Couperin mourut
le 2 février 1789 suivi de peu par son aîné Pierre,
survivancier et fréquent remplaçant depuis 1773. Leur succéda
le cadet Gervais-François Couperin.
Puis l'église fut fermée en mars 1793, rouverte au culte
de la Raison, puis rendue au culte Catholique le 19 juin 1795. L'orgue
avait failli être vendu.
Lorsque que le 2 fructidor an III Molard passe avec ses experts
organistes et facteurs, l'orgue est considéré « en
bon état » et n'a besoin que d'un « repassage
sur place ».
Le service continua, l'entretien fut assuré par Dallery
en raison des absences fréquentes de Clicquot fils, puis de sa
mort en 1801.
L'orgue
de Gervais-François Couperin.
En 1811 on demanda à
Pierre-François Dallery le relevage qui s'imposait. D'accord
avec Couperin, le facteur dressa un sombre tableau de l'état de
l'orgue afin d'inciter la Fabrique à ne pas lésiner.
Au relevage normal, le devis ajoutait « qu'il convenait de supprimer
des tuyaux reconnus inutiles comme la Fourniture et la Cymbale (du
GO), le Larigot et la Cymbale (nom unique pour le Plein-Jeu)
du positif ».
Ces disparitions sont présentées comme un progrès.
Ensuite apparaissent les désirs d'augmentation de Gervais-François
qui demande au Grand-Orgue une deuxième Trompette
(qui deviendra la « première » parce que plus grassouillette
que l'autre) et au positif une deuxième Flûte, une
Clarinette et un Basson. La Flûte sera les
basses, manchonnées, du Larigot , la Clarinette sera
issue d'un Hautbois d'occasion et complété dans la
basse par un Basson peut-être bien neuf, le tout placé
sur la large chape du Plein-Jeu ôté.
L'orgue fut reçu les 26 et 27 août 1813 par Couperin et Guillaume
Lasceux.
Et la suite ...
Après la mort de Gervais-François Couperin en 1826 Jean-Nicolas Marrigues, ami déjà âgé de Boëly, ancien élève d'Armand-Louis, fut nommé.
A sa mort, Alexandre-Pierre-François
Boëly assura quelques temps le service. Préférant
les Pleins-Jeux aux Tierces, il profita de la nécessité
de réparer les grandes Montres pour poser au facteur Louis-Paul
Dallery la question de la restitution des Pleins-Jeux.
La Fabrique refusa toute dépense.
On engagea en 1838 une récente
lauréate du Conservatoire, Marie Bigot, qui dut se contenter
de l'orgue tel qu'il était.
De même son successeur Baillet qui allait bientôt disposer
au Chœur d'un second orgue, ce qui lui fit peu à peu abandonner
le premier.
Pourtant, auparavant, en 1842, il fut demandé à Dallery
de remplacer la Montre des tourelles et la restitution des Pleins-Jeux
mais on lui refusa une soufflerie neuve et la possibilité d'ôter
quelque jeu que ce soit. Pour être sûr qu'aucun échange
de jeux ne puisse avoir lieu, on l'obligea même à travailler
à l'intérieur de l'église. Dallery maugréa
qu'il arriverait mal à placer 5 rangs de Plein-Jeu de positif
sur la seule chape de Larigot, puis il se mit au travail tandis
qu'on faisait repeindre le buffet d'une couleur encore plus foncée.
La réception eut lieu le 15 juillet 1843 avec, au positif, une
Cymbale V, 2/3' et au Grand-Orgue une autre Cymbale V, 1'
avec, dans la basse, un sixième rang de Tierce 2/5' que
des déplacements et retailles ultérieurs ont partiellement
transformé en unissons.
Cela ne provoqua pas pour autant un regain d'intérêt pour le grand orgue.
En 1845 on installa un petit
orgue de Daublaine et Callinet (en fait un pur Louis Callinet)
parmi les stalles, sans égard pour ce mobilier historique.
Seul Boëly vint assez souvent tenir le grand orgue, surtout
après son éviction de Saint-Germain-l'Auxerrois et bien
qu'il n'en ait jamais été le titulaire. Mais la présence
du petit orgue rendit celui de tribune moins nécessaire. On s'en
servit moins, on l'entretint moins encore. Pis, il failli brûler
dans l'incendie d'un reposoir disposé sous la voûte du porche
en 1853. Un tuyau de la Montre du positif fondit.
Dallery, en mal de clientèle, en profita pour proposer, en plus
de l'échange du tuyau fondu, une soufflerie neuve et des modernisations
en usage (un Récit expressif). On s'en tint au seul tuyau de positif
pour 20 francs !
Après la mort de Boëly en 1858, de Baillet en 1880, le grand orgue entra de plus en plus en léthargie malgré diverses propositions de réfection toujours repoussées.
La première restauration.
En 1902, quand un prêtre
actif, le Père Gauthier, voulut faire remettre en service
le vieil instrument, les services de la ville de Paris lui conseillèrent
de consulter Alexandre Guilmant.
Les travaux se firent en 1909. La maison Merklin fut chargé
de remettre l'orgue en service sans rien y changer, pas plus la soufflerie
cunéiforme que le pédalier à la française.
Les Montres furent blanchies, l'intérieur fut dépoussiéré,
des tuyaux muets reparlèrent, d'autres furent amuis (Plein-Jeu),
la deuxième trompette servit à remettre en état
les mauvais tuyaux de la première. C'est probablement à
cette occasion que les bourdons furent mis à calottes mobiles
et qu'ils perdirent leurs cheminées.
Ensuite, ce fut la guerre...
Pourtant en 1915, l'obstiné
Curé Gauthier (il l'était devenu entre temps) amena aux
claviers un amateur, pianiste puis claveciniste, qui allait pour Saint
Gervais se faire organiste et le défenseur passionné de
l'instrument. Il s'agissait de Paul Brunold. Avec des moyens de
fortune il réussit à faire parler la moitié des jeux.
Mais le boulet ne passa pas bien loin. Le vendredi saint 29 mars 1918
un obus allemand* tiré depuis les environs de Meaux jeta deux travées
de la voûte dans la nef de l'église et fit une centaine de
morts. L'orgue ne fut pas touché mais reçut beaucoup de
gravats. Une pierre tomba sur le banc entre le positif et le grand corps.
Le reste de la charpente tint bon.
L'orgue
fut bâché tandis qu'on réparait l'église.

* On
a longtemps pensé que l'obus avait été tiré
par une "grosse Bertha".
En fait, on apprend grace à internet que la "grosse Bertha"
n'était pas un canon à longue portée et que ce n'est
pas "elle" qui tira sur Paris :
Voir : http://html2.free.fr/canons/canparis.htm.

 Ce
n'est qu'en 1920 qu'on put recommencer à penser à l'orgue.
Le curé Gauthier en tête.
Ce
n'est qu'en 1920 qu'on put recommencer à penser à l'orgue.
Le curé Gauthier en tête.
Deux clans se formèrent autour de deux projets opposés présentés
par deux facteurs. Charles Mutin proposait une reconstruction complète
tandis que Louis Béasse soutenait la possibilité
d'une réparation à l'identique. Débâché,
l'orgue put faire entendre son positif et les fonds du Grand-Orgue au
triduum du 21 au 24 octobre 1920.
La ville de Paris préférait le projet de Mutin.
Consulté mais prudent, Charles-Marie Widor préféra
s'entourer d'une commission qui choisît finalement le projet de
Béasse Le principe en était que la restauration ne devait
« en aucun cas être une modification, même partielle
». Toutefois on accepta de changer la soufflerie mais en gardant
au musée un soufflet cunéiforme, comme y fut gardé
aussi le pédalier à la française tandis qu'on posait
un pédalier allemand (qui était prévu pour pouvoir
lui substituer le pédalier français conservé). On
maintint même des désordres évidents : silence du
sixième rang de plein jeu dont la basse sonnait toujours la tierce,
échanges passés de tuyaux entre jeux d'anches. On trouva
même, au cours du démontage, un bouton de tirage ancien sur
lequel furent copiés tous les autres (ils avaient été
changés en 1823). Une modestie exemplaire.
Toutefois on déplaça au fond de l'étage du grand
sommier ceux de Récit et d'Écho. On adopta un plan nouveau
pour la traction de la Pédale. Le bloc des claviers, trop bas pour
Joseph Bonnet, fut rehaussé d'une douzaine de centimètres,
l'ancien banc disparut ainsi que les bougeoirs en fer.
L'orgue fut inauguré le 7 février 1924.
Un ventilateur électrique fut posé en 1927.
Le 30 août 1924 la partie instrumentale de l'orgue fut classée
comme « monument historique », une première. Paul Brunold
espérait ainsi que l'orgue ne pourrait « jamais être
transformé ni seulement modifié ». Confiance
passionnée et touchante de naïveté !
L'entretien est confié
à Louis Eugène Rochesson.
Un dépoussiérage eut lieu en 1934 et, pour permettre à
Paul Brunold de jouer sans trop de peine le cinquième clavier,
la surélévation demandée par Bonnet fut réduite
de moitié après une fastidieuse rallonge de toutes les vergettes.
Jean Ver Hasselt commençait alors son rôle de suppléant. Peu après eut lieu la rencontre de Charles Tournemire avec cet orgue, à l'origine de sa « Suite évocatrice » écrite pour lui en 1938.
La deuxième restauration.
Puis vint la guerre et le remplacement des verrières par des châssis de bois garnis de vitres de plastique laissant entrer froid et vent. Malgré un fonctionnement parfois incertain, l'orgue assura régulièrement son service et Paul Brunold put même le faire entendre régulièrement lors des messes radiodiffusées.
 Jean
Ver Hasselt devint titulaire à la mort de Paul Brunold en 1948,
année précédant la repose des verrières au
cours de laquelle le positif fut inondé lors d'un orage. La remise
en état du positif, occasion d'un dépoussiérage de
l'orgue, révéla la signature de Langhedul* sur un tuyau
de la Montre qui avait repris place en 1922 sans même être
regardé de près.
Jean
Ver Hasselt devint titulaire à la mort de Paul Brunold en 1948,
année précédant la repose des verrières au
cours de laquelle le positif fut inondé lors d'un orage. La remise
en état du positif, occasion d'un dépoussiérage de
l'orgue, révéla la signature de Langhedul* sur un tuyau
de la Montre qui avait repris place en 1922 sans même être
regardé de près.
* L'authenticité de cette signature
a été mise en doute par Dufourcq qui, nommément,
a accusé Hardouin de « faux » dans un bouquin parfaitement
inintéressant sur ce plan et qui porte le doux titre de «
Mélanges François Couperin ». L'authenticité
réelle a été prouvée par la suite, quand on
a retrouvé d'autres signatures sur d'autres tuyaux.
En 1949 commença le reclassement des jeux d'anches. 15 ans
plus tard, celui des désordres les plus évidents du Plein-Jeu,
non sans une certaine perplexité. Plus tard un Nasard d'Écho
fait de tuyaux de récupération prit place sur la chape vide
de ce sommier.
![]() Ecouter
Jean Ver Hasselt avant la deuxième restauration : un Noël
de Louis-Claude D'aquin « Bon Joseph écoutez-nous ».
Une vieille cire !
Ecouter
Jean Ver Hasselt avant la deuxième restauration : un Noël
de Louis-Claude D'aquin « Bon Joseph écoutez-nous ».
Une vieille cire !
Attention : 4,3 Go
A l'approche du 3e centenaire
de la mort de François Couperin (en 1968), un nouveau « comité
d'organisation des Concerts de Saint Gervais » exigea qu'une
grande restauration fit de l'orgue dit « des Couperin »
(un « Crocodile » pour Widor) un « bel
orgue » de toute urgence.
Une admiration légitime de François-Henri Clicquot, jointe
au mépris de tout le matériel ancien qu'il avait pu y conserver,
conduisit au principe de restituer l'orgue de 1769 et, ce, d'après
la connaissance assez floue qu'on en avait.
 -
Relevage et remise en parfait état des parties existant en 1769,
-
Relevage et remise en parfait état des parties existant en 1769,
- Correction des libertés prises en 1921 : emplacement du Récit
et de l'Écho, mécanique de la Pédale, mais on n'allait
pas jusqu'à supprimer les leviers d'aide à la traction de
la Bombarde ni à la restitution pourtant facile du pédalier
français et des soufflets cunéiformes.
- Rétablissement de la composition de 1769 au prix des modifications
inévitables aux sommiers. Suppression du dessus de Flûte
de Dallery et du Basson-Clarinette de 1813 pour restituer un Larigot
neuf et un Plein-Jeu « à la Clicquot » sans
autre précision. Au Grand-Orgue suppression de la deuxième
trompette de Dallery père et du Plein-Jeu du fils
pour un grand Plein-Jeu X (sic) également aussi vaguement
« à la Clicquot ».
Le 5 mai 1967 marché
était passé sur le programme établi par Dufourcq
avec la maison Gonzalez (Danion) choisie sans alternative réelle
par le rapporteur. Le 5 juin le démontage fut entrepris dans une
hâte brutale qui légitima la création d'un comité
de défense de l'orgue de Saint Gervais et par la suite celle de
l'AFSOA. (Association Française pour la Sauvegarde
de l'Orgue Ancien).
Mai 68 grondait déjà sous la tribune de Saint Gervais.
Devant cette levée
de boucliers, le Ministère des Affaires Culturelles cessa tout
crédit, prépara une refonte de la Commission des Orgues
et suspendit les travaux à Saint Gervais, suspension qui devait
durer 6 ans. Seuls les travaux au buffet pouvaient continuer : décapage
à cru sans recherche des peintures et des décorations du
passé.
En 1969, pour ne pas maintenir le spectacle affligeant et accusateur du
buffet béant, on remonta provisoirement les tuyaux de façade
remis en état.
En 1970, la tâche du rapporteur fut confiée à un groupe
de travail vaguement paritaire dans lequel œuvra Michel Chapuis
représentant « ceux qui étaient d'un avis différent
sur les travaux à entreprendre »
Un nouveau devis du facteur,
du 18 septembre 1971, comporta en conséquence :
- Au positif, pose d'un dessus de Bourdon à cheminées
neuf au lieu de boucher la Flûte de Dallery et avec éviction
de cette dernière au musée. Faute de faux-sommier pour lire
la composition du Plein-Jeu d'origine, celui de Dallery sera maintenu;
le larigot « flûté et d'étoffe »
n'évincera le Basson-Clarinette que faute de trouver une
meilleure solution (en fait ce sera un Larigot étroit à
l'allemande, en étain).
- Au Grand-Orgue, pour conserver la deuxième Trompette tout
en rendant les 3 chapes d'origine au Plein-Jeu, la Voix-Humaine
sera reportée sur une chape supplémentaire; le Plein-Jeu
IX sera neuf et non pas composé sur le plan néo-classique
prévu initialement mais d'après le relevé fait sur
le faux-sommier d'origine (il avait été conservé).
- Au sommier de Pédale, les gravures non utilisées serviront
à faire monter, si possible, le pédalier jusqu'au Mi3. En
fait il ne montera que jusqu'au Ré.
Sur ces bases, les travaux de restauration purent reprendre en mars 1973 sous la direction effective et très prudente de Jacques Bertrand, organier de la maison Gonzalez.
Entre temps, Jean-Claude Malgoire et sa « Grande Écurie » donna à Saint Gervais un concert pour lequel il programma la « Messe pour les instruments au lieu des orgues » de Marc-Antoine Charpentier, ce qui n'eut pas l'heur de plaire en haut lieu, le tricentenaire torpillé étant encore dans les mémoires.
A la fin des travaux en 1974, l'orgue de Saint Gervais nous présenta :
| Positif, 51 notes Ut1 à Ré5 |
Grand-Orgue, (id) | Bombarde, (id) | Récit, 32 notes Sol2 à Ré5 |
Écho, 27 notes Ut3 à Ré5 |
Pédale, 27 notes Ut1 à Ré3 Anches : La0 à Ré3 |
| Montre 8'
1601 (façade
1758) Bourdon 8' 1973 Prestant 1601 Nasard 1659 Tierce 1659 Plein-Jeu V 1843 Larigot 1973 Cromorne 1769 Trompette 1766 Clairon 1780 |
Cornet V 1685
Montre 16' 1601 (plates-faces 1758, tourelles, 1843) Bourdon 16' 1676 (cheminées disparues) Montre 8' 1766 (façade 1758) Dessus Flûte 8' 1766 Bourdon 8' 1601 (basses bois 1685) Prestant 1601 Nasard 1628 Doublette 1601 Quarte 1685 Tierce 1628 Grosse Fourniture II 2' 1973 Fourniture III 1' 1973 Cymbale IV 2/3' 1973 Trompette 1766 Trompette 1812 Clairon 1766 Voix-Humaine 1628 |
Bombarde 16'
1766 |
Cornet V
1676 Hautbois 1766 |
Nasard 1967 (récup') |
Bourdon 16' 1766 Flûte 8' 1601 Flûte 4' 1659 Bombarde 1766 Trompette 1766 Clairon 1766 |
Un beau patchwork ... Mais quelle Histoire ! Jamais orgue n'eut tant de facteurs aussi respectueux du travail de leurs prédécesseurs. Bien aidés en cela par l'impécuniosité de la paroisse au 19e siècle.
Majorité
des tuyaux:
1601- Mathieu Langhedul
1628 - Pierre
Pescheur
1659 - Pierre Thierry
1676 - 1685 - Alexandre Thierry
1714 - François Thierry
1758 - 68 - Louis Bessart
1766 - 69 - 1780 - François-Henri
Clicquot
1812 -
Pierre-François Dallery
1843 - Louis-Paul Dallery
1973 - Danion - Gonzalez
Au musée (premier étage
de l'orgue, contre le mur) sont conservés :
- Le basson-Clarinette du positif,
- Le dessus de Flûte, 27 anciennes basses du Larigot de 1685 manchonnées
en 1812,
- Le Plein-Jeu VI de 1843
- L'ancien pédalier français.
Le ton est toujours en Si bémol
(un peu au dessus). Le tempérament pas tout à fait égal.