
Traité de l'Orgue de Marin Mersenne
PROPOSITION VIII.
Expliquer la matière , la proportion & la fabrique des tuyaux à anches , & tout ce qui leur appartient.
Ces tuyaux sont forts différents des précédents tant en leur forme qu'en leur matière , c'est pourquoi il faut expliquer leur fabrique , leur matière , leur figure et leur proportion.
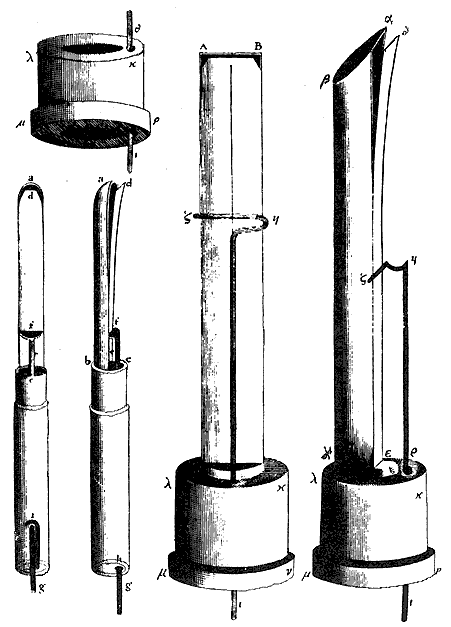 Sur
la figure, on voit les deux parties dont l'une est un demi cylindre creux
ou concave et l'autre est une petite lame bien mince et déliée
appelée languette. La languette couvre le concave du demi
cylindre que quelques uns appellent l'échalote. (Maintenant, c'est
la "rigole", l'échalote étant plutôt le
"noyau"). La matière de l'une et de l'autre a coutume
d'être de laiton, encore qu'on puisse les faire d'or, d'argent,
d'acier, &c. particulièrement le demi cylindre, car le couvercle
qu'on appelle languette ne peut être fait en étain ni des
autres métaux qui sont trop mous. Il faut qu'ils puissent frapper
l'air assez fort ou assez vite pour produire des sons agréables,
et qu'ils soient aussi vifs et robustes que l'on les désire, comme
sont les languettes de laiton, qui doivent être forgées bien
uniment, limées bien droites, et bien placées car le laiton
recuit sans être forgé ne vaut rien pour ces languettes.
Sur
la figure, on voit les deux parties dont l'une est un demi cylindre creux
ou concave et l'autre est une petite lame bien mince et déliée
appelée languette. La languette couvre le concave du demi
cylindre que quelques uns appellent l'échalote. (Maintenant, c'est
la "rigole", l'échalote étant plutôt le
"noyau"). La matière de l'une et de l'autre a coutume
d'être de laiton, encore qu'on puisse les faire d'or, d'argent,
d'acier, &c. particulièrement le demi cylindre, car le couvercle
qu'on appelle languette ne peut être fait en étain ni des
autres métaux qui sont trop mous. Il faut qu'ils puissent frapper
l'air assez fort ou assez vite pour produire des sons agréables,
et qu'ils soient aussi vifs et robustes que l'on les désire, comme
sont les languettes de laiton, qui doivent être forgées bien
uniment, limées bien droites, et bien placées car le laiton
recuit sans être forgé ne vaut rien pour ces languettes.
L'échalote (la rigole) représente la bouche ou le palais
et le couvercle (la languette) lui sert de langue, mais les figures font
mieux comprendre tout ce qui appartient à ces tuyaux qu'un plus
long discours, car la partie ![]() représente
le demi cylindre de laiton, lequel est un peu plus gros vers
représente
le demi cylindre de laiton, lequel est un peu plus gros vers ![]() où
il commence à se courber, qu'il n'est vers
où
il commence à se courber, qu'il n'est vers ![]() .
Or, il faudrait faire ce demi cylindre d'autant plus gros qu'il est plus
long, encore qu'une même grosseur puisse servir à différentes
longueur, afin qu'il soit mieux proportionné et que leurs sons
ne soient pas seulement plus creux, ou plus graves, mais aussi plus pleins
et qu'ils aient plus de corps.
.
Or, il faudrait faire ce demi cylindre d'autant plus gros qu'il est plus
long, encore qu'une même grosseur puisse servir à différentes
longueur, afin qu'il soit mieux proportionné et que leurs sons
ne soient pas seulement plus creux, ou plus graves, mais aussi plus pleins
et qu'ils aient plus de corps.
Après avoir fait l'échalote (la rigole) ![]() ,
on la couvre d'une languette
,
on la couvre d'une languette ![]() ,
laquelle lui est égale en grandeur et, puisque l'on entre dans
un plus gros cylindre de bois ou d'autre matière que l'on appelle
le noyau et que l'on perce de même grosseur que l'échalote
(la rigole) afin qu'elle entre dedans avec sa languette dont elle est
couverte. Et parce que elle doit y tenir ferme et demeurer dans le noyau,
l'on y pousse un petit coin de bois qui a la même figure que le
demi cylindre, pour remplir la moitié du trou.
,
laquelle lui est égale en grandeur et, puisque l'on entre dans
un plus gros cylindre de bois ou d'autre matière que l'on appelle
le noyau et que l'on perce de même grosseur que l'échalote
(la rigole) afin qu'elle entre dedans avec sa languette dont elle est
couverte. Et parce que elle doit y tenir ferme et demeurer dans le noyau,
l'on y pousse un petit coin de bois qui a la même figure que le
demi cylindre, pour remplir la moitié du trou.
Quant à l'autre bout de la languette, il doit être libre
pour se mouvoir plus ou moins fort, vite, et suivant le son qu'elle doit
faire. On accourcit la longueur qu'on lui laisse libre autant qu'on le
veut par le moyen d'un fil de fer ou de laiton qui passe par un petit
trou que l'on fait dans le noyau. Ce fil doit se tenir assez ferme dans
ce petit trou afin qu'il ne puisse se hausser ou baisser sans force et
qu'il tienne toujours la languette en même état que les Facteurs
la mette, jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de remuer ce
fil et de le faire descendre ou monter pour accorder les tuyaux à
anches.
Ce fil de fer s'appelle le mouvement, le ressort ou le gouvernail (maintenant
: tige d'accord, ou plutôt la rasette) et est courbé
à la fin pour presser la languette contre son corps. Plus la tête
du fil de fer est éloignée du bout de la languette et plus
le son de l'anche est grave. Plus il en est proche et plus le son est
aigu, à raison que la partie de la languette qui bat l'air est
plus courte, et par conséquent elle fait ses retours plus vite.
Le mouvement de la languette est semblable à celui d'un ressort
: les périodes des plus grands corps ont coutume de durer plus
longtemps.
Ce ressort de l'anche, que quelques uns appellent la rasette, sert à
hausser ou à baisser le ton et peut faire monter la languette par
tous les intervalles d'une octave, comme le chevalet du monocorde et les
chevilles des autres instruments font monter les cordes. Le ressort peut
être comparé à un chevalet mobile et l'anche servir
de monocorde.
Les deux figures à gauche font voir la fabrique et la beauté
des régales, anches, ou voix humaines, que l'on fait d'argent ou
de laiton et dont le ressort peut passer par les deux petits trous du
noyau, comme dans les premiers, ou par la première ouverture du
noyau et repasser par un trou que l'on fait dans le corps de l'anche comme
on le voit au point i de la première des petites régales.
Quant aux deux languettes de ces deux régales que l'on voient de
face et de profil, comme les autres, sont ici en leur grandeur naturelle
(environ 123 mm sans la tige qui dépasse) et les moindre sont à
l'unisson d'un tuyau de huit pieds ouvert, c'est à dire au ton
de chapelle, et les plus grandes à l'unisson des tuyaux de seize,
ou de vingt quatre pieds, quoiqu'elles ne puissent bien parler si on ne
leur ajoute pas des corps proportionnés à leur grosseur
et à leur longueur. Ces anches reçoivent plusieurs noms
suivant la différence de leur sons, car les simples anches sont
quasi indifférentes à toutes sortes de sons et sont modifiés
et déterminés par la forme et la grandeur des corps qu'on
leur ajoute.
Si leurs corps sont beaucoup plus larges en haut qu'en bas, on les appelle
Trompettes ou Clairons parce qu'ils imitent le son de ces instruments.
S'ils sont plus longs sans s'élargir en haut, on les appelle cromornes.
Mais il n'est pas nécessaire d'observer la proportion si exacte
entre les anches qu'entre les autres tuyaux, à raison qu'une même
anche peut servir à plusieurs tons. De là vient que les
Facteurs ne font pas toutes les anches de différentes grandeur,
encore qu'elles doivent faire des tons différents. Ils font servir
une même grosseur et une même longueur à 4 ou 5 tons
qui se suivent immédiatement.
Néanmoins leur harmonie serait plus agréable et plus naturelle
si chaque anche gardait la proportion de son intervalle car chaque chose
n'est jamais meilleure que lors qu'elle est en sa juste proportion et
grandeur et que le sens répond parfaitement à la raison,
et le sentiment à l'intellectuel.