
Traité de l'Orgue de Marin Mersenne
PROPOSITION XX.
Déterminer quelles sont les propriétés de chaque jeu de l'Orgue , & pourquoi l'on aperçoit pas les dissonances que font les Organistes en jouant.
Puis que les tuyaux sont
différents en grandeur et en matière, il n'y a nul doute
qu'ils ont des tons et des sons différents qui affectent l'ouïe
et l'esprit en diverses manières. Les tuyaux bouchés parlent
plus doucement que les ouverts à raison que le vent qui sort par
la lumière du tuyau ne bat leur languette si fort que les ouverts,
d'autant que le vent qui entre dans la bouche rencontre celui qui revient
de dedans le tuyau, qui affaiblit l'impétuosité de celui
qui entre car le vent va frapper le bout ou le fond du tuyau est contraint
de ressortir par la même bouche par laquelle il est entré,
parce qu'il n'a point d'autre sortie.
Quant aux tuyaux de bois, ils sont plus doux que ceux d'étain parce
que le bois est plus mou ou qu'il a plus de pores. Il est difficile d'expliquer
la qualité des sons de chaque jeu si on ne les rapporte aux instruments
dont ils imitent le son. Par exemple, aux flûte d'Allemand, aux
cornets, aux trompettes, etc. car la plus grande partie de nos connaissances
est fondée sur la comparaison que nous faisons de l'un à
l'autre.
Il suffit de dire ici que les jeux de l'orgue peuvent imiter tous les
autres instruments à vent, et peut être de ceux qui utilisent
de cordes, comme la viole et la lyre.
Pour les dissonances, c'est plus facile à comprendre si l'on entend
les notes qui suivent.
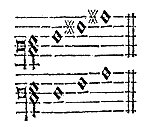 Chaque
portée représente un jeu, et ces deux jeux sont à
la tierce l'un de l'autre. Le dessus qui fait la tierce avec la basse
est toujours éloigné d'une tierce majeure à chaque
tuyau. Si l'on suppose que les trois notes qui sont à la basse
soient les trois sons que l'on joue sur la basse, les trois notes du dessus
sont les trois notes des trois tuyaux du dessus qui parlent à la
tierce. Si l'on joue ensemble la première et la deuxième
note de la basse, on obtient une quinte superflue (triton), et
si l'on touche aussi la troisième, on obtient une septième.
Chaque
portée représente un jeu, et ces deux jeux sont à
la tierce l'un de l'autre. Le dessus qui fait la tierce avec la basse
est toujours éloigné d'une tierce majeure à chaque
tuyau. Si l'on suppose que les trois notes qui sont à la basse
soient les trois sons que l'on joue sur la basse, les trois notes du dessus
sont les trois notes des trois tuyaux du dessus qui parlent à la
tierce. Si l'on joue ensemble la première et la deuxième
note de la basse, on obtient une quinte superflue (triton), et
si l'on touche aussi la troisième, on obtient une septième.
(DGW : .. et même un demi ton : sol et sol#. On entend
une septième parce qu'il y a une erreur sur la portée :
la tierce du sol est si, et non si# !).
Il est aisé de montrer la même chose des neuvièmes
et de plusieurs autres dissonances que l'on est contraint de faire sur
l'orgue, encore qu'on ne les aperçoivent pas ordinairement. La
raison de ce phénomène doit être prise de la faiblesse
des moindres tuyaux dont les sons ne paraissent quasi nullement parmi
les plus grands jeux parce que leurs sons cachent, étouffent et
engloutissent les autres comme la lumière du soleil cache celle
des chandelles.
Or il est certain que les six notes ut, ré, mi, fa, sol, la, se
peuvent parfois rencontrer sur une même touche de sorte que toutes
les dissonances accompagnent toutes les consonances, ce qui ne pourrait
être que très mauvais et insupportable si les sons qui discordent
étaient assez forts pour être ouïs et remarqués.
Ce qui n'empêche pas que ces petits jeux ne rendent l'harmonie plus
remplie et plus massive, ou solide, car ils donnent du lustre aux tuyaux
qui font les unissons et les octaves. Ces derniers ont ce semble trop
de douceur pour être agréables si l'on n'y mêle des
sons qui tiennent de l'aigre, du piquant et de l'aigu, et qui fassent
mieux goûter l'harmonie dans laquelle il suffit que les consonances
prédominent et qu'elles préoccupent tellement l'oreille
qu'elle n'en perde point l'idée par la présence des dissonances.