LES VRAIES NOTES INÉGALES...
D'APRÈS MERCADIER
On trouve, à la Bibliothèque Nationale, un traité de musique dont l'existence est connue de certains musicologues américains, mais semble généralement ignorée chez nous :
"Nouveau système de Musique théorique et pratique par MERCADIER de BELESTA, Paris 1776"
Au moins deux chapitres de ce traité méritent d'être tirés de l'oubli :"De la mesure et de la valeur des notes et des silences" et "Du tempérament"
Le large extrait ci-après du premier n'apporte rien sans doute de très nouveau, mais il a le mérite d'exposer de façon claire le principe et la pratique des notes inégales dans la musique française du XVIIIe siècle.(Nous conservons la numérotation des paragraphes de l'auteur, elle facilite la référence à des paragraphes antérieurs extrait d'une partie non reproduite du chapitre: la "Description des divers types de mesures").
149- Remarquons maintenant qu'il y a des tems où la mesure se fait beaucoup plus sentir qu'à d'autres: c'est pourquoi on nomme les premiers "tems forts" par opposition aux derniers qu'on appelle "tems foibles". Dans la mesure à deux tems, le premier tems est fort et le second est foible; dans la mesure àtrois tems, le premier tems est fort et les deux autres sont foibles; dans la mesure à quatre tems, le premier et le troisième sont forts tandis que le second et le quatrième sont foibles.
150- Notons encore que la mesure se fait aussi mieux sentir au premier instant de chaque tems qu'au dernier ainsi le tems a aussi ses parties fortes et ses parties foibles. Si un tems se divise en deux parties, la première est forte et la seconde foible. S'il se divise en trois parties, il n'y a que la première de forte. S'il se divise en quatre parties, la première et la troisième sont fortes et la seconde est foible ainsi que la quatrième. S'il se divise en six parties, la première, la troisième et la cinquième, ou si c'est par accident en sorte qu'il faille en avertir (Art.143) la première et la quatrième seulement sont fortes et les autres foibles etc..
(143- On divise encore en trois parties égales les tems des mesures à 4 tems, à 3/4, à 3/2 etc., à2, à 2/4 etc. en mettant trois noires et trois croches etc. au lieu de deux, et un 3 au dessus d'une de ces trois notes. On met aussi quelquefois six ou neuf notes au lieu de 4 ou de 6 et on en avertit en mettant un 6 ou un 9 au dessus.)
151- De là vient une espèce d'inégalité qui paroît être entre les notes de même valeur qui sont sur des tems forts et sur des tems foibles, et plus encore entre des notes de même valeur qui sont sur des parties fortes et sur des parties foibles du même tems; celles-ci paroissent toujours de moindre durée que celles-là. Au reste, c'est dans cette inégalité apparente que consiste principalement le sentiment de la mesure; car de même qu'une syllabe brève appuie sur une longue, un tems foible pause sur un tems fort et le rend plus sensible.
152- Lorsqu'il ne faut qu'une ou deux notes pour un tems, on les fait égales autant qu'il se peut excepté dans les mesures à 3 et 3/8 etc. où deux notes de valeur égale qui composent un tems se passent d'ordinaire fort inégalement, la première étant un peu plus longue que la seconde.
153- S'il en faut quatre, huit ou seize etc. elles sont inégales, la première plus longue que la seconde, la troisième plus longue que la quatrième, ainsi de suite.
154- S'il en faut six, elles sont inégales comme les précédentes excepté lorsque ces notes sont mises pour quatre de la même espèce: auquel cas elles doivent être égales ou bien la première et la quatrième doivent être un peu plus longues au dépens de la deuxième et de la cinquième. S'il n'en faut que trois ou que, dans une mesure quelconque, on mette trois notes pour deux de la mème espèce, on doit les passer également ou soutenir la première un peu plus et la seconde un peu moins que la troisième.
155- Il est aisé présentement de s'apercevoir de la différence et de l'analogie de la mesure à deux tems et de la mesure à quatre tems: dans la première, il faut quatre croches pour chaque tems et par conséquent elles sont inégales; dans la seconde, il ne faut que deux croches pour chaque tems et conséquemment elles sont égales; d'où l'on voit que la mesure à quatre tems est au fond la même que la mesure à 2/4 et qu'elle peut y être réduite en partageant chaque mesure en deux parties égales.
156- Lorsqu'on doit passer également des notes qui doivent être inégales suivant l'usage ordinaire, on en avertit en mettant des points au dessus de chacune de ces notes pendant les premières mesures; il est cependant plus sûr d'en avertir par écrit. Si l'on veut par exemple que les croches se passent également dans une mesure à deux ou à trois tems, on n'a qu'à mettre au commencement "croches égales".
157- Remarquez que les croches, quoiqu'inégales dans certaines mesures ,sont cependant égales pour l'ordinaire lorsqu'elles sont entremêlées de doubles-croches. Il en est de même des doubles-croches, lorsqu'elles sont entremêlées de triples-croches.
Il est intéressant de faire le rapprochement avec les définitions données par J.J.Rousseau dans son "Dictionnaire de Musique":
Piqué, adj. pris adverbialement. Manière de jouer en pointant les notes et marquant fortement le pointé.
Notes piquées sont des suites de notes montant ou descendant diatoniquement ou rebattues sur le même degré, sur chacune desquelles on met un point quelquefois un peu allongé, pour indiquer qu'elles doivent être marquées égales par des coups de langue ou d'archet secs et détachés, sans retirer ou repousser l'archet mais en le faisant passer en frappant et sautant sur la corde autant de fois qu'il y a de notes dans le même sens qu'on a commencé.
Les points au dessus des notes
indiquent donc pour Rousseau des notes égales, comme pour Mercadier,
et de plus détachées; mais le nom de "notes
piquées" qu'il donne prête à confusion avec l'indication
"piqué" qui, placée au début d'une pièce
(pièces de clavecin de Dandrieu par exemple) équivaut au
contraire à "notes pointées" c'est à
dire inégales.
Rousseau définit:
Pointer, c'est au moyen du point, rendre alternativement longues et brèves des suites de notes naturellement égales, telles, par exemple, qu'une suite de croches.. .dans la musique françoise, on ne fait les croches exactement égales que dans la mesure à quatre temps; dans toutes les autres, on les pointe toujours un peu, à moins qu'il ne soit écrit "croches égales".
Ces remarques faites, le reste du texte de Mercadier ci-dessus peut se passer de commentaires.
Henri LEGROS.
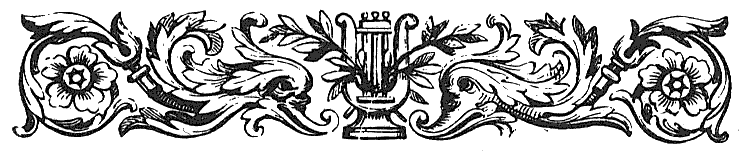
A la suite de l'article de Henri Legros, le Pr Ewald KOOIMAN apporte les précisions suivantes dans le N° 35 de "Connoissance de l'Orgue", 1980.
RETOUR
A
MERCADIER
Dans le Numéro 26 de Connaissance de l'orgue, Henri LEGROS a attiré l'attention sur le traité de MERCADIER de BELESTA paru en 1776 sous le titre "Nouveau système de Musique théorique et pratique"
Legros donne un large extrait du traité (paragr. 149-157) auquel il joint quelques remarques. Je cite: (Mercadier)"a le mérite d'exposer de façon claire le principe et la pratique des notes inégales dans la musique française du XVIIIe siècle". Le but du présent article est de démontrer que Mercadier dans les paragraphes cités ne parle pas que des notes inégales, mais aussi de la distinction capitale entre temps forts et temps faibles. Cette dernière distinction est toute autre que celle entre notes égales et inégales et, chose étonnante, elle parait avoir échappé à l'attention des auteurs modernes qui s'occupent de l'interprétation de la musique française ancienne.
Au paragraphe I49, Mercadier fait remarquer "qu'il y a des tems où la mesure se fait beaucoup plus sentir qu'à d'autres; c'est pourquoi on nomme les premiers tems forts par opposition aux derniers qu'on appelle tems foibles". Dans la suite (paragr.150), Mercadier explique que la même distinction vaut pour les temps qui, eux aussi, possèdent leurs parties fortes et leurs parties faibles.
Dans une représentation schématique, on a donc:
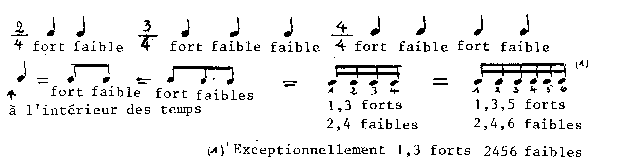
Mercadier enchaîne, en disant au paragraphe 151: "De là vient une espèce d'inégalité qui paroît être entre les notes de même valeur qui sont sur des tems forts & sur des tems foibles, & plus encore entre des notes de même valeur qui sont sur des parties fortes et sur des parties foibles du même tems, celles-ci paroissant toujours de moindre durée que celles-là. Au reste c'est dans cette inégalité apparente que consiste principalement le sentiment de la mesure.
Citation extrêmement
importante et tout à fait obscure, tant qu'on croit que Mercadier
parle ici de notes inégales. Que faut-il entendre par "une
espèce d'inégalité" ou une "inégalité
apparente"? Pour y voir clair, il semble opportun de citer un autre
auteur du XVIIIe siècle.
Dans la Méthode de musique sur un nouveau plan de JACOB
(Paris 1769), figure un chapitre intitulé "Sur la distinction
des Tems et des Portions de Tems en forts & en foibles" dont
je cite quelques phrases tout à fait révélatrices:
"Quoique... les Croches dites égales, les blanches mêmes,
soient supposées égales entre elles & le soient réellement,
l'exécution de ces Notes porte néanmoins dans la pratique
une empreinte d'inégalité. Car les Croches qu'on appelle
égales, se passent toujours de manière qu'une oreille exercée
n'a pas de peine à distinguer la Croche qui est pour ainsi dire,
de repos, d'avec celle qui est de passage. Il en est de même des
Noires & des Blanches. Bien plus, dans une suite continuée
de Rondes, l'oreille distingue la même chose" (p.55).
Eugène BORREL, dans son article "Les notes inégales dans l'ancienne musique française" (Revue de Musicologie XII,1931 pp.278-289) donne la même citation, qu'il qualifie d'ailleurs de "curieuses réflexions". Ce jugement n'étonne pas : nulle part dans ses travaux sur l'inégalité, Borrel ne fait mention de la distinction entre Temps forts et faibles. Force nous est de conclure que le passage du traité de Jacob lui fut totalement incompréhensible. Ce que Jacob explique ici, c'est qu'à côté de l'inégalité, qui vaut en général pour les seules croches, il y a une autre distinction, celle-ci valable pour l'ensemble des valeurs et même pour les notes "égales". Le phénomène décrit par Jacob n'est pas typiquement français. Les Italiens parlent de notes "buone" et "cative"; chez les Allemands, il est question de "anschlagende" ou "innerlich lange Note" d'une part et d'autre part de "durchgehende" ou "innerlich kurze Note". Lorsque J.G.Walther parle de valeur intrinsèque et extrinsèque, c'est toujours la même distinction.
Nul mieux qu'ENGRAMELLE n'a exposé les conséquences de ladite distinction pour l'articulation. (*) Je me permets de renvoyer à mon article "Articulatie in de oud-Franse muziek" ( il est paru in Orgelkunst 1980 pour une étude détaillée de ce problème d'une portée éminemment pratique pour l'exécutant.
Pour compléter la liste des auteurs qui ont parlé des notes appuyées et des notes de passages, je cite encore DARD, Nouveaux principes de Musique, Paris 1769 "Il est de règle que toutes les mesures ont leurs tems forts et leurs tems foibles. . .on appuye davantage sur le tems fort que sur le foible'' (p.8). Il y a pour terminer, BUTERNE, Méthode pour apprendre la Musique vocale et instrumentale, Paris 1752, qui écrit: "Dans toutes les divisions des Mesures, on distingue le tems fort et le tems foible"(p.12).
En résumant, la distinction entre notes fortes et faibles appartient au domaine de l'articulation. En tant que telle, elle ne relève pas du choix de l'exécutant, mais fonctionne comme un élément de base, valable dans tous les cas. Avec l'inégalité au contraire, on entre dans le domaine expressif où la liberté individuelle, toujours fondée sur le respect des règles auxquelles le goût enlève toute rigidité, a son mot à dire.
Dr Ewald KOOIMAN -1980-
Université libre d'AMSTERDAM.
(*) On retrouve intégralement le texte d'Engramelle dans "L'art du Facteur d'Orgues" de Dom Bedos de Celles.
