
Traité de l'Orgue de Marin Mersenne
PROPOSITION II.
Expliquer la construction de l'Orgue , & de toutes ses parties.
Il y a deux sortes de parties
dans les Orgues, les premières qui servent à produire le
son, les secondes à l'ornement. Pourvu que le vent fasse bien parler
les tuyaux, l'Orgue a ce qui lui est nécessaire. Mais comme le
vent doit y entrer d'une certaine manière selon la volonté
des Organistes, les touches du Clavier sont encore nécessaires
et conséquemment toutes les parties qui l'accompagnent.
Les autres parties, ornementales, consistent au Buffet et en toutes les
gentillesses dont on les embellit.
l'une des principales pièces est le Châssis parce
que l'on enchasse dedans la table du sommier sur lequel on pose
les tuyaux. Les côté de ce châssis ont 3 pouces de
hauteur et 1 pouce 1/2 d'épaisseur dans lequel on applique un fond
de l'épaisseur d'1 pouce qu'il faut coller avec lesdits côté.
Quelques-uns font le sommier à ressorts pour les plus grands jeux
de l'Orgue à raison qu'ils sont trop grands pour les registres
traînants des Orgues de moyenne grandeur.
Les Facteurs prennent une grande table de bois de chêne bien sec,
bien uni, sans fentes et épaisse de peur que la dimension ne la
fasse s'incurver. Après que cette table a été préparée,
on applique dessus des tringles de bois épaisses, qui sont
éloignées les unes des autres de 2 doigts pour faire place
aux cranes ou gravures. On en fait 48 que quelques uns appellent
barreaux (maintenant : barrages) et que l'on colle sur ladite
table, dont on en assemble quelques uns à queue, et que l'on enchasse
dans les bords du châssis. On les fait de chêne bien sec et
bien doux afin qu'ils fassent les 48 rainures qui portent le vent aux
tuyaux.
(DGW : en fait il faut 49 barreaux pour faire 48 gravures.
Simple problème d'intervalles).
On les remplit de colle bien claire que l'on fait couler d'un côté
et d'autre pour remplir les petites cavités et les pores du bois.
On applanit la colle avec des brosses ou bien l'on colle du papier dans
les rainures avec de la colle d'Angleterre.
Mais avant de coller les barreaux il faut mesurer les places des tuyaux
sur le sommier et faire que les trous de leur place se trouvent tous sur
le milieu au long des tringles, et puis il faut faire d'autres trous à
la droite des autres dans les gravures. Il faut aussi coller du cuir velu
sur les cranes (gravures) et, quand il est bien sec, les percer avec un
fer chaud.
Ceci étant fait, on prépare des morceaux de bois de la largeur de 1 ou 2 pouces dont les plus larges servent de chapes et les plus étroits servent de registre que l'on attache ensemble sur le sommier, c'est à dire sur le dessus du fond du châssis, avec des chevilles. On les perce aisément vis à vis les uns des autres, soit avec des villebrequins ou avec des fers chauds pour avoir les 48 trous de chaque jeux qui n'a qu'un seul trou dans chaque gravure pour chacun de ses tuyaux. S'il y a 20 ou 30 jeux chaque rainure doit avoir 20 ou 30 trous ; afin que les 48 trous d'un même jeu se trouvent sur une même ligne sur le sommier, sur laquelle on pose tous les tuyaux. (DGW : en réalité les trous d'un même jeu sont maintenant en zig-zag).
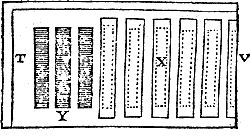 Quand
les chapes et les registres ont été percés comme
les rainures et le sommier, on les enlève afin d'ajuster le registre
entre le sommier et la table pour qu'ils soient étanches mais que
le mouvement soit bien libre. On fixe les chapes avec des vis ou des clous
aux tringles qui sont à côté des registres (on les
appelle maintenant faux-registres) afin que ces derniers coulissent
aisément sans se soulever et sans pouvoir bouger ni d'un côté
ni l'autre.
Quand
les chapes et les registres ont été percés comme
les rainures et le sommier, on les enlève afin d'ajuster le registre
entre le sommier et la table pour qu'ils soient étanches mais que
le mouvement soit bien libre. On fixe les chapes avec des vis ou des clous
aux tringles qui sont à côté des registres (on les
appelle maintenant faux-registres) afin que ces derniers coulissent
aisément sans se soulever et sans pouvoir bouger ni d'un côté
ni l'autre.
Sur la gravure 1, T V montre le châssis en dessous du sommier. Y montre les gravures, rainures ou cranes ouvertes. X les montre recouvertes de peau de mouton.
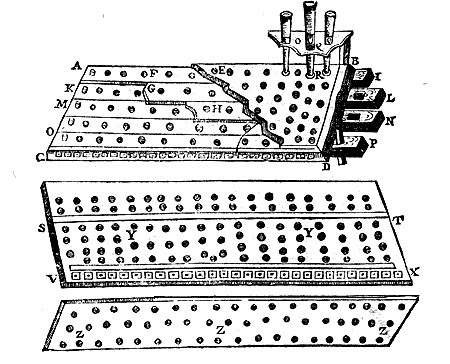 Figure
2. Quant aux tringles, qui ont 2 ou 3 lignes d'épaisseur, elles
paraîssent sur l'autre figure de S à T, et V X sur lesquelles
la châpe Z Z doit porter afin que les registres I, L, N, P se meuvent
dessous par le moyen d'un fer que l'on met dans leurs mortaises, qui sont
au bout desdits registres après leurs derniers trous. Or leur mouvement
ne doit pas être supérieur à la moitié de la
distance d'un trou à l'autre. Ce mouvement ne se fait que pour
ouvrir ou fermer les trous tels qu'on les voit à G et H.
Figure
2. Quant aux tringles, qui ont 2 ou 3 lignes d'épaisseur, elles
paraîssent sur l'autre figure de S à T, et V X sur lesquelles
la châpe Z Z doit porter afin que les registres I, L, N, P se meuvent
dessous par le moyen d'un fer que l'on met dans leurs mortaises, qui sont
au bout desdits registres après leurs derniers trous. Or leur mouvement
ne doit pas être supérieur à la moitié de la
distance d'un trou à l'autre. Ce mouvement ne se fait que pour
ouvrir ou fermer les trous tels qu'on les voit à G et H.
La chape E R est d'une seule pièce. Les peaux de velin ou de mouton
X (figure 1) doivent être bien collées sur les rainures afin
que le vent ne puisse communiquer de l'une à l'autre, de peut qu'il
se fasse des emprunts qui font souvent corner les tuyaux qui ne doivent
pas sonner.
La pièce de bois O Q qui tient les tuyaux en état s'appelle
le tamis.
Figure 3. Après collage du velin, il faut le couper sur les rainures
pour ouvrir d'une longueur correspondant aux soupapes, que l'on voit en
1, 2, 3, 4, 5 &c. Les soupapes sont un peu plus longues et plus larges
que les ouvertures pour les recouvrir parfaitement et sont doublées
de cuir de mouton afin que le vent ne se perde pas. La queue de la soupape
est attachée au sommier avec un petit morceau de cuir qui dépasse
de celui qu'on a collé dessous.
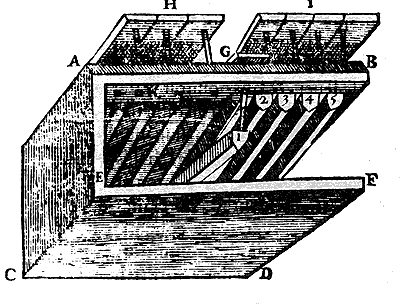
Les pilotis ou tirants qui paraissent sous les marches H et I et dont
l'une fait baisser la première soupape, tiennet d'un bout à
la marche et de l'autre à la tête de la soupape par le moyen
d'un fil de laiton, qui s'accroche à une petite boucle de laiton
fichée dans la soupape.
Sur la quatrième figure, A montre la soupape qui est couchée
sous sa rainure. B C montre la marche (touche du clavier) qui fait abaisser
ladite soupape par le moyen du pilotis C D, et qui pèse sur le
bout de la soupape E et contraint le ressort de laiton E F G à
se ployer et à s'abaisser.
La ligne pointillée K montre le conduit, ou le canal par où
le vent se communique jusqu'aux tuyaux.
On met des épingles ou d'autres petites pointes entre les têtes
des soupapes afin qu'elles n'aient nul autre mouvement que celui qui est
nécessaire pour ouvrir ou fermer les gravures. Les queues des ressorts
sont dans les traits de scie qui paraissent sous R . Comme il y a 48 ressorts,
il y a 48 traits de scie qui correspondent au milieu des 48 soupapes et
qui sont faits sur une tringle carrée de 1 pouce 1/2 de côté,
que l'on met sur le fond E F de la layette A B E F (figure 3) qui
n'est autre que la layette Q S R de la figure 4 diversement représentée.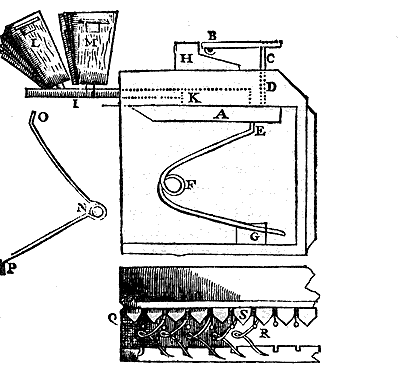
Cette layette est le coffre qui contient le vent de la soufflerie, que l'on fait plus ou moins grande en fonction de la dimension du sommier. Si le sommier a 6 pieds de long et 3 de large, il aura une layette, casse, ou caisse, de 4 pouces de hauteur et est plus longue (plus profonde) de 2 pouces que les soupapes. Elle est aussi longue que le sommier auquel elle est jointe avec des chevilles sur le derrière. Au devant elle se joint seulement par le moyen d'une planchette mobile qu'il faut parfois ôter pour visiter les soupapes.
Cette planchette parait en A B dans la cinquième figure, qui ferme la layette et qui tient fermement par les petits fers qui sont à ses côtés en haut. La boucle du milieu sert pour la tirer et pour ouvrir le coffre lequel est comme le trésor du vent. Il faut couvrir le dedans de cette planchette de peau de mouton qui se redouble par dessus les bords afin qu'elle empêche mieux que le vent ne se perde.
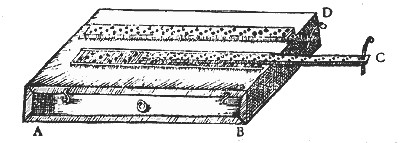 On
voit aussi comme le registre C est tiré de dessus le sommier quoi
qu'il est trop tiré ici puis qu'il ne doit de tirer que de la seule
largeur de l'un des trous. Cette figure a été faite ainsi
à dessein pour représenter les trous du sommier, que l'on
reperce avec des fers chauds de peur que les villebrequins y laisse quelques
petites particules de bois.
On
voit aussi comme le registre C est tiré de dessus le sommier quoi
qu'il est trop tiré ici puis qu'il ne doit de tirer que de la seule
largeur de l'un des trous. Cette figure a été faite ainsi
à dessein pour représenter les trous du sommier, que l'on
reperce avec des fers chauds de peur que les villebrequins y laisse quelques
petites particules de bois.
Quant à la soufflerie, on la compose ordinairement de 5 soufflets
de 6 pieds de long sur 4 de large, dont chacun doit avoir 2 lunettes (évents)
de 4 pouces de haut sur 2 de large parce que s'ils n'en avaient qu'une,
elle serait trop grande pour aspirer et sa soupape ne pourrait pas s'ouvrir
aisément. Il faut encore mettre une soupape dans le mufle de chaque
soufflet afin qu'il n'aspire pas le vent de son compagnon et qu'elle se
ferme tandis que les autres aspirent, autrement le vent de l'un fera enfler
l'autre. Le porte-vent qui commence aux mufles doit être
plus gros à l'endroit où l'on met le tremblant dant nous
parlerons après.
Les soufflets ont 5 plis et 12 éclisses de bois de chêne
de chaque côté, dont les jointures collées sont couvertes
de velin et qu'ils se referment eux mêmes en moins d'un quart d'heure,
quoi que l'Orgue soit bien étanché et que les soupapes demeurent
fermées.