
|
Encyclopédie RORET |
Dom Bedos de Celles

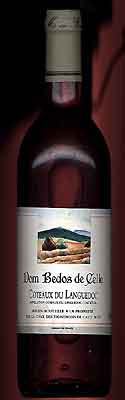 L'ART
DU FACTEUR D'ORGUES
L'ART
DU FACTEUR D'ORGUES
François
Lamathe BEDOS de CELLES de SALELLES est né à CAUX, diocèse
de Béziers, le 24 janvier 1709 d'une famille de très vieille
noblesse aux armoiries ainsi définies : "De gueules,
à trois croissants d'argent, surmontés de trois étoiles
de même, à l'orle de huit coquilles d'argent".
Il est mort en 1779.
Il doit la particule "Dom" à son appartenance à
l'ordre religieux des Bénédictins de Saint-Maur.
Membre de l'Académie de Bordeaux et correspondant de l'Académie
des sciences de Paris, on lui doit un des meilleurs traité de gnomonique
ou "L'art de tracer les cadrans solaires" (1760), l'Art
du Relieur et du Doreur de Livres et l'Art du Facteur d'Orgues
(1766).
"L'Art du Facteur d'Orgues" a été
réédité en 1849 dans l'Encyclopédie RORET,
"Nouveau Manuel Complet du Facteur d'Orgues", complété
par l'exposé des "perfectionnements réalisés
pendant la première moitié du XIXe siècle",
par M. HAMEL.
Une seconde édition de cette encyclopédie a été
publiée en 1903, à son tour complétée par
"L'Orgue Moderne", rédigé par Joseph GUEDON.
C'est à partir de cette édition que j'ai réalisé
cette page, cet ouvrage étant beaucoup plus facile à manier
et à passer sur un "Scan" pour en obtenir la reconnaissance
du texte. On ne s'étonnera donc pas d'y trouver toutes les mensurations
dans le système métrique, transposition qu'avait réalisée
Hamel lui même. Par contre, le texte est la copie conforme de celui
d'origine, à quelques détails mineurs près, j'ai
vérifié.
On découvrira d'autres pages de l'Art du Facteur
d'Orgues, à partir de l'édition originale, sur le site
de "l'Hydraule" :
http://smcj.club.fr/bureau/biblio/dombedos/index.htm
CHAPITRE XVI
(Dans l'édition originale de Dom Bedos, il s'agit du chapitre
X)
MANIÈRE D'ACCORDER L'ORGUE
Faire parler les tuyaux, faire la partition, couper les tuyaux en ton, et manière d'accorder l'orgue.
SOMMAIRE.
I. Faire parler les tuyaux à bouche, les couper en ton, faire la partition
et égaliser les tuyaux
.
II. Manière de faire parler, égaliser et accorder les jeux d'anche.
III. Manière d'accorder l'orgue.
C'est ici le chapitre le plus important, puisqu'il s'agit
du son de l'orgue. Tout l'instrument peut être très bien
construit, les tuyaux peuvent être parfaitement bien faits et bien
conditionnés, et cependant faire un fort mauvais orgue. Cet instrument
n'étant fait que pour être entendu, il est essentiel de lui
donner une bonne et agréable harmonie. Les opérations nécessaires
pour cela se divisent naturellement en trois parties, qui composeront
les trois paragraphes suivants. Nous verrons dans le premier comment il
faut faire parler les tuyaux à bouche, les couper en ton ; et conséquemment
nous y joindrons la manière de faire la partition et d'égaliser
le son des tuyaux. On* décrira dans le second les mêmes opérations
sur les jeux d'anche; et on enseignera dans le troisième comment
il faut accorder l'orgue.
* Dans l'édition originale, Dom Bedos écrit
à la première personne du singulier : "Je décrirai
...".
I. FAIRE PARLER LES TUYAUX A BOUCHE,
LES COUPER EN TON ; FAIRE LA PARTITION ET ÉGALISER LES TUYAUX.
Le prestant est le premier jeu qu'il faut faire parler,
puisqu'on doit s'en servir pour faire parler tous les autres. La raison
en est que, pour avoir plus de facilité à faire parler les
tuyaux et pour moins risquer de s'y tromper, il faut les couper en ton
en même temps. Or, pour couper en ton, il est nécessaire
d'avoir un jeu qui soit accordé, sur lequel on puisse se régler:
Le prestant est le plus commode pour cela; nous en avons dit la raison
page 14. Il faut donc accorder le prestant. Il est évident qu'on
ne peut point l'accorder qu'il ne parle auparavant. On donnera en conséquence
ici la manière de faire parler les tuyaux ; on enseignera toutes
les ressources et les expédients qu'on peut mettre en usage pour
cela. On commencera par faire parler les tuyaux à la bouche :
1° Si, en y soufflant, le tuyau ne parle pas du tout, ce qui est rare
lorsqu'il est bien monté, cela viendra de ce
que la lame du vent qui sort de la lumière est dirigée trop
en dehors ou trop en dedans, et qu'elle ne touche point la lèvre
supérieure. On essaiera de faire sortir un peu la lèvre
supérieure ou de la faire rentrer. Si le tuyau alors commence à
donner du son, on reconnaîtra si la lame du vent est dirigée
trop en dedans ou trop en dehors. Si la lèvre supérieure
ne peut pas rester autant en dehors ou en dedans, qu'on vient de la mettre,
sans que le tuyau ne perde de sa grâce, on baissera ou on relèvera
le biseau. En le baissant, on dirige le vent en dedans, et en le rehaussant
on le dirige en dehors. Cette opération doit se faire avec propreté,
avec beaucoup de discrétion, et peu à peu. On apportera
tous ses soins pour rendre la lumière bien égale, tant pour
la hauteur que pour la largeur. Si l'on a trop baissé le biseau,
le tuyau octaviera ; alors on le rehaussera tant soit peu, ou l'on enfoncera
un peu la lèvre supérieure. S'il est tardif à parler,
ce sera une marque que la lèvre supérieure est trop en dedans
; on la fera sortir tant soit peu.
2" Lorsque la lumière est trop étroite, ou autrement
dit, trop fine, le tuyau ne peut pas prendre d'harmonie; il aura toujours
le son sec et maigre. Si on l'élargit trop, le tuyau soufflera,
il ne parlera pas net ; ainsi, il faut un juste milieu. On essaiera
donc de rétrécir ou d'élargir la lumière,
pour éprouver si le tuyau rendra un son qui ait du corps et qui
parle nettement. En général, la lumière étroite,
pourvu qu'elle ne le soit pas excessivement, fait parler le tuyau plus
nettement; mais il ne donne pas une harmonie aussi moelleuse que lorsqu'elle
est un peu plus large.
3° Si le tuyau ne peut rendre assez de son sans octavier, quoiqu'on
ait bien disposé sa lèvre supérieure, et qu'elle
ne soit ni trop en dedans ni trop en dehors, cela viendra de ce qu'il
ne sera pas assez égueulé. C'est ici où il faut de
la discrétion pour égueuler à propos, sans quoi on
gâte un tuyau. On ne peut couper précisément la quantité
convenable de la lèvre supérieure que le tuyau ne soit au
ton. Si l'on égueule le tuyau au point qu'il faut lorsqu'il est
trop long, on le fera bien parler,on lui donnera bien sa véritable
harmonie; mais lorsqu'il sera raccourci et qu'il sera au ton, il se trouvera
trop égueulé, et il ne vaudra plus rien. Or, un tuyau qui
a ce défaut n'a plus de tranchant, plus de moelleux; il crie, il
est sec, il a le son grossier et désagréable. Alors il n'y
a pas d'autre remède que de ressouder un petit morceau à
la lèvre supérieure, ou bien, si le tuyau est encore assez
long, on lui coupera la tête, c'est-à-dire qu'on le sciera
pardessus le biseau et on le remontera. Pour connaître si un tuyau
est trop égueulé, on soufflera dedans très légèrement.
S'il rend tout autre son et tout autre ton qu'il ne doit sonner lorsqu'il
a son plein vent, ce sera une marque qu'il sera trop égueulé.
Tout ce qu'on a dit ici regarde les tuyaux de la montre comme les autres.
Ils sont sujets de plus à friser: cela vient de ce qu'ils ne sont
pas fermes en leur place ou qu'ils touchent contre un autre tuyau voisin.
4° Comme on ne peut pas couper en ton le prestant, à mesure
qu'on le fait parler, pour l'égueuler à propos, il faudra
en tenir les bouches un peu basses : on achèvera de l'égueuler
à son véritable point à mesure qu'on ébauchera
son accord.
5° Les défauts auxquels un tuyau peut être sujet, sont
les suivants :
Il peut être tardif à parler ;
cela vient de ce que la lame de vent ne touche pas assez la lèvre
supérieure, ou de ce que la lumière est trop fine.
Il peut octavier ; cela peut venir de ce
que la lèvre supérieure est trop basse, ou de ce qu'elle
est trop en dehors, ou de ce que le tuyau a trop de vent.
Il peut piauler ; cela peut venir de ce qu'il
y a trop de vent, ou de ce qu'il est trop égueulé, ou de
ce qu'il ne l'est pas assez.
Il peut trembler ; cela peut venir de ce
que le tuyau n'est pas ferme dans sa place, ou de ce que la lèvre
supérieure est trop en dehors, ou de ce que le tuyau n'est pas
assez étoffé.
Il peut être faible de son ; cela peut venir
de ce qu'il n'a pas assez de vent, ou de ce que sa lumière est
trop fine.
Il peut souffler ; cela peut venir de ce que la
lumière n'est pas bien égale d'un bout à l'autre,
ou de ce qu'elle est trop large.
Il peut varier ; cela peut venir de ce qu'il
y a trop de son, ou que sa bouche n'est pas bien régulière,
ou de ce que le tuyau est trop mince, ou qu'il a de l'irrégularité
dans son épaisseur.
Ce tuyau peut n'avoir aucun de tous ces défauts, et avoir le son
sec, maigre, sans fond ni harmonie. Il faudra alors tâtonner toutes
les ressources indiquées ci-dessus. On a toujours supposé
qu'un tuyau n'avait pas de défaut grossier dans sa construction,
comme d'être mal monté, mal embouché, d'avoir des
crevasses, des trous, une grande irrégularité dans l'épaisseur
de la matière : que le tuyau n'était pas trop mince, que
les soudures étaient exactes et solides. Avec un seul de ces défauts
grossiers, on ne tirerait jamais aucun parti d'un tuyau; il serait inutile
de s'y exercer. On trouvera en général qu'un tuyau bien
fait, bien embouché et suffisamment étoffé, ne sera
pas sujet à la plupart des défauts ci-dessus mentionnés,
et qu'on le met bien facilement au point qu'il faut.
6° En général, si l'on tire trop de son d'un tuyau,
il sera criard, dur, et n'aura point d'harmonie. Si on n'en tire pas assez,
il sera faible, sec, et n'aura point de fond. Il n'est pas possible d'exprimer
par paroles la qualité du bon son : c'est une chose que l'on sent
mieux qu'on ne peut le rendre par le discours.
7° A l'égard des tuyaux bouchés, ils sont sujets à
presque tous les défauts mentionnés dans l'article précédent,
et surtout à piauler, à quinter et à nasarder ; trois
défauts auxquels il n'est pas toujours bien facile de remédier.
Un tuyau piaule, quinte ou nasarde lorsqu'il a trop de vent, ou qu'il
n'est pas assez égueulé, et quelquefois lorsqu'il l'est
trop. On tentera tous les expédients dont on a parlé, jusqu'à
ce que ces défauts n'existent plus. On suppose que les tuyaux seront
exactement bouchés, et que toute leur matière sera bien
saine. Les tuyaux de bois bouchés ou ouverts ne sont pas sujets
à tant de défauts, lorsqu'ils ont été bien
faits et bien embouches.
On n'a que les quatre ressources suivantes à employer pour les
faire bien parler :
1" de leur ôter ou donner du vent plus ou moins ;
2° de les égueuler plus ou moins;
3° d'ôter la lèvre inférieure pour agrandir ou
diminuer la lumière ;
4° enfin, de retoucher au chanfrein du biseau pour
diriger la lame du vent de la lumière plus en dedans ou plus en
dehors. On trouve quelquefois un peu plus de difficulté aux grands
tuyaux de bois, surtout lorsqu'ils sont bouchés.
Après qu'on aura fait parler tous les tuyaux du prestant le mieux
qu'on aura pu, on le mettra en place. Il sera temps alors de finir de
régler le clavier, parce que dès qu'il y a un jeu en place
en état de parler, on découvrira les cornements. On travaillera
à les guérir tous, en nettoyant les soupapes bien exactement.
Lorsqu'il n'y en aura plus, on achèvera d'égaliser le clavier
de force et de hauteur. On retouchera, s'il le faut, aux ressorts des
soupapes ; après cela on examinera le prestant sur son vent. S'il
y a des tuyaux qui octavient pour avoir trop de vent, on serrera un peu
leur embouchure ; enfin, on remédiera a tous les défauts
qu'on reconnaîtra. Ensuite, on commencera à ébaucher
son accord et à faire la partition, comme on va l'expliquer.
Manière de faire la partition
La gamme est la progression des sons intermédiaires d'un ton à
son octave. Il y en a de deux espèces, la Diatonique et la Chromatique
(nous ne parlerons point ici d'une troisième, qu'on appelle l'Enharmonique,
dont il ne s'agit pas dans l'orgue). La diatonique est la gamme ordinaire,
ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut, qui est composée
de cinq tons et de deux demi-tons. La gamme chromatique est divisée
en douze demi-tons, qui sont ut, ut dièze, ré, mi bémol,
mi, fa, fa dièze, sol, sol dièze, la, si bémol, si,
ut.
Il n'est pas possible de diviser l'octave en douze demi-tons justes; car
si on l'accorde de façon que tout y soit juste, on se trouvera
outrepasser l'octave d'une quantité très sensible, et jusqu'à
choquer l'oreille, qui ne peut souffrir la moindre altération dans
l'octave. On ne peut accorder l'octave de demi-ton en demi-ton ;
ces intervalles ne pouvant s'apprécier assez sensiblement par leur
harmonie.
On a imaginé d'accorder par quintes, qui sont des intervalles très
sensibles, et par conséquent bien appréciables. Comme l'octave
chromatique contient douze demi-tons, elle contient aussi douze tierces,
douze quartes, douze quintes, etc. Si l'on ne peut diviser l'octave en
douze demi-tons justes, il s'ensuit nécessairement que les douze
tierces, les douze quartes, les douze quintes, etc., ne peuvent pas non
plus être justes. On est donc obligé de rendre un peu plus
petits, ou d'affaiblir d'une certaine quantité ces intervalles
pour parvenir à l'octave juste. C'est cette altération qu'on
appelle le tempérament, ou, en termes de facteurs d'orgues, la
partition. La difficulté de la partition consiste à trouver
le juste point de cette altération, et, s'il convient mieux, de
tempérer également ou inégalement les quintes ;
ou, si l'on se détermine à préférer cette
inégalité, sur quelles quintes on la fera tomber. Les savants,
nous voulons dire les mathématiciens et les harmonistes, ont fait
beaucoup de recherches là-dessus : ils ont bien calculé
et bien disserté. Ils ont imaginé plusieurs systèmes
de tempérament ; chacun a prétendu avoir trouvé
le moins défectueux (car ils le sont tous nécessairement).
Dans le nombre des systèmes qu'on a inventés, il y en a
deux qui sont les plus remarquables: l'un, qu'on appelle l'ancien système,
qui consiste à tempérer inégalement les quintes,
et le nouveau, selon lequel on affaiblit moins les quintes, mais
toutes également.
Les mathématiciens ne se sont pas trouvés d'accord avec
les harmonistes. Ceux-ci, ne consultant que la nature et l'oreille, n'ont
pu goûter cette nouvelle partition, qui leur a paru dure et moins
harmonieuse que l'ancienne. En effet, les quintes n'y sont affaiblies
que d'un douzième de comma (nous verrons bientôt ce que c'est),
et toutes le sont de même; mais aussi il n'y a aucune tierce majeure
qui ne soit outrée, ce qui rend l'effet de cette partition dur
à l'oreille;
Selon l'ancienne partition, on affaiblit environ onze quintes d'un quart
de comma. Cette altération est bien plus considérable qu'un
douzième de comma, ce qui se fait ainsi pour sauver ou rendre justes
huit tierces majeures; et comme en altérant ces quintes d'un quart
de comma, on ne parviendrait pas à l'octave juste, on fait tomber
tout ce qui manque sur une seule quinte que l'on sacrifie, pour ainsi
dire, et qui devient outrée: elle se trouve sur un ton le moins
usité.
Les facteurs appellent cette quinte la quinte du loup.
Quelque respectable que soit l'autorité des savants qui ont imaginé
la nouvelle partition, on n'a pas laissé de l'abandonner, quoique,
selon la théorie, elle paraisse moins imparfaite que l'autre. La
raison que donnent les harmonistes de leur choix, est que les quintes
peuvent souffrir une altération, ou un affaiblissement d'un quart
de comma et même un peu plus, sans perdre leur harmonie. En ce sens,
leur partition n'est pas inférieure à la nouvelle, dont
les tierces toutes outrées choquent nécessairement l'oreille.
Leur fonction de distinguer essentiellement les modes, est trop importante
dans l'harmonie, pour ne pas préférer un système
où il sen trouve le plus grand nombre possible de justes. Le compositeur,
au reste, met à profit les défauts inévitables de
cette partition : il y trouve des avantages pour mieux caractériser
l'esprit de ses pièces. Veut-il composer du gai, du triste, du
grand, du majestueux, etc. ? Il choisit le ton le plus propre à
aider sa modulation, et pour donner plus d'expression à son idée.
Il n'a pas cette ressource dans la nouvelle partition. Tous les tons y
étant égaux, ils expriment tous également, sans que
rien balance la rudesse des tierces (1).
(1) Au reste, quoique nous nommions nouvelle la partition
où l'on affaiblit également les quintes d'un douzième
de comma, elle est peut-être plus ancienne que l'autre, puisque
le P. Mersenne, dans sa seconde partie de L'Harmonie Universelle, imprimée
en 1637, la décrit et enseigne à la faire. Mais on l'a appelée
nouvelle, parce qu'on l'a renouvelée de notre temps et que plusieurs
savants ont voulu la faire adopter. Nous nous en tiendrons à ce
que nous appelons l'ancienne partition, dont nous allons donner la pratique,
après quelques explications préliminaires.
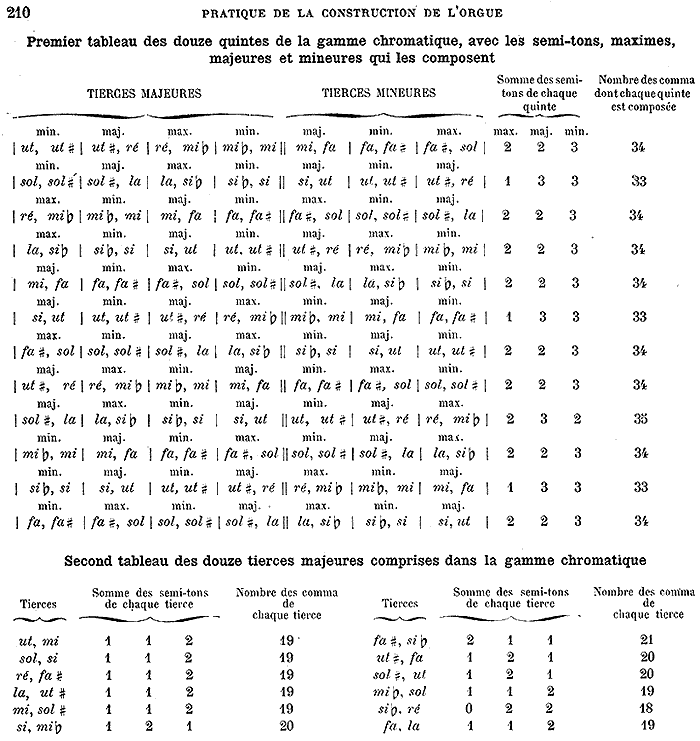
Pour bien comprendre ces tableaux, il faut savoir que chaque
quinte est composée de sept demi-tons, qui ne sont pas égaux
entre eux ; car il y en a de maximes, de majeurs et de mineurs. Les
maximes sont d'un intervalle un peu plus grand que les majeurs.
On peut diviser le demi-ton mineur en 4 comma, le demi-ton majeur en 5,
et le demi-ton maxime en 6.
On appelle comma la neuvième partie d'un ton.
On distingue le ton en majeur et en mineur. Celui-ci est supposé
composé de 9 comma, et l'autre de 10. Ces comma ne sont pas égaux
entre eux ; il en est de quatre espèces, les mineurs, les
moyens, les majeurs et les maximes. Tout cela est d'une profonde théorie,
qui n'est nécessaire qu'au mathématicien, mais bien inutile
à notre objet; puisqu'il n'est pas question ici de chercher de
nouveaux systèmes, mais de pratiquer celui qui est universellement
adopté et en usage parmi tous les facteurs d'orgue. Il suffira
de savoir qu'il y a une différence réelle entre les quintes,
dont on verra bientôt les trois espèces. Il y a aussi des
tierces majeures de quatre espèces. Il y a des quintes de 33, de
34 et de 35 comma. Il y a des tierces de 18, de 19, de 20 et de 21 comma.
Il ne s'agit pas ici d'apprécier à l'oreille les comma,
ni un quart de comma, dont il faut altérer les quintes dans la
partition, cela serait presque impossible dans la pratique; mais il y
a des expédients pour exécuter le tout sans entrer dans
ce détail, un peu trop abstrait pour des ouvriers ordinaires, que
nous avons toujours principalement en vue dans cet ouvrage.
On trouvera dans le premier tableau, en lisant les lignes de gauche à
droite, toutes les quintes avec les semi-tons qui les composent. On y
remarquera la qualité de chaque demi-ton On lira ainsi : de ut
à ut dièze, il y a un demi-ton mineur : de ut
dièze à ré, un demi-ton majeur ; de ré
à mi bémol, demi-ton maxime; de
mi bémol à mi, demi-ton mineur ainsi des autres.
On trouvera sur la même ligne le nombre des demi-tons maximes, majeurs
et mineurs, qui composent cette quinte ut sol; ensuite sur la même
ligne on trouvera le nombre des comma compris dans la même quinte
ut sol. Il y en a 34. On voit par là bien sensiblement combien
et quelles quintes sont de la même espèce ou égales
entre elles. On trouvera qu'il y a 8 quintes de
34 comma, qui sont par conséquent égales entre elles. Ce
sont : ut, sol ; ré, la ; la, mi ; mi, si ;
fa dièze, ut dièze ; ut dièze, sol dièze ;
mi bémol, si bémol ; fa, ut.
Il y en a trois de 33 comma, qui doivent être un peu plus affaiblies
que les huit précédentes ; ce sont : sol, ré ;
si, fa dièze ; si bémol, fa.
Il en reste une dont l'intervalle est plus grand qu'il ne faut, qui est
de 35 comma ; c'est sol dièze. mi bémol.
Les ouvriers appellent cette quinte, la quinte du loup.
Les tierces majeures, au nombre de 12, sont contenues dans le second tableau.
On y voit celles qui appartiennent à une classe, et celles qui
appartiennent
à une autre par le nombre des semi-tons, et surtout des comma qui
les composent.
On trouvera qu'il y en a 7 de 19 comma ; celles-ci sont parfaitement justes,
qui sont : ut, mi ; sol, si ; ré, fa dièze ;
la, ut dièze ; mi, sol dièze ; mi bémol,
sol ; fa, la.
Il y en a une de 18 comma ; celle-ci est un peu faible, mais cependant
encore harmonieuse; c'est si bémol, ré.
Il y en a trois de 20 comma, qui sont : si, mi bémol ;
ut dièze, fa ; sol dièze, ut ; celles-ci sont
outrées.
Il en reste une qui l'est encore davantage, c'est fa dièze,
si bémol, qui est de 21 comma.
Il faut remarquer que de 12 quintes dont l'octave est composée,
on n'en accorde que onze : la douzième, qui est la quinte
du loup, se trouve d'elle-même au point où elle doit être.
On n'accorde aucune tierce, elles se trouvent toutes justes, ou outrées
au point qui leur convient. Les huit bonnes servent de preuve à
la juste altération qu'on doit avoir donnée aux quintes.
Les quatre autres seront d'elles-mêmes outrées, autant qu'elles
doivent l'être.
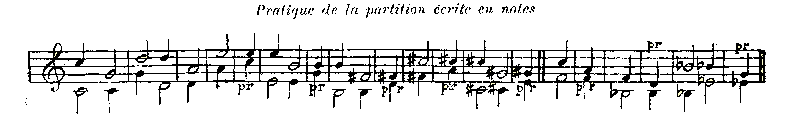
Beaucoup de facteurs commencent la partition par ut,
d'autres par fa, ce qui revient au même.
On expliquera la première manière ; on comprendra par là
la seconde. Mais avant d'aller plus loin, il faut avertir qu'il est important
de mettre l'orgue bien au ton. Il y a le ton de chapelle et le
ton d'orchestre (in Dom Bedos : ton
de l'Opéra); celui-ci n'est pas un ton fixe; on le hausse
ou on le baisse d'un quart de ton, ou même plus, selon la portée
des voix. Le ton de chapelle est fixe en France ; c'est le plus à
la portée des voix et de tous les instruments de musique :
il faut donc monter le tuyau de ton sur celui-là. On l'ajustera
sur un orgue qu'on saura être parfaitement au ton de chapelle.
.jpg) Tuyaux de Ton |
Les notes noires représentent le tuyau sur lequel
on en accorde un autre ; les notes blanches désignent le tuyau
qu'on accorde.
Tous les ut qui sont au-dessous des cinq lignes représentent
celui du milieu du clavier.
On commencera par mettre le quatrième C sol ut du prestant
au ton du C sol ut du tuyau de ton ; mais comme nous supposons
que le jeu de prestant ne sera pas encore dans sa perfection pour son
harmonie, on mettra d'abord ce quatrième C sol ut un peu
plus bas que celui du tuyau de ton. A mesure qu'on mettra au ton l'ut
en question du prestant, et que vraisemblablement on en raccourcira un
peu le tuyau, on travaillera à le faire bien parler dans sa véritable
harmonie, et on le mettra bien juste au ton. On accordera ensuite son
octave plus bas, qui se trouvera être l'ut au milieu du clavier,
comme on le voit noté.
Pour comprendre si deux tuyaux sont ou ne sont point d'accord, soit qu'ils
sonnent à l'unisson ou à la tierce, à la quinte ou
à l'octave, etc., il faut écouter si l'on entend un battement
ou balancement dans leur son. Tant qu'on entendra ce battement, les tuyaux
ne seront pas d'accord. Lorsqu'il cesse entièrement, les tuyaux
sont ordinairement d'accord. On dit ordinairement, parce qu'il peut se
faire qu'on n'entende plus de battement, et que cependant les deux tuyaux
ne soient pas exactement et finement d'accord, puisque, lorsque le battement
a cessé, on peut hausser ou baisser de quelque partie le ton d'un
des deux tuyaux, sans qu'il recommence à battre, surtout si les
tuyaux sont grands. Ce battement, au reste, ne se fait entendre que lorsque
le tuyau est assez près de son accord ; quand il en est bien
éloigné, on ne l'entend plus.
Les deux ut, tels qu'ils sont notés, étant bien d'accord,
on accordera sur l'ut en bas, noté par une note noire, la
quinte au-dessus qui est sol, noté par une note blanche.
On fera d'abord cette quinte juste, en sorte qu'elle ne batte point du
tout; ensuite on baissera un peu le sol, de façon qu'il
fasse à peu près quatre ou cinq battements par seconde (la
durée d'une seconde est à peu près comme chaque pulsation
ou battement du pouls). A cet effet, on retranchera suffisamment de la
longueur du tuyau, et en même temps on le fera bien parler ;
ce que l'on fera à tous les autres tuyaux à mesure qu'on
les mettra au ton. On doit couper du tuyau à plusieurs reprises,
pour ne pas risquer de le raccourcir trop.
Lorsqu'on aura tempéré comme il faut la quinte ut sol,
on accordera la quinte suivante sol ré, comme on le voit
noté. Cette quinte sol ré doit être un peu
plus affaiblie que ut sol ; il faut qu'elle fasse cinq ou six battements
par seconde ; elle est du nombre des trois qui doivent être un peu
plus faibles que les huit autres. Cette quinte sol ré étant
mise à son point, on fera la quinte ré la ; mais
comme il ne faut pas s'éloigner du milieu du
prestant, qui est la partie la plus sensible à l'oreille, et qu'on
risquerait de ne pas accorder si juste si l'on montait trop, on accordera
l'octave en bas de ce ré, selon qu'on le voit noté,
et on fera la quinte ré la qu'on mettra au même point
que ut sol : on fera ensuite la quinte suivante la mi,
qu'on tempérera au même point que ut sol.
Pour savoir si l'on a bien tempéré les quatre quintes déjà
accordées, on confrontera ce dernier mi déjà
accordé avec l'ut le plus près qui aura été
accordé au commencement; ce mi doit faire une tierce majeure
juste et sans battement avec l'ut. Si on entend un battement, ce
sera une marque qu'il sera trop bas ou trop haut. Pour le reconnaître,
on approchera le doigt du bout supérieur du tuyau qui sonne ut
sans le toucher ; son ton baissera un peu. Si le battement alors
cesse ou qu'il diminue, c'est à dire qu'il devienne plus lent,
ce sera un signe certain que le mi est un peu bas. Si, en approchant
le doigt du haut du tuyau, le battement devient plus vite ou plus accéléré,
ce sera une marque que le mi sera trop haut. Dans le premier cas,
puisque le mi se trouve un peu bas, on aura donc trop affaibli
les quatre quintes; on les repassera et on les rehaussera un peu, pour
qu'elles battent tant soit peu plus lentement. On comparera encore le
mi en question avec le premier ut le plus voisin, pour voir
si cette tierce est bien juste. Dans le second cas, on affaiblira un peu
plus les quatre quintes, et on comparera ensemble le mi et l'ut.
Si la tierce se trouve bien juste sans battement,
que les trois quintes soient également tempérées,
et la quinte sol ré soit tant soit peu plus affaiblie que
les trois autres, on sera assuré que le plus difficile de
la partition est bien fait.
On continuera la partition, et on fera mi si, quinte un peu faible,
comme ut sol. Si l'on a tempéré au point qu'il faut
cette quinte mi si, ce si doit faire une tierce majeure
juste avec le sol le plus voisin déjà accordé,
ce qui s'appelle la preuve, comme on le voit écrit au-dessous de
ces deux notes si sol. Si on y entend du battement, on agira comme
on vient de le dire dans l'article précédent ; c'est-à-dire
qu'on reconnaîtra, en approchant le doigt, si le si est trop
haut ou trop bas.
S'il est trop haut, on n'aura donc pas assez affaibli la quinte mi
si; on l'affaiblira un peu plus. S'il est trop bas, on l'aura trop
affaiblie; on la rehaussera un peu. Lorsque cette tierce se trouvera juste,
on fera l'octave en bas du si, pour ne pas monter trop haut ; et
on fera la quinte si fa dièze un peu plus faible que les
autres, c'est-à-dire comme sol ré. On comparera ce
fa dièze avec le ré le plus voisin, qui doit
être à la tierce majeure juste avec le fa dièze ;
c'est la preuve.
On fera ensuite fa dièze ut dièze, quinte un peu
faible, comme ut sol. On fera la preuve, c'est-à-dire qu'on
comparera cet ut dièze avec le la le plus voisin,
qui doivent faire ensemble une tierce majeure juste.
On fera l'octave en bas de ut dièze, et on fera la quinte
ut dièze sol dièze : on fera la preuve comme
les autres. Ce sol dièze doit faire une tierce majeure juste
avec le mi le plus voisin.
En poursuivant la partition dans le même sens que nous avons opéré
jusqu'à présent, il faudrait faire la quinte sol dièze
mi bémol; mais comme c'est la quinte du loup, selon le langage
des ouvriers, et qu'on n'accorde point cette quinte, qui doit se trouver
d'elle-même à son point particulier et qui lui est propre,
l'on est obligé de faire les trois autres quintes qui restent,
en descendant; ainsi l'on accordera sur le quatrième ut
du clavier, comme on le voit noté, le fa suivant, en descendant.
On fera d'abord cette quinte juste; ensuite on rehaussera un peu le fa
pour affaiblir la quinte, et la mettre au même point que sol
ut. On fera la preuve, qui est de comparer ce fa avec le la
le plus voisin.
Si cette tierce majeure se trouve juste, on poursuivra la partition et
on fera la quinte en descendant fa si bémol, cette quinte
doit être tant soit peu plus faible que sol ut ; elle
doit être comme ré sol. On fera la preuve on comparant
ce si bémol avec le ré le plus voisin ; cette
tierce doit être un peu faible et battre lentement.
On fera l'octave au-dessus de si bémol, et ensuite la quinte
en descendant si bémol mi bémol un peu faible, comme
sol ut. On fera la preuve en comparant ce mi bémol
avec le sol voisin ; cette tierce doit se trouver juste, et la
partition sera finie.
Il faut remarquer qu'en faisant la partition, on ne passera
point à une seconde opération, qu'on ne soit bien assuré
de la justesse de la précédente, ce qui a lieu principalement
lorsqu'on la fait sur un prestant neuf, qu'on est obligé de manier
pour le mettre en harmonie, à mesure qu'on fait la partition. Ainsi,
on reviendra, on examinera et on repassera ce que l'on aura fait précédemment,
avant de passer outre. Lorsqu'on aura fini, examiné et reconnu
la partition bien juste, on accordera par octaves tout le reste du prestant,
qui sont les basses et les dessus ; prenant bien garde de toucher aux
tuyaux de la partition, à moins qu'on n'y sente quelque discord.
Pour accorder les tuyaux, on se servira d'accordoirs doubles ou simples.
Les doubles sont représenté dans la planche 1, figure 86,
et l'on voit les simples également représentés dans
la même planche, figure 82.
Voyez pages 12 et 13.
La manière de se servir des accordoirs est de les
tenir verticalement au-dessus des tuyaux. On les fera tourner (en
fait : "tournoyer") un peu en appuyant dessus.
On prendra bien garde que l'effort que l'on fera avec l'accordoir sur
le tuyau ne soit jamais dirigé d'une façon à le faire
pencher ; on le gâterait infailliblement.
Avec le bout pointu, on évasera le bout du tuyau et on rehaussera
par là le ton.
On rétrécira le bout du tuyau par le bout creux de l'accordoir,
ce qui fera baisser le ton ; mais l'effet des accordoirs n'est pas
grand : on ne peut faire hausser ou baisser le ton par leur moyen
que de peu de chose. Si l'on voulait baisser le ton bien sensiblement,
il faudrait ôter le tuyau de sa place, et opérer dessus avec
l'accordoir en tenant le tuyau à la main. Si l'on voulait rehausser
le ton considérablement, il vaudrait mieux en retrancher un peu
avec la cisaille ou le couteau.
On accordera toujours proprement les tuyaux, les conservant bien ronds
et coupés si justes, qu'ils ne soient pas trop évasés
ni trop resserrés. On se gardera bien d'en fendre le bout avec
le couteau, comme font les mauvais ouvriers, pour ne
pas prendre la peine de les raccourcir avec la cisaille.
On ne les pincera point avec les doigts pour baisser le ton. S'il arrivait
qu'il fallût trop resserrer un tuyau, il vaudrait mieux l'ajouter
proprement. On reconnaît un facteur habile, lorsqu'on voit ses tuyaux
accordés proprement et coupés justes, c'est une marque qu'il
ne tâtonne point, et qu'il sait bien faire parler et accorder les
tuyaux.
Dans tout ce qu'on a dit ci-dessus pour accorder le prestant, on a toujours
supposé qu'il parlait bien, et qu'il était par là
en état d'être accordé. Nous avons donné la
méthode entière de l'accorder, pour ne pas y revenir et
ne pas le dire à différentes reprises. Nous n'avons interrompu
notre description que lorsque nous l'avons cru indispensable.
Voici encore quelques observations à faire :
1° On ne peut parfaitement accorder un tuyau
qu'il ne parle bien; ainsi, tout tuyau qui n'est pas dans sa véritable
harmonie, n'est pas susceptible d'un bon et véritable accord. Si
le tuyau parle trop fort, s'il a trop de vent ou s'il n'en a pas assez
; s'il piaule, s'il octavie, s'il tarde à parler, s'il est trop
égueulé, ou s'il ne l'est pas assez ; s'il varie, s'il frise,
s'il est offusqué, etc., tous ces défauts sont un obstacle
à un accord bon et solide.
2° On ne peut jamais faire bien parler un
tuyau qu'il ne soit à son véritable ton, comme on l'a déjà
dit : on peut absolument faire bien parler un tuyau quoiqu'il soit,
par exemple, trop long pour faire le ton auquel il sera destiné ;
mais lorsqu'on l'aura raccourci pour le mettre à son ton, alors
il parlera mal, parce qu'il se trouvera trop égueulé; c'est
pourquoi :
3° on observera de ne retrancher de sa lèvre
supérieure qu'à mesure qu'on le mettra au ton, ou qu'on
le raccourcira, attendu que la hauteur de sa bouche a une connexion nécessaire
à la hauteur du tuyau. On tiendra donc les bouches un peu basses,
et on ne les mettra au point qu'il faut, que lorsque le tuyau sera presque
entièrement au ton : nous disons presque entièrement,
parce qu'il arrive souvent que quand il faut égaliser l'harmonie
d'un tuyau avec celle des autres, on est obligé d'y donner un peu
plus de vent ; alors le ton du tuyau étant un peu rehaussé,
il se trouvera assez court.
4° Il est nécessaire, surtout à
ceux qui n'ont pas une grande expérience, de tenir le prestant
un peu bas, tandis qu'on ébauchera son accord et qu'on le fera
parler, jusqu'à ce qu'il parle bien et qu'il soit égalisé;
alors on le mettra parfaitement au ton et on lui donnera entièrement
son accord.
5° Tout tuyau, de quelque espèce qu'il
soit, peut bien être accordé sur-le-champ après qu'on
l'a manié, ou qu'on y a travaillé ; mais son accord
ne dure point, il baisse son ton à mesure qu'il refroidit. Il s'ensuit
qu'on ne peut donner le dernier accord au prestant, ni à tout autre
jeu, que lorsqu'il ne faut plus toucher aucun tuyau avec les mains pour
l'ôter de sa place ou y faire quelque opération. Si l'on
est obligé de lever un tuyau et de le manier, on doit le laisser
bien reposer après l'avoir remis à sa place. On différera
de l'accorder d'autant plus longtemps, qu'on l'aura manié davantage.
Le même cas a lieu lorsqu'on tourmente beaucoup un tuyau avec l'accordoir,
quoiqu'on ne le touche point avec les mains, parce que cette opération
réitérée de suite échauffe le tuyau.
Le prestant étant bien accordé, on entreprendra de faire
parler la montre.
On commencera par le premier tuyau de huit pieds : on ouvrira bien
son accordoir ; il faut toujours commencer par là.
On fera souffler continuellement, et un homme tiendra basse la touche
relative au tuyau, et son registre ouvert; alors si le tuyau ne parle
pas du tout, cela viendra vraisemblablement de ce que le biseau est un
peu trop élevé : la lame du vent qui sort par la lumière
est dirigée trop en dehors et ne touche point la lèvre supérieure :
il faut donc baisser un peu le biseau ; cette opération se
fera aisément en appliquant horizontalement le bout d'un bec-d'âne
de menuisier sur un bout du bord du biseau, et en donnant un coup de marteau
sur le bec-d'âne tout près de la bouche. Quand on aura ainsi
baissé le biseau par un bout, on le baissera par l'autre, afin
que son élévation soit bien égale d'un bout à
l'autre. Si après cela le tuyau ne parle point, on baissera encore
un peu le biseau, et par cette opération le tuyau commencera sûrement
à parler.
S'il octavie, c'est qu'il aura trop de vent : on baissera un peu
la clef de la plinthe ou du pont, pour lui en ôter ; s'il octavie
encore, on baissera davantage la clef; si alors il devient trop faible
de son, ce sera une marque que sa lèvre supérieure sera
trop basse. On mesurera avec le compas si elle est à l'élévation
de la lèvre inférieure de la cinquième partie de
la longueur de la bouche ; si elle y est, il ne faudra en retrancher
qu'à la dernière extrémité ; et même,
comme on l'a dit ailleurs, il ne faut pas que la lèvre supérieure
soit si haute lorsque le tuyau se trouve de grosse taille pour le ton
qu'il doit faire.
Pendant qu'on opérera sur le tuyau, la touche restera baissée,
mais on la lèvera aussitôt après ; et quand on
aura un peu laissé reposer le tuyau, pour que les vibrations de
sa matière cessent entièrement, on baissera la touche et
on verra si le tuyau prend bien son ton et son harmonie ; car il
faut qu'il ait ces deux qualités. Si le tuyau est trop bas, il
faudra l'approcher de son ton en fendant un peu plus bas son accordoir,
ce qu'on exécutera avec le couteau, sur lequel on frappera avec
un petit marteau. Ensuite on le perfectionnera un peu plus. On fera les
mêmes opérations sur toute la partie de ce jeu qui sera en
montre. On tirera autant de son que l'on pourra des tuyaux, pourvu qu'ils
ne piaulent point, qu'ils n'octavient point, qu'ils soient prompts à
parler, qu'ils ne soient pas plus égueulés qu'on ne l'a
dit, et qu'ils soient égaux de force et d'harmonie. On y reviendra
plusieurs fois et à différentes reprises, pour perfectionner
toujours les tuyaux les plus imparfaits. Égaliser de force, c'est
opérer de façon que tous les tuyaux se fassent également
entendre, et que l'un ne soit pas plus fort que l'autre. Égaliser
d'harmonie, c'est donner à tous les tuyaux la même qualité
de son et d'harmonie; car si l'un avait le son sec et maigre, l'autre
moelleux, etc., ils ne seraient pas égalisés d'harmonie.
Ensuite, on les accordera touche par touche sur le prestant lorsqu'ils
parleront assez bien pour être susceptibles d'accord.
On fera les mêmes opérations sur le jeu
de seize pieds. On le fera bien parler, on l'approchera du ton peu à
peu au moyen du huit pieds; et après l'avoir bien égalisé
de force et d'harmonie, on l'accordera sur le huit pieds et le prestant
ensemble.
S'il y a en montre un trente-deux pieds, on opérera sur ce jeu
comme sur le seize pieds et le huit pieds, et on l'accordera de même.
S'il y a des pédales de flûte en montre ou quelque autre
jeu, on le traitera de même. On comprend bien que tout cela ne peut
être qu'un accord ébauché et imparfait.
A l'égard de tous les autres jeux qui seront sur le sommier, on
les ôtera de leur place l'un après l'autre, pour les ébaucher
à côté du clavier. On prendra d'abord les dessus du
seize pieds, si c'est le premier jeu ; on les apportera sur un banc
ou sur une table auprès du clavier ; là on les fera
parler à la bouche, et on les coupera en ton en même temps.
On remettra cette partie de jeu en place, et on prendra le suivant qu'on
apportera auprès du clavier; on le fera parler, on le coupera en
ton, et on le remettra en place. On fera de même pour tous les autres
jeux, même pour le plein jeu, les cornets, etc.
On fera parler aussi les tuyaux des bourdons, soit bouchés ou à
cheminée, on les coupera en ton en les essayant, bouchés
avec la main ou avec un morceau de planche où l'on aura collé
une ou deux peaux, et lorsqu'ils parleront bien et qu'ils seront coupés
en ton, on les coiffera avec du papier et on les remettra en leur place.
(Les bourdons étant "à calotte soudée",
on les accorde avant de souder ladite calotte).
Pour les tuyaux de bois bouchés ou ouverts, on opérera à
leur place même, avant tous ceux qui doivent parler sur leur vent.
Tous les tuyaux à bouche étant coupés en ton et remis
en place, on les perfectionnera sur leur vent. On les égalisera
de force et d'harmonie. Pour faire cette égalisation comme il faut,
il est nécessaire qu'un ouvrier soit au clavier, d'où il
avertira que tel tuyau (en baissant sa touche) est trop fort ou trop faible.
Celui qui sera en haut ôtera du vent à ceux qui seront trop
forts, et l'augmentera à ceux qui seront trop faibles, au moyen
de la pointe, figure 84, planche 1. Voyez page 13.
Il corrigera tous les défauts, et mettra en même temps tous
les tuyaux au ton, en recoupant ceux qui en auront besoin ; c'est à
quoi le prestant servira toujours.
En un mot, on mettra tous les jeux en état de recevoir le dernier
accord; à cet effet, on les rendra assez parfaits pour qu'il ne
faille plus les toucher avec la main.
II. MANIÈRE DE FAIRE PARLER, ÉGALISER ET
ACCORDER LES JEUX D'ANCHE
La trompette étant langueyée et mise en place, comme on
l'a décrit page 182, on la fera parler sur son vent.
Pour qu'un tuyau d'anche parle bien,
1° sa languette ne doit être ni trop ouverte ni trop fermée
;
2" il faut qu'elle soit bien dégauchie et qu'elle ait sa tournure
régulière. Si elle est trop ouverte, le tuyau sera tardif
à parler. Si elle est trop fermée, il sera trop prompt ;
il n'aura jamais assez de son ; il aura toujours une mauvaise harmonie.
Si la languette est gauche, ou que sa tournure soit irrégulière,
le tuyau râlera et parlera mal.
On connaîtra qu'une languette est dégauchie, si, en la regardant
par son bout, on s'aperçoit que sa distance de l'anche est exactement
égale de chaque côté. Nous aurons bientôt occasion
d'expliquer encore tout ceci un peu plus amplement.
Revenons au jeu de la trompette. On commencera à opérer
par le plus petit tuyau, qu'on fera parler avec le prestant. Si, lorsque
l'on baisse la touche, le prestant parle plus tôt que le tuyau d'anche,
celui-ci sera regardé comme tardif à parler. Il faut alors
prendre le tuyau, tenir appliqué contre l'anche le bout de la languette
avec le doigt, et frotter la languette avec le dos de la lame du couteau
contre l'anche. Cette opération fera fermer un peu la languette ;
on essaiera le tuyau sur son vent : si on l'a trop fermée,
le tuyau sera trop prompt; en ce cas, on l'ouvrira un peu.
Pour ouvrir une languette, ce qu'on appelle lui donner plus de ressort,
on passera le couteau entre l'anche et la languette, et tenant le gros
doigt (de la même main que le couteau) contre la languette appuyée
ou portant sur la lame du couteau, on fera glisser et sortir celui-ci
en le tournant un peu en dehors.
Il n'en est pas des jeux d'anche comme des jeux à bouche :
on ne peut faire parler comme il faut ceux-ci que lorsqu'on les a coupés
à leur véritable ton ; on en a vu la raison plus haut.
Mais on ne peut couper en ton un tuyau d'anche que lorsqu'il parle bien,
autrement il se trouverait presque toujours trop court. Tant que le tuyau
aura quelque défaut, comme d'être trop prompt, d'être
tardif, de râler; en un mot, tant qu'il ne parlera pas bien, on
se gardera de le couper ou de le raccourcir.
Il faut distinguer entre le ton propre d'un tuyau d'anche et celui du
prestant qui lui répond. Lorsqu'on fait parler le tuyau d'anche,
il est ordinairement un peu plus long qu'il ne faut ; par conséquent,
son ton propre doit être un peu plus bas que celui du prestant qui
lui répond. Il faut d'abord le faire bien parler à son ton
propre avant de le couper pour le mettre au vrai ton du prestant. On doit
remarquer que lorsqu'on veut mettre un tuyau d'anche au ton qui lui est
propre, selon la longueur où il se trouve, on le fait monter en
baissant la rasette (on suppose que celle-ci touchait le coin) :
le son devient mâle, harmonieux. Si l'on baisse un peu plus la rasette,
le son devient plus doux, plus tendre, mais moins mâle et moins
éclatant. Si l'on baisse encore la rasette, le son diminue, il
s'éteint et devient sourd ; si l'on baisse encore la rasette,
le son double, c'est-à-dire qu'il monte tout à coup d'un
ton ou d'une tierce et quelquefois davantage ; il change d'harmonie,
et ce son ne vaut rien. On le fait redescendre en rehaussant la rasette,
jusqu'à ce qu'il revienne à son vrai ton, qui doit être
mâle, éclatant et harmonieux, et faire sentir un bourdon
qui parlerait ensemble avec le tuyau d'anche.
Pour reconnaître si un tuyau d'anche parle bien, il faut le mettre
à son propre ton : comme c'est l'unique moyen d'en bien juger,
on les y mettra tous. On retouchera toujours à ceux qui paraîtront
les plus imparfaits, jusqu'à ce que tous parlent bien sans aucun
défaut. Il sera temps alors de les couper en ton pour les accorder
avec le prestant. On les coupera peu à peu, 2 millimètres
à l'un, 5 millimètres à l'autre,
7 millimètres à celui-ci, 9 millimètres à
celui-là, selon leur grandeur, et selon qu'ils seront éloignés
du ton du prestant ; mais surtout, on les coupera avec tant de précision,
que leur harmonie soit aussi belle qu'auparavant.
Lorsqu'on les aura un peu coupés, on examinera s'il y en a quelqu'un
qui ait nouvellement acquis quelque défaut. Si on le reconnaît,
on retouchera à sa baguette jusqu'à ce qu'il parle bien,
et on achèvera de le couper petit à petit, jusqu'à
ce qu'il soit bien au ton. Il arrive quelquefois qu'un tuyau vient facilement
au ton du prestant après qu'on a retouché à sa languette,
quoique avant cette petite opération il ne pût y monter,
paraissant un peu trop long, ce qui prouve combien il faut être
réservé à ne le raccourcir que lorsqu'il parle bien
et sans défaut.
Lorsqu'un tuyau parle bien, il supporte une plus grande longueur sans
doubler (quand il est d'accord avec le prestant), que s'il ne parlait
pas si bien. Et plus un tuyau est long, plus il est harmonieux, pourvu
qu'il ne soit ni sourd ni trop doux. Un habile facteur qui maniera bien
un jeu d'anche, le tiendra toujours plus long qu'un autre qui ne sera
pas si expert.
On coupera les tuyaux suffisamment pour qu'ils soutiennent ferme leur
ton d'accord avec le prestant sans doubler. Pour les éprouver,
on mettra la main dessus un instant tandis qu'ils parlent, comme si on
voulait les boucher; alors le tuyau commencera à doubler; mais
il se remettra de lui-même au ton aussitôt qu'on aura ôté
la main. S'il ne se remet pas de lui-même, ce sera une marque qu'il
sera un peu trop long, pourvu d'ailleurs qu'il ne soit pas trop prompt
et qu'il parle bien. En ce cas, on en coupera un peu, comme, par exemple,
2 millimètres ou 3 millimètres si le tuyau est moyen, ou
5 millimètres s'il est grand.
On observera que pour éprouver si un tuyau est assez prompt, il
faut le laisser reposer un moment, comme une demi-minute, l'ayant fait
cesser de parler. On baissera ensuite la touche : il doit partir
ou parler aussi promptement que le prestant. En général,
il est plus difficile d'allier ensemble la promptitude à parler
avec la belle harmonie, que de séparer l'une de l'autre. Il est
plus aisé de faire rendre à un tuyau une belle harmonie,
si l'on veut souffrir qu'il tarde un peu à parler; mais comme l'on
touche les orgues aujourd'hui avec volubilité, il est nécessaire
de rendre les jeux d'anche très prompts à parler, parce
qu'on en fait usage dans la plus grande exécution.
S'il y a quelque tuyau qui râle, c'est-à-dire qui ne parle
pas net, ce sera une marque que la languette sera gauche, ou qu'elle n'a
pas une tournure régulière, ou que sa courbe commence trop
haut ou trop bas.
On y remédiera, soit en passant le dos du couteau par-dessus la
languette sur l'endroit où elle relève trop, soit en le
passant en-dessous pour relever l'endroit qui en a besoin. Il est assez
rare que ces opérations réussissent bien lorsque la languette
a une tournure qui a quelque irrégularité. II sera mieux
de l'ôter et de la redresser sur un bois avec le couteau ;
on lui fera prendre la tournure qu'il faut, et on la remettra dans sa
place.
Plus on raccourcit les tuyaux, plus ils ont d'éclat; mais ils sont
moins moelleux, le son en est moins tendre, on ne sent pas si bien leur
bourdon. Si on les laisse trop longs, ils perdent leur tranchant, ils
ont le son trop rond, ils sont sourds et ils ont moins d'éclat.
L'une et l'autre extrémités sont désagréables,
et font que des jeux d'anche ne seront jamais estimés par les connaisseurs
en harmonie : il faut donc prendre un juste milieu, qui est de ne
les tenir ni trop longs ni trop courts.
Or, pour chercher cette bonne et véritable harmonie, on les laissera
d'abord aussi longs qu'ils pourront soutenir ferme leur ton d'accord,
sans doubler; ensuite on fera descendre tant soit peu le ton en rehaussant
la rasette.
Si, en augmentant son éclat, il conserve ou acquiert une belle
harmonie, qui soit tendre, moelleuse, qu'on sente toujours son bourdon
et que le son en soit plus mâle, qu'il ait plus de corps, il ne
faut pas faire difficulté de raccourcir un peu le tuyau, ce qui
étant fait, on le remettra au ton. On le fera encore descendre;
s'il devient meilleur, on en coupera un peu plus: c'est là où
il faut être connaisseur en harmonie, où il convient d'avoir
le bon goût, c'est ce qui fait l'habile facteur. Un petit nombre
acquièrent cette connaissance par une longue expérience.
Il faut de la pratique pour faire un jeu d'anche qui ait toutes les qualités
qui paraissent contraires, en sorte qu'il soit éclatant, brillant,
tranchant, fier, mâle, prompt, et cependant moelleux.
Ce n'est pas en donnant plus ou moins de vent qu'on rend un tuyau d'anche
prompt, ou d'une différente harmonie, ou plus ou moins éclatant;
par conséquent, ce n'est pas par là qu'on égalisera
le jeu. Les embouchures des pieds se font à peu près de
la grandeur des trous respectifs du sommier, et on n'y touche plus, du
moins cela est fort rare. La manière d'égaliser de force
et d'harmonie un jeu d'anche s'exécute toujours par la languette
et la longueur du tuyau. Si l'un est sourd et l'autre criard, cela viendra
de ce que le premier tuyau sera trop long et le second trop court. La
même cause rendra l'un doux et l'autre aigre; si l'un a un son mâle,
plein, et l'autre maigre et sec, cela viendra de ce que l'un a sa juste
longueur et l'autre ne sera pas assez long.
Ainsi, pour égaliser un jeu d'anche, on observera exactement l'égalité
et la justesse des longueurs respectives, et on fera en sorte qu'un tuyau
ne soit pas plus preste ni plus lent que l'autre. Il est encore nécessaire
qu'un tuyau ne soit pas langueyé fort et l'autre faible ; c'est
ce qu'on reconnaîtra, comme on l'a dit ailleurs, par l'endroit où
restera la rasette sur la languette lorsque le tuyau sera d'accord.
S'il arrive qu'on ait trop raccourci un tuyau, il ne faut pas faire difficulté
de le rallonger; mais on se gardera bien de suivre la mauvaise pratique
de certains facteurs qui allongent le tuyau par l'anche; ils la font sortir
davantage hors du noyau ; alors on a un peu rallongé le tuyau,
mais il n'est plus anché solidement, et son accord ne durera point;
il sera sujet à se déranger, à changer d'harmonie.
Pour ajouter proprement un tuyau conique, on le mettra sur un moule qui
y aille juste ; on fera un patron de papier qu'on ploiera autour
du moule contre le bout du tuyau. Lorsqu'on verra que ce papier ira assez
bien, on taillera un morceau de la même matière
et de la même épaisseur que celle du tuyau ; on la coupera
jusqu'à ce qu'elle joigne bien et qu'elle suive exactement l'angle
du tuyau ou sa figure conique ; on blanchira le tout et on le soudera
avec de la soudure à tourner. On lavera tout le blanc et on le
repassera sur le moule. On mettra le tuyau en place, on le raccourcira
au point qu'il faut. On suppose qu'on en aura ajouté un peu plus
qu'il n'est nécessaire, comme cela convient.
Il y en a qui font tenir une goutte de cire au bout extérieur des
languettes lorsque les tuyaux sont grands. On prétend que cet expédient
rend les tuyaux plus prompts à parler, ou qu'ils parlent mieux.
Nous avons peine à croire que cela soit d'aucune utilité,
et que cette cire puisse produire aucun bon effet. Un ouvrier qui est
au fait de bien manier les languettes n'a jamais besoin d'un aussi mince
secours pour faire bien et promptement parler un tuyau.
On sait qu'une bombarde est comme une trompette, par conséquent
il faut la traiter de même. Toute la difficulté consiste
dans les basses, surtout lorsqu'il y a un ravalement qui descend plus
bas que le premier C sol ut de seize pieds. Ces tons si bas sont
fort difficiles à apprécier, c'est ce qui fait la principale
difficulté de traiter une bombarde. On s'assurera d'abord de la
force des languettes. Voyez ce qu'on en a dit, page 183. On commencera
à faire parler ce jeu par les dessus, et l'on mettra bien en règle
les trois dernières octaves, parce qu'elles serviront à
apprécier le ton des tuyaux des basses. Après le C sol
ut de huit pieds, on fera parler le B fa si en descendant,
et les suivants jusqu'à F ut fa de douze pieds.
Jusque-là il n'y a pas un grand embarras, mais la difficulté
commence à l'E si mi, et plus on descend, plus la difficulté
augmente, surtout pour ceux qui n'ont pas une grande pratique. Pour s'assurer
du ton du tuyau, il faudra se servir de son doublement. On suppose qu'on
travaille sur le C sol ut de seize pieds ; on fera monter
peu à peu et bien lentement le ton du tuyau en l'écoutant
avec une grande attention jusqu'à ce qu'il double; on le fera alors
redescendre jusqu'à ce qu'il revienne à son ton naturel.
Si le tuyau parle bien, ce doublement sera plus sensible; mais il faut
être averti qu'on ne doit pas s'attendre qu'il soit aussi sensible
ou aussi frappant que dans un tuyau médiocre de trompette. Lorsque
le tuyau sera revenu à son ton naturel, on le confrontera avec
son octave : on examinera si on en est ou plus ou moins éloigné.
Pour l'éprouver, on baissera ou l'on rehaussera un peu le ton de
son octave, et on verra par là si le tuyau dont il s'agit est trop
bas ou trop haut. Il n'est pas encore bien facile de le reconnaître ;
car, un C sol ut de seize pieds de bombarde faisant entendre, même
assez sensiblement, la tierce dans son harmonie, on peut bien prendre
la tierce pour l'ut. Ce n'est pas l'affaire d'un moment pour s'assurer
du vrai ton de ce tuyau ; il faut y mettre un temps suffisant pour
le discerner. C'est encore bien autre chose quand il s'agit d'un ravalement
de bombarde, surtout s'il descend jusqu'en F ut fa de vingt-quatre
pieds; et plus difficile encore s'il descend jusqu'au C sol ut
de trente-deux pieds. Lorsqu'on traite des tuyaux si difficiles, et qui
demandent l'expérience la plus longue et la plus consommée,
il faut interrompre l'ouvrage après s'y être exercé
pendant quelques heures, et travailler à une autre chose; on y
reviendra une autre fois. A force de s'y remettre à différentes
reprises, et de répéter les épreuves dont on vient
de faire mention, on viendra à bout de s'assurer du ton de ces
tuyaux, pourvu que, d'ailleurs, on ait une grande pratique. Ce n'est pas
encore une petite difficulté de les faire bien parler et promptement :
on ne conseillerait pas à un commençant de faire une telle
entreprise. Du reste, lorsqu'on sera bien assuré du véritable
ton de ces tuyaux, on tâtonnera leur harmonie en les faisant un
peu descendre pour voir s'il faut les raccourcir ou non. Voyez là-dessus,
page 215.
Pour le clairon, il est d'usage de faire parler les dessus une octave
plus haut que ne porte la longueur de ses tuyaux, pour donner plus de
corps à leur son. Quoiqu'ils sonnent une octave plus haut que leur
taille ne porte, ils sont également sujets à un second doublement
comme les autres tuyaux ; car il faut remarquer qu'un tuyau de trompette,
quel qu'il soit, même les tuyaux des basses de bombarde, qui a doublé
lorsqu'on l'a fait monter plus haut qu'il ne faut, doublera encore si
on le fait monter une octave plus haut : ce second doublement des
tuyaux du dessus du clairon servira également pour les mettre en
harmonie.
Il est des facteurs qui font monter le clairon d'un bout à l'autre,
et tout entier à l'unisson du prestant; mais c'est une chose difficile.
Après tout, ce n'est pas la peine de s'exercer beaucoup à
un ouvrage si délicat, pour ne produire presque rien ; car les
quatre ou cinq derniers tuyaux ne font presque aucun effet, ils se discordent
très souvent et sont fort sujets à ne point parler. Ceux
qui les font parler à l'unisson de la trompette sont à imiter.
Le cromorne se traitera à peu près comme la trompette; mais
ce jeu est plus délicat pour la juste longueur des tuyaux :
2 millimètres de plus ou de moins y sont bien sensibles pour la
qualité de l'harmonie. Le Cromorne, surtout dans les basses, est
difficile à bien traiter et à faire bien parler. La courbe
des languettes doit être un peu plus basse que pour la trompette,
mais c'est de très peu. Plus le Cromorne est anché grand,
plus il est difficile à bien traiter. On en vient plus aisément
à bout lorsqu'il est anché un peu plus petit, mais le son
en a moins de corps. Il ne s'agit pas de chercher un grand éclat
dans ce jeu, mais beaucoup de tendre et de moelleux. Il est essentiel
qu'il parle bien promptement et bien nettement.
Le hautbois doit être langueyé un peu plus fort que les autres
jeux, selon la pratique de certains bons facteurs; mais d'autres préfèrent
le langueyer plus faible; il y en a même qui donnent un peu de recuit
aux languettes. Ce jeu doit avoir beaucoup de brillant et d'éclat,
sans négliger le moelleux.
Il faut traiter la trompette de récit un peu plus délicatement
que les quatre autres trompettes, c'est-à-dire qu'il faut la tenir
tant soit peu plus longue, sans pourtant qu'elle ait rien de sourd. On
doit l'égaliser de force et d'harmonie avec beaucoup de soin.
La trompette du positif doit aussi se traiter délicatement, et
presque autant que celle du récit. Il faut la travailler avec beaucoup
d'attention.
Les trompettes et clairons de pédale doivent
avoir le son mâle, fier, plein, éclatant et harmonieux. Leur
son doit être un peu plus fort que celui des autres trompettes ;
aussi on les fait de plus grosse taille, on les anche et on les langueye
plus fort. Cependant, on prendra bien garde de ne pas les raccourcir trop
pour leur donner plus d'éclat; on leur ôterait leur moelleux
et leur bourdon qui doit toujours se faire sentir dans tous les jeux d'anche.
La voix humaine est un jeu d'une nature différente de tous les
autres jeux d'anche. Il n'est pas question d'harmonie dans ce jeu, tous
les tuyaux y sont courts. Il faut seulement s'appliquer à faire
bien parler les tuyaux et les égaliser par les languettes. Comme
on touche le plus souvent ce jeu avec le tremblant doux, il faut essayer
chaque tuyau avec cette modification de vent. On a quelquefois beaucoup
de peine à empêcher qu'ils ne fassent bien des grimaces,
qu'ils ne varient avec le tremblant doux et qu'ils ne soient lents à
parler. Si le tremblant doux se trouve bon, ce dont on n'est pas toujours
maître, la voix humaine imitera bien la voix naturelle de l'homme;
mais s'il n'est pas bon, ce sera un jeu de peu d'importance, et dont on
ne fera pas grand usage.
Lorsque plusieurs jeux d'anche jouent ensemble, ils doivent partir en
même temps, surtout les pédales. Il serait fort désagréable
d'entendre plus tôt la trompette, ce qui arrive lorsque les tuyaux
ne sont pas également prompts.
III. MANIÈRE D'ACCORDER L'ORGUE
lorsque tous les tuyaux à bouche parleront bien, et qu'ils seront
bien ébauchés pour l'accord, on procédera au dernier
accord en commençant par le positif. On accordera d'abord le prestant
dont on vérifiera soigneusement le premier tuyau de la partition,
pour qu'il soit bien au ton de chapelle. On fera ensuite la partition
avec tous les soins indiqués page 211.
Si le prestant du grand orgue était bien d'accord, on pourrait
accorder celui du positif sur l'autre, touche par touche; mais comme on
ne l'entend pas assez bien, on accordera celui du positif séparément,
après qu'on aura pris avec une grande précision le ton de
chapelle, comme nous venons de le dire. On observera toujours le milieu
de l'accord, mais sur les basses on se tiendra au haut de l'accord, sans
pourtant entendre aucun battement.
On accordera le huit pieds sur le prestant en commençant par le
dessus, touche par touche, et on finira par les basses, en les tenant
toujours sur le haut de l'accord, ce qui est une règle générale.
Ensuite on accordera le seize pieds, s'il y en a, sur le huit pieds et
le prestant ensemble; après, le petit bourdon avec le seul prestant.
On accordera les seconde et troisième octaves du nasard sur le
seul prestant, lesquelles étant bien d'accord à la quinte,
on fermera le prestant, et on accordera les première et quatrième
octaves du même jeu par octaves. Comme on a quelquefois de la peine
à reconnaître dans les plus petits tuyaux s'ils sont trop
hauts ou trop bas, on approchera, pour le bien distinguer, le doigt ou
l'accordoir du bout du petit tuyau ou de son octave sur laquelle on l'accorde :
on verra par là si le petit tuyau est trop haut ou trop bas. C'est
une méthode assez générale qu'avant de toucher à
un tuyau pour le baisser ou le hausser, il faut connaître s'il est
haut ou bas, afin de ne pas le tourmenter inutilement. Si en approchant
l'accordoir son battement augmente, c'est une marque qu'il est trop bas;
s'il diminue, il est trop haut. Si l'on approche le doigt ou l'accordoir
du tuyau sur lequel on accorde, et que par là le battement diminue,
le petit tuyau sera trop bas ; si le battement augmente, il sera
trop haut. Comme dans les grands tuyaux qui sonnent fort bas, on a la
même peine à distinguer si leur ton est trop haut ou trop
bas, on approchera la main de leur bouche ou de leur accordoir :
si le battement alors diminue, le tuyau sera trop haut ; s'il augmente,
il sera trop bas.
Pour accorder la tierce, on accordera premièrement la doublette
sur le prestant, et lorsqu'elle sera bien d'accord, on accordera à
la tierce majeure de la doublette la seconde octave de la tierce, le prestant
étant ouvert. On fera bien attention de ne pas prendre la tierce
mineure, ou la quarte, pour la tierce majeure, les commençants
s'y trompent quelquefois. Afin de ne rien risquer, on fermera la tierce
et le prestant, et on touchera la tierce majeure sur la doublette pour
en mettre bien le ton à l'oreille ; il faudra se servir de
cet expédient quand on coupera en ton la tierce auprès du
clavier. Quand elle sera ainsi ébauchée, on ne risquera
plus de s'y méprendre lorsqu'il faudra l'accorder sur le sommier.
Quand on aura accordé exactement la seconde octave, on accordera
tout le reste du jeu par octaves, la doublette et le prestant étant
fermés.
On accordera enfin le larigot sur le nasard, touche par touche. Les sept
à huit derniers tuyaux sont les plus difficiles de tout l'orgue
à accorder, attendu qu'ils sont extrêmement aigus. On aura
recours aux expédients indiqués dans l'article précédent
pour reconnaître leur ton et s'ils sont trop hauts ou trop bas.
Il ne faut pas se presser beaucoup pour accorder ces tuyaux; on y mettra
le temps nécessaire.
Lorsqu'on aura accordé tous ces jeux séparément,
on les accordera ensemble. Le prestant sera toujours ouvert, et on tiendra
la première touche baissée. On ouvrira le huit pieds et
on écoutera s'il est bien d'accord avec le prestant, si on entend
quelque battement, on y retouchera. On ouvrira ensuite le petit bourdon,
ensuite les seize pieds, s'il y en a ; ensuite le nasard ; ensuite
la doublette ; ensuite la quarte ; ensuite la tierce ;
et enfin le larigot. On écoutera le tuyau de chaque jeu à
mesure qu'on l'ouvrira, et on l'accordera s'il en a besoin. On fermera
tous les jeux, excepté le prestant : on baissera la touche
suivante ; on ouvrira tous ces jeux les uns après les autres ;
on retouchera aux tuyaux qui ne seront pas bien d'accord, et on les refermera.
On poursuivra cette manœuvre sur toutes les touches du clavier ;
ensuite, pour éprouver encore mieux la justesse de l'accord, on
ouvrira tous ces jeux, et on examinera les octaves ensemble. Si l'on trouve
de la défectuosité dans l'accord, on y remédiera.
Tous ces jeux une fois bien d'accord, on accordera le cornet sur le seul
prestant; mais auparavant il faut s'assurer si tous les tuyaux du cornet
parlent bien, et s'ils sont égalisés
de force et d'harmonie. A cet effet, on bouchera les quatre derniers tuyaux
du cornet sur la première marche, et on battra sur la touche (le
prestant étant fermé) pour voir si le bourdon du cornet
parle bien, selon la force et l'harmonie qu'il doit avoir. On bouchera
le bourdon du cornet, ce qui se fait en mettant un morceau de papier dans
sa bouche ; on débouchera le prestant du cornet, on battra
sur la touche ; on bouchera celui-ci, et on débouchera le
nasard du cornet ; on battra encore la touche ; on bouchera
celui-ci, on débouchera la quarte et on battra la touche. On bouchera
la quarte, on débouchera la tierce et on battra sur la touche.
On fera la même manœuvre sur toutes les marches du cornet pour
éprouver s'il n'y a pas quelque tuyau qui parle mal et qui ait
besoin d'être retouché.
On ouvrira le prestant, on bouchera les quatre derniers tuyaux de la première
marche du cornet; et, la touche du clavier relative à cette première
marche étant baissée, on accordera le premier tuyau, qui
est le bourdon du cornet. On bouchera ce tuyau, on débouchera le
suivant, qui est le prestant du cornet, et on l'accordera. On le bouchera
et on débouchera le suivant qui est le nasard du cornet. Lorsqu'il
sera accordé, on ouvrira le nasard du sommier pour voir s'ils sont
bien d'accord ensemble : s'ils ne le sont pas, on retouchera à
l'un ou à l'autre selon le besoin. On fermera le nasard du sommier;
on bouchera celui du cornet et on débouchera le quatrième
tuyau du cornet, qui est la quarte du nasard : on l'accordera et
on ouvrira la quarte de nasard du sommier pour entendre s'ils vont bien
ensemble. On fermera celui-ci ; on bouchera ce quatrième tuyau
du cornet ; on débouchera le cinquième, qui est la
tierce; on l'accordera et on ouvrira la tierce du sommier. Si elles vont
bien ensemble, on fermera la tierce du sommier: on procédera de
même à l'accord de la seconde marche et ensuite à
celui de toutes les autres.
Lorsqu'on aura ainsi accordé séparément tous les
tuyaux du cornet, on les accordera ensemble. A cet effet, le prestant
étant ouvert, on débouchera le bourdon du cornet, puis le
prestant du cornet, puis le nasard du cornet ; ensuite le nasard
du sommier ; ensuite la quarte du cornet ; et après,
la quarte du sommier ; enfin, la tierce du cornet, puis la tierce
du sommier. A mesure qu'on débouchera chaque tuyau, on verra s'il
est d'accord et s'il va avec le jeu semblable du sommier. Si l'on entend
quelque battement, on retouchera à l'accord du tuyau qui le cause,
soit à celui du cornet, soit à celui du sommier.
Il faut remarquer que lorsqu'on accorde les jeux dont les tuyaux sont
posés alternativement d'un côté et de l'autre sur
le sommier, comme ils le sont presque tous, il faut baisser les touches
alternativement en en omettant toujours une (sur deux) ;
on reviendra ensuite à toutes celles qu'on aura omises. On le pratique
ainsi pour la commodité de celui qui accorde, afin de ne pas le
faire courir continuellement d'un coté de l'orgue à l'autre,
ce qui, à la longue, serait bien fatiguant; d'ailleurs, il perdrait
de vue la suite des tuyaux, qu'il faudrait chercher chaque fois qu'il
changerait de place; cela ferait perdre beaucoup de temps.
Pour accorder le plein jeu, c'est-à-dire la fourniture et la cymbale,
on ouvrira ces deux jeux ensemble. On mettra un plomb sur le second C
sol ut du clavier, car c'est par là qu'il faut commencer; et
les tuyaux parlant, on bouchera tous ceux qui seront sur cette marche.
Pour boucher ces tuyaux, on se servira de bouchons de soie, figure
83, planche 1. Voyez page 13.
On choisira les bouchons proportionnés à la grandeur des
tuyaux. On ôtera le bouchon du premier tuyau de la marche, c'est-à-dire
le plus grand ; on battra sur la touche pour voir s'il parle bien :
s'il a quelque défaut, on le corrigera. Quand on sera assuré
qu'il parlera selon la force et l'harmonie qu'il doit avoir, on le bouchera,
et on débouchera le suivant, sur lequel on fera la même opération.
Ce second tuyau étant perfectionné, on la bouchera et on
débouchera le troisième ; ainsi de tous les autres
qui seront sur la même marche.
Tous les tuyaux de la même marche parlant bien, on ouvrira tous
les jeux de fond qui doivent être mêlés avec le plein
jeu, comme les huit pieds, seize pieds, prestant et doublette. On les
écoutera un moment pour voir si l'on n'entendra point quelque battement.
On y retouchera s'il y a lieu ; car avant d'accorder une touche de
plein jeu, on commencera toujours par s'assurer du parfait accord du fond,
les fournitures et cymbales étant bouchées, et, cependant,
leurs registres étant toujours ouverts. On débouchera le
premier, on l'accordera, on le recoupera s'il le faut; on le bouchera
ensuite, et on débouchera le second qu'on accordera de même
sur le fond. On le bouchera et on accordera le troisième, et ainsi
des autres qui seront sur la même marche. Comme il s'y trouvera
de doubles et de triples octaves, de doubles et de triples quintes, on
pourrait avoir quelque peine à accorder ces tuyaux si aigus et
si éloignés du fond ; alors on débouchera celui
qu'on jugera convenable dans la marche sur laquelle on travaille, lequel
étant déjà accordé, pourra servir d'octave
ou de quinte intermédiaires pour accorder les tuyaux suivants sur
la même marche.
On aura été vraisemblablement obligé de toucher et
de manier quelques-uns des tuyaux déjà accordés,
soit pour les guérir de quelque défaut qu'on y aura trouvé,
soit pour les raccourcir quelque peu, soit enfin pour y passer à
la main l'un ou l'autre bout de l'accordoir; il faudra donc recommencer
à accorder séparément chaque tuyau en particulier
comme la première fois.
Lorsqu'on aura ainsi accordé tous les tuyaux de cette marche séparément,
il faudra les accorder ensemble. A cet effet, on les débouchera
les uns après les autres et on retouchera l'accord, s'il est besoin,
à mesure qu'on les débouchera. Ce sont les tuyaux à
l'unisson qui sont les plus sujets à n'être pas d'accord
ensemble, quoiqu'ils le soient séparément. On tâtonnera,
avec le bout de l'accordoir, lequel des deux unissons il faudra baisser
ou rehausser, et l'on opérera en conséquence.
Il faut remarquer qu'il est facile d'accorder la fourniture et la cymbale
(c'est-à-dire le plein jeu) lorsque les tuyaux parlent bien, et
qu'il est très difficile de l'accorder quand il y a quelque tuyau
qui parle mal, soit qu'il crie, qu'il octavie ou qu'il
piaule, etc. Il arrive souvent que, quoiqu'on ait bien fait la première
opération qui consiste à faire bien parler les tuyaux, il
sen trouve pourtant quelqu'un qui acquiert quelque défaut en l'accordant,
parce qu'on l'aura éreinté avec l'accordoir sans sen apercevoir.
Dans ce cas, on aura plus tôt fait de revenir à la première
opération, de boucher les tuyaux et de faire battre la touche sur
chacun séparément, tout le fond étant fermé.
On découvrira par ce moyen quel tuyau se trouvera défectueux.
On y remédiera, et on le repassera à l'accord avec les autres,
après qu'on l'aura laissé assez reposer. Lorsqu'on aura
accordé tous les tuyaux sur une marche, en sorte qu'on n'y entende
plus le moindre battement, on fera les mêmes opérations sur
toutes les autres jusqu'au haut du clavier.
Après cela, on entreprendra la première octave, et à
mesure qu'on en aura accordé une touche, on la confrontera avec
son octave en dessus. Quoiqu'on ait bien accordé sur le fond, par
exemple, le premier C sol ut, il se trouve quelquefois un peu bas,
étant comparé avec le second C sol ut, son octave.
En ce cas, on recommencera à accorder le premier C sol ut
pour le rehausser un peu. Tout cet accord dépend principalement
de la doublette qui aura baissé tant soit peu ; il faudra
la rehausser jusqu'à ce qu'elle soit prête à battre,
et on raccordera la fourniture et la cymbale.
Tout le plein jeu étant accordé, on le vérifiera
en comparant toutes ses octaves; car souvent on en trouve qui ne sont
pas justes. On raccordera celles qui en auront besoin.
Comme on ne peut accorder un orgue dans un jour l'on ne manquera pas,
au commencement de chaque journée, de visiter l'accord du prestant,
et de le repasser s'il le faut. Il est essentiel que son accord soit parfait :
autrement on ne parviendrait jamais à accorder, comme il faut,
tout l'orgue.
Le positif étant fini d'accorder, on accordera le grand orgue.
On commencera par le prestant, qu'on mettra parfaitement d'accord avec
celui du positif. On les confrontera ensemble touche par touche et par
octaves. Il ne faut pas qu'il y ait un seul tuyau qui batte. On ne saurait
assez répéter qu'il est important que les deux prestants
soient bien accordés ensemble ; la réussite de l'accord
de tout l'orgue dépend de là.
On accordera le premier huit pieds sur le prestant lorsqu'on sera bien
assuré de la justesse de son accord. Ensuite on accordera sur le
même jeu le second et le troisième huit pieds, chacun séparément.
On accordera ensuite le seize pieds ouvert, sur le premier huit pieds
et le prestant ensemble. On fermera ce seize pieds, et on accordera le
bourdon de seize pieds sur le premier huit pieds et le prestant. On accordera
le trente-deux pieds, s'il y en a, sur le seize pieds ouvert avec le premier
huit pieds. On fermera ces jeux, on ouvrira le prestant avec le petit
nasard à la quinte du prestant : on s'y prendra comme on l'a
dit page 217. Le nasard étant d'accord, on
accordera le gros nasard à l'octave, en bas du petit nasard, touche
par touche, sans prestant. On accordera la doublette à l'octave
du prestant ; ensuite la petite tierce à la tierce de la doublette :
on s'y prendra comme on l'a décrit page 217.
Cette tierce étant accordée toute entière, on accordera
à l'octave en bas de celle-ci la grosse tierce, touche par touche,
et sans prestant. On accordera la quarte sur le prestant. Tous ces jeux
étant accordés séparément, on les accordera
tous ensemble, comme on l'a décrit pour le positif, page
217. On accordera les cornets, quels qu'ils soient, comme on l'a expliqué
page 218.
On accordera le plein jeu de la même manière qu'on l'a décrit
pour le positif, page 218. On ouvrira tous les jeux
de fond, même le trente deux pieds, pendant qu'on accordera le plein
jeu. Lorsqu'il sera tout d'accord, et que toutes les octaves, ayant été
comparées entre elles, auront été trouvées
justes, on le confrontera encore avec celui du positif; et s'il y a quelque
chose à rectifier, on le fera. On comparera de même tous
les fonds du grand orgue avec ceux du positif : il faut que tout
aille parfaitement ensemble ; on accordera tous les jeux à
bouche de pédale, d'abord séparément, ensuite ensemble;
et on les comparera avec les jeux semblables du grand orgue, afin que
tout s'ajuste ensemble.
Comme on aura été obligé de tourmenter beaucoup pour
accorder tout l'orgue, et qu'il aura été nécessaire
d'ôter de leur place une partie des jeux d'anche, ceux-ci auront
besoin d'être repassés. On remettra en place tous les tuyaux
qu'on avait déplacés, et on les repassera tuyau par tuyau,
jusqu'à ce qu'ils soient bien en état. On accordera la première
trompette sur le prestant seul ; on accordera chacune séparément,
sur le prestant seul, la première et la seconde trompette, et le
clairon aussi. S'il y a une bombarde, on l'accordera sur la première
trompette : on verra ensuite si tous ces jeux vont bien ensemble.
Si l'on y remarque quelque battement, on retouchera à l'accord
des tuyaux qui en auront besoin.
A l'égard des pédales, on accordera sur le grand plein jeu
entier chaque trompette en particulier, s'il y en a plusieurs. On accordera
le clairon sur une trompette et la bombarde sur le plein jeu. On examinera
si tous ces jeux vont bien ensemble, et si leur son est bien uni. Si l'on
entendait quelque battement, on retoucherait aux tuyaux défectueux
dans leur accord.
Les jeux d'anche du récit s'accorderont sur le prestant.