
MIROIR DES ORGANIERS ET ORGANISTES
Arnold
Schlick - 1511
Traduction par Christian Meyer (in: revue "l'Orgue", n° 21 - 1979)
Schlick, qui vécut à Heidelberg entre 1460 et 1521, a beaucoup voyagé et a connu de nombreux organistes et facteurs d'orgues. Parmi ces premiers, il rencontra à plusieurs reprise P. Hofhaimer.
Son traité est intéressant sur l'aspect de la facture d'orgue de son temps qui en était à un tournant entre le "blockwerk" (orgue à plans sonores fixes) et l'orgue à registres séparés, de l'interprétation de la musique d'église ainsi que la manière de l'accompagner à l'office.
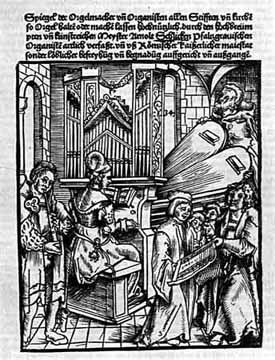
Très utile miroir des organiers et organistes à l'usage
de toutes les abbayes et églises désireuses d'entretenir
ou de faire construire des orgues. L'auteur en est le très célèbre
et très artiste Maître Arnold Schlick, organiste du comte
Palatin.
Imprimé et édité avec le privilège particulier
et la faveur de sa majesté l'Empereur Romain
Nous, Maximilien,
Empereur Romain élu par la Grâce de Dieu, Roi d’Allemagne,
de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne
et de Brabant, Comte Palatin, accordons notre faveur et tous nos bienfaits
à tous les princes Electeurs, ecclésiastiques et temporels,
Prélats, Comtes, Barons, Seigneurs, Chevaliers, Ecuyers, Commandants,
Sénéchaux, Vidames, Baillis, Gouverneurs, Administrateurs,
Fonctionnaires, Maires, Juges, Conseillers, Habitants des villes, Imprimeurs,
Libraires, Municipalités, et à tous les autres Sujets et
Fidèles, ceux des nôtres et de l’Empire, de nos Principautés
et Territoires héréditaires, quelle qu’en soit la dignité,
le mérite et le rang, [et] à ceux auxquels parvient notre
présente missive. Vénérables, nobles et illustres,
respectables et dévoués Seigneurs, chers Neveux et Oncles,
Princes Electeurs, Princes et Fidèles. Cher et fidèle à
nous-même et à l’Empire, notre Maître Arnold Schlick,
Organiste à Heidelberg, nous a fait savoir qu’en réponse
aux prières et demandes réitérées et multiples
de la part du Comte Palatin Philippe et d’autres Princes, et personnes
de rang ecclésiastique et temporel, I'a recueilli avec diligence
et patience en un petit livre, la présentation, l’enseignement
et l’instruction relatifs à la manière dont il convient
d’arranger et d’accorder un jeu fait selon les règles de l’art,
composé de tuyaux et d’autres choses, au chant du chœur et à
l’organiste.
Ce même opuscule avant tout à la louange et à
la gloire de Dieu, mais aussi imprimé pour l’usage commun afin
que l’on fasse l’économie des fortes dépenses inutiles qui
ont été engagées jusqu’à présent pour
les orgues à cause des avaries dont elles étaient fréquemment
l’objet; sa volonté a été de faire largement connaître
cet état de chose et d’en référer. Et afin qu’il
trouve d’autant plus facilement un imprimeur qualifié qui lui imprime
son opuscule et ouvrage à l’aide de caractères nets et lisibles,
et qu’il recueille ainsi le salaire de son travail et de sa peine par
la vente de celui-ci, il nous a humblement sollicité et prié
de lui accorder la grâce de notre Privilège Impérial
afin qu’au cours des dix années à venir, à compter
la date de notre présent acte, personne ne réimprime, à
son insu et sans son consentement, l’opuscule précité qu’il
a rédigé, ou tout autre chose, comme la tablature destinée
aux orgues et à d’autres instruments à cordes qu’il a le
projet de dresser sous peu et de porter au jour, [privilège] que
nous accordons pour les raisons énoncées plus haut et plus
particulièrement en vue de la promotion de l’utilité commune.
Par conséquent, nous vous enjoignons à tous, ordonnons fermement
à chacun de vous, et voulons que, par les précités
faveur et privilège, vous protégiez énergiquement
en Notre nom le dit Arnold Schlick, Organiste, et ne tolériez que
ni son opuscule précité ni l’autre, dont le concept a été
fourni plus haut, ne soient ladite période, édités
à son insu ou réimprimés sans son accord par qui
que ce soit, en pays welche, ou toute autre nation au-delà de nos
territoires, ou réimprimés en vers; qu’aucun exemplaire
n’en soit vendu et que vous-même ne le fassiez, mais au contraire,
conformément au désir et au souhait de Maître Arnold
Schlick ou de l’imprimeur qu’il aura décidé de prendre à
son service, vous les fassiez saisir et interdire à la vente et
agissiez de la sorte afin qu’en vertu de la protection assurée
par notre Privilège il n’y ait pas d’autre mesure à prendre.
Donné en notre Ville et celle de l’Empire, à Strasbourg,
le troisième jour du mois d’avril en l’an du Seigneur quinze cent
onze, en la vingt sixième année de notre Règne sur
l’Empire Romain et la vingt et unième année de notre Règne
sur l’Empire Hongrois.
Pour le Roi. A la requête de Sa Majesté Impériale
L’ingratitude, ainsi
que l’enseignent les anciens sages, mérite, plus que tout autre
défaut, d’être repoussée. Mais tandis que moi-même,
Arnold Schlick, Serviteur du Palatinat et le moindre parmi d’autres organistes,
ai été créé par le Tout-Puissant dans ma condition
humaine, et (ainsi que l’écrit Tullius) non pour moi seul, je reconnais
ne pas m’être suffisamment appliqué au cours de ma vie à
rendre grâces et louer Dieu. J’ai reçu la grâce, la
faveur, les émoluments et avantages particuliers de plus d’un homme,
ecclésiastique ou laïc, de haut rang ou de condition modeste,
et plus particulièrement jadis de son illustre Excellence Prince
et Seigneur, Sire Philippe, Comte Palatin du Rhin et Duc de Bavière,
Ecuyer et Prince Electeur du Saint Empire Romain [auquel j’adresse ici]
mon respectueux souvenir, mais aussi de Sire Louis, Prince Electeur, de
Sire Philippe zu Freisingen, de Sire Johannsen, Evêque de Regensburg,
des précepteurs de Sire Frédérique, de Dame Elisabeth,
Margrave de Bade et de ses frères et sœurs, du Comte Palatin et
de la Comtesse Palatine, du Duc et de la Duchesse de Bavière, de
mes très bons et bons Seigneurs, Dames et Damoiselles. C’est pourquoi
j’ai pensé qu’il ne serait que juste de mettre à profit
le temps qu’il me reste (puisque l’homme a sur l’animal l’avantage de
la volonté) et de ne pas disperser inutilement mon temps comme
les animaux de raison qui, par nature, inclinent leur tête vers
la terre et vivent selon la loi de leur ventre. Il convient donc, afin
d’être considéré comme un homme reconnaissant de la
grâce et des dons qu’il a reçus, d’exprimer cette reconnaissance
par un ouvrage à la gloire et à la louange de Dieu qui réjouira
et divertira mes très bons et bons Seigneurs, Dames et Damoiselles
cités plus haut et tous les bons Chrétiens; que d’autres
aussi qui auront été dotés de Dieu et de la nature
de plus de savoir et d’expérience en cet art que moi, veuillent
corriger, compléter et parfaire ce que je n’ai su qu’imparfaitement
composer afin que les gens oisifs et avides d’art, (pour lesquels) de
nouveaux domaines ne font qu’accroître l’ennui de la lecture, soient
incités à lire notre ouvrage.
Puisque toute force humaine réside dans l’entendement et dans le
corps, — l’une, nous l’avons en commun avec les anges, l’autre avec les
animaux dépourvus de raison —, et que la vie humaine est également
de courte durée, je pense que cet opuscule saura conserver le souvenir
de mes très bons et bons Seigneurs, Dames et Damoiselles cités
plus haut, ainsi que celui de moi-même, le plus humble serviteur
de votre bonté; ont été à l’origine de cet
ouvrage et lui ont servi de règle. C’est selon les préceptes
irréfutables et intangibles de docteurs chrétiens, Jérôme,
Aurélien, Augustin, Ambroise, Grégoire, lgnace, Cassiodore,
Basile, selon les anciens Rois, Princes et Seigneurs, et selon le témoignage
de nombreuses, excellentes et savantes personnes, vivant encore, dont
certaines décrivent la musique et d’autres l’ont pratiquée
et l’exercent encore grandement, que j’ai cultivé l’une des parties
de la louable, noble, très douce et véritable musique, qui,
selon le témoignage de tous les maîtres, doit être
profondément vénérée en raison de la prééminence
de ses inventeurs, appelés Muses à cause des neuf femmes
symboliques desquelles il est dit qu’elle tient son origine.
Boèce dit en effet qu’elle est la véritable amie de l’égalité
et de la concorde, une ennemie de l’inégalité et de la discorde;
mais elle est également digne d’une haute considération
à cause de l’effet qu’elle produit à l’office divin, de
l’édification et du divertissement lors de la messe, et selon l’enseignement
de David, à cause de son effet dans les guerres, les batailles,
les pacifications et les joies. Elle réconforte et réjouit;
elle rend doux les gens portés à la colère; elle
apporte la raison aux insensés ainsi que l’écrit Asclépiade
le médecin, elle chasse également l’esprit du mal comme
David avec sa harpe (Rois, Livre premier, seizième chapitre); elle
chasse l’impudicité, ainsi qu’on le rapporte au sujet de Pythagore
lequel, grâce à la musique, aurait délivré
d’un amour coupable un jeune garçon. Ainsi que le rapporte également
Gui, la musique est profitable à tous les hommes, quel que soit
leur âge et elle est particulièrement l’amie de la nature
qu’elle soutient et qu’elle renforce. C’est pourquoi l’on dit d’elle qu’elle
est une médecine pour le corps et pour l’âme. Elle convient
aux enfants, aiguise et dresse l’esprit; elle soigne et guérit
les infirmités du corps. C’est ainsi que Thalès de Crête
fut guéri de la peste par la douceur du son de la harpe et qu’il
apaisa la foule en colère. Aristote dit que la musique rend les
gens adroits, redresse les gens déchus et désespérés,
réconforte les gens épuisés, désarme les assassins
et soulage le sommeil, la mélancolie, la tristesse et toutes les
peines, et non pas seulement à l’endroit de l’homme, mais aussi
des animaux dépourvus de raison, les oiseaux, les chevaux et d’autres.
Mais [la musique] est avant tout la plus agréable consolatrice
de l’esprit humain. Une solide expérience et causes fondamentales
d’où découle la musique ont présidé à
la rédaction de l’opuscule qui suit et on a rassemblé un
certain nombre de règles quant à la facture et à
la réparation de l’orgue qui est l’instrument de musique le plus
distingué en tant qu’il permet à un seul homme de conduire
le plus de voix (2),
à savoir six ou sept. On s’en sert dans les églises dans
le cadre de l’office divin; il contribue à faciliter le chant du
chœur et réconforte l’âme de l’homme et la soulage dans sa
détresse; sa facture et son utilisation exigent un lourd labeur
et d’importantes dépenses et cependant l’ignorance parvient facilement
à le rendre impropre et à le gâter, de sorte que tous
les frais engagés ont été dépensés
en vain. Grâce à ces règles, à condition qu’elles
aient été bien comprises et résolument appliquées
dès le début, lors de la préparation, mais aussi
pendant l’édification et jusqu’à la réalisation finale
de chaque orgue, qu’on les utilise, que l’on s’y tienne et que l’on donne
à chaque chose sa juste proportion; ce jeu se fera alors sans aucun
doute avec l’économie d’une somme de travail inutile, de frais
et de temps; il sera plaisant, agréable et on en fera l’éloge;
et ainsi se manifestera le fruit de ces règles.
Le premier chapitre. Traite de la manière dont les jeux doivent être installés selon les églises afin qu’elles soient correctement entendues, vues et qu’elles offrent la garantie de leur longévité.
Le deuxième chapitre. Traite de la mesure des tuyaux, une bonne mesure pour le chœur selon laquelle il sera facile de chanter et pour l’organiste de jouer.
Le troisième chapitre. Enseigne à faciliter aux organistes l’usage des jeux conformément à la pratique contemporaine.
Le quatrième chapitre. Traite de la propriété des tuyaux et du métal.
Le cinquième chapitre. Des registres.
Le sixième chapitre. De la mixture ou locatz.
Le septième chapitre. De la manière dont chaque chœur (plan sonore - (3) -) se présente en lui-même et ensuite des rapports qu’ils doivent mutuellement entretenir.Le huitième chapitre. Comment et à quel moment il convient d’accorder un jeu.
Le neuvième chapitre. Traite du sommier du jeu.
Le dixième chapitre. Traite du vent et des soufflets.
Que l’on voie où
le jeu doit être monté afin qu’on l’entende convenablement
en tout point de l’église pas trop loin du chœur comme cela se
fait parfois dans certaines grandes églises où les personnes
qui chantent entendent à peine si l’organiste accompagne le chant
choral ou s’il joue autre chose; cela se produit précisément
lorsqu’il utilise chaque registre isolément, chacun ayant une faible
puissance, et non pas le plein jeu (ganz Werck); [dans les églises]
où l’organiste peut à peine entendre ce que le prêtre
à l’autel chante ou percevoir le moment où le chant s’achève
; — car c’est alors qu’il revient à l’organiste de commencer —
comme par exemple après le Gloria in excelsis, après
l’Epître, parfois avec le Pater et l’Offertoire, après la
Préface, le Sanctus etc. .. Et lorsque le jeu peut être
placé soit contre un mur, soit de manière plus pratique,
au milieu de l’église, voire qu’il apparaisse face au spectateur,
c’est par un effet de décoration recommandable; car bien que les
orgues soient destinées avant tout à l’ouïe et à
la louange de Dieu, ainsi qu’à la contemplation des choses célestes,
mais aussi au soutien des chantres du chœur, elles n’en contribuent pas
moins à l’ornement des églises dans la mesure où
elles présentent un bel aspect, et suscitent le recueillement grâce
à de nombreuses représentations et peintures, non pas celles
qui excitent au moyen de facéties frivoles ou licencieuses comme
il en a été faites au cours des dernières années
dans un monastère d’un ordre mendiant la figure d’un moine d’une
taille assez grande qui, lorsqu’on jouait de l’orgue, tombait presque
jusqu’à la ceinture d’une fenêtre placée sous l’orgue,
pour se mettre à nouveau à sa place initiale. Plus bas,
jeunes et vieux, hommes et femmes en étaient souvent effrayés.
Les uns se mettaient à jurer, les autres en riaient; ce qui, à
bon droit, devait être proscrit dans les églises et plus
particulièrement chez les clercs. De même, les visages des
Rohraffen (4), avec leurs
larges gueules qui s’ouvrent et se ferment, avec leurs longues barbes,
ainsi que les grandes statues qui frappent sur de petits sacs d’étranges
divertissements; de même, les étoiles articulées à
grelots, et d’autres choses du même ordre, tout cela n’a pas sa
place dans les églises; mais à côté de l’endroit
où notre Seigneur consacre son église, le diable dresse
son propre établi; quant au salaire que mériteront ceux
qui s’appliquent à effrayer de la Sorte le peuple, à le
troubler dans sa méditation et ses bonnes œuvres et à l’exciter
au mal, j’en laisse à leurs frères en prières le
soin de l’estimer! Il n’est pas nécessaire de mettre des poux dans
la fourrure ou d’envoyer des voleurs à la foire de Francfort; ils
y viennent d’eux-mêmes, et plus tôt qu’on ne le désire.
On veillera également à trouver un endroit à l’abri
des méfaits du temps; on évitera les murs humides. les voûtes,
les fenêtres ou les toitures d’où pourraient tomber des gouttes
d’eau; cela s’est encore produit récemment et a endommagé
le jeu. En ce qui concerne également les soufflets, on veillera
à ce qu’ils ne reposent pas à même sous un toit sur
lequel donne le soleil; cela provoque rapidement un dessèchement
du cuir qui se fendille pour devenir dur et inutilisable de sorte qu’il
se brisera d’autant plus tôt. Maïs s’il est impossible de les
disposer autrement, aussi construira-t-on un conflatonium ou tout
autre abri qui protégera les soufflets du soleil et des intempéries.
De même le soubassement ainsi que la charpente dont le soin de la confection revient aux menuisiers, seront construits afin que ça ne cède, ni ne penche de côté ou ne s’effondre lorsqu’on y pose le sommier et les tuyaux; cela se passait encore naguère dans une fondation épiscopale, ce qui occasionna de profonds désagréments et des frais importants.
Le jeu (d'orgue) doit être adapté au chœur et correctement accordé pour le chant; car là où l’on n’observe pas cela, les gens devront chanter souvent trop haut ou trop bas; l’organiste devra alors jouer sur les touches noires, ce qui ne convient pas à tout un chacun. Mais quant à savoir quelle doit être cette mesure des tuyaux afin qu’elle convienne au chœur pour ses chants, cela ne peut être donné de manière tout à fait précise et certaine; car en un lieu on chante plus haut ou plus bas qu’en un autre selon que les gens ont des voix aiguës ou graves; mais, dans la mesure où le corps du tuyau le plus long, à savoir le fa sous le gama-ut (5) au pédalier, comporte, du bord supérieur jusqu’au pied, seize fois la longueur portée ci-contre (119 mm x 16, soit 1,90 m – environ 5,8 pieds. 6 pieds à Heidelberg ? ), ce sera là à mon avis, une excellente mesure de chœur. (Chormass). Mais si l’on souhaite un jeu d’une quinte plus grave, le c-fa-ut au pédalier doit alors comporter cette longueur (?).
Mais si l’on souhaite un jeu encore plus grave on rabaissera l’une des mesures définies ci-dessus d’une octave. Sur les très grands jeux, où le tuyau le plus grave est de 20, de 24 ou de 30 pieds de long, comme on en trouve en de nombreux endroits, et que les anciens ont construit à grands frais, il n’est pas commode d’entendre distinctement ce qu’on y joue du fait du timbre grave et de l’abondance des tuyaux. De même les organistes ne peuvent y exécuter leurs pièces de manière aussi libre et avec la même maîtrise que sur les petits jeux à cause de la force du vent, de la taille des soupapes, des ressorts de soupapes, des vergettes, des rouleaux d’abrégés et de toutes les autres [pièces] qui alourdissent [le jeu] comme le savent les organiers et les organistes.
En outre pour un
assez petit jeu (d'orgue) je conseillerais de prendre 16 fois la mesure
présentée plus haut (119 mm x 16) pour le fa sous
le gama-ut; et pour un jeu plus important, le tuyau le plus grave
aura une longueur double. La cause en est que la plus grande partie du
chant choral finit in gravibus (6);
par exemple in primo tono (7)
: Salve regina, Ave
maris stella, Gaudeamus, Vita Sanctorum, et toutes les autres de la
même sorte conviendront au chœur sur g-sol-re-ut; et il sera
facile d’y joindre un contraténor bassus (frey bass contra)
à l’octave, le pédalier permettant de clausuler et finir
sur le Gama-ut, mais il sera facile également de conduire
le chant choral au pédalier; en effet sur les autres jeux, dans
la mesure où le chant dont il est question ici doit être
exécuté à partir du d-sol-re, le pédalier
ne permet pas de monter à l’octave supérieure, ce qu’exige
parfois le chant choral et le contraténor bassus; l’organiste doit
par conséquent avoir recours au clavier manuel à la manière
de l’usage que l’on observe dans les pays situés au-delà
des frontières allemandes.
Et si là-bas ils utilisent maintenant également le pédalier,
ce n’est pas sans raison, car il est impossible de conduire à la
perfection uniquement avec les mains un chant comportant de nombreuses
voix éloignées les unes des autres; en s’aidant du pédalier
où l’on peut conduire deux ou trois voix, à quoi s’ajoutent
quatre autres au clavier, on peut donc jouer simultanément sept
voix; ce qu’il est impossible de faire au clavier sans l’aide du pédalier.
Non seulement les pièces présentant tant de voix, mais aussi
mainte autre chanson et autre chant à trois ou quatre voix ne sauraient
être exécutés à la perfection au clavier comme
ils sont composés, précisément lorsque les voix s’éloignent
trop les unes des autres de sorte qu’une voix devra céder au profit
de l’autre, ou entièrement faire silence parce que l’on n’aura
pas pu l’atteindre des mains. Soit encore qu’en entrant en trop grande
proximité, deux voix ne convergent sur une seule touche cela ne
se fera de manière plus parfaite et chaque voix n’aura son propre
son et ne sera distinctement entendue que lorsqu’on se servira simultanément
du pédalier et du clavier.
En outre, la mesure de ces tuyaux acceptera également le chant choral en troisième ton, à partir d’a-la-mi-re, comme Pange lingua, A solis ortus, Hostis Herodes, etc.
De même le chant choral en cinquième ton qui monte pratiquement à l’octave supérieure, voire au-delà, conviendra bien au chœur en commençant sur f-fa-ut. Cependant le chant qui ne monte pas dans l’aigu, mais qui demeure toujours dans le grave, comme par exemple en sixième ton, on l’exécutera de préférence sur b-fa-b-mi; un organiste adroit saura s'en tenir à cela selon la voix des chantres.
De même, le
chant choral en septième ton convient également plutôt
à la mesure que nous avons indiquée plus haut qu’à
l’autre mesure à la quinte inférieure, et un tel chant devra,
sur un orgue dont les tuyaux auront ces mesures-ci, être exécuté
sur ses notes et ses touches régulières et naturelles, à
partir de g-sol-re-ut à la manière aussi du premier
ton dont il a été question plus haut. Les deux tons dont
nous venons de parler seront donc intonés sur une même note,
à une hauteur et un son uniques que le chœur pourra chanter correctement
et sans difficulté; mais comme avec l’autre mesure l’organiste
ne peut pas jouer le premier et le septième ton à partir
d’une même note, il intonera le septième sur c-fa-ut;
quant au premier ton, il ne I’intonera pas sur cette touche-là,
mais sur d-sol-re; le choeur devra donc chanter un ton plus haut.
Il en va de même pour [les mélodies] du troisième
ton sur e-la-mi qui sont également intonées
un ton plus haut; l’organiste peut alors jouer en musica ficta le
mi in d-sol-re (8), chose
qu’il est certes facile de faire, mais qui ne convient pas à chacun.
C’est pourquoi, là encore, la mesure des tuyaux dont nous avons
parlé en premier est la meilleure, car le premier et le septième
ton demeurent en un ton unique, sur g-sol-re-ut, et le troisième
ton à partir d’a-la-mi-re n’est plus que d’un ton trop haut
(par rapport au premier et au septième); il sera donc très
facile d’exécuter sur les orgues les trois tons en question sur
les deux touches sol et la dont on a parlé et il
sera tout aussi commode pour le chœur de les suivre dans son chant. Mais
lorsqu’un chant en troisième ton monte trop haut dans l’octave
et tend à la dépasser, l’organiste préférera
exécuter ce dernier à partir d’e-la-mi. Il y a beaucoup
de chants qui montent haut et descendent bas, couvrant un intervalle de
douzième ou de treizième; comme certaines séquences
(9) : Laus tibi Christe, De sancta
Maria Magdalena ; Psallite regi, De decollatione Johannis Baptiste,
et d’autres de la même sorte; dans ces derniers, l’organiste saura
s’adapter aux voix du chœur qu’il accompagne.
De même certains chants chorals comme la séquence De Sancta Trinitate, Benedicta sit semper, Et in terra summum, qu’il est de coutume de chanter chez nous, commencent sur le septième et le huitième tons et s’achèvent en premier ton. Il est beaucoup plus pratique pour un organiste de jouer cela en g-sol-re-ut, puisqu’il placera mi et fa sur b-fa-b-mi conformément à la mélodie du chant choral en question. Et s’il doit jouer un tel chant à partir de c-fa-ut, il placera mi et fa sur e-la-mi ou sur f-fa-ut [s’il le joue] en d-sol-re; à moins qu’il sache, ainsi qu’il sied et convient de la part d’un maître organiste, jouer de manière achevée et certaine sur les touches noires, en quoi toutefois tout le monde ne s’est pas rendu maître, la première mesure dont nous avons souvent parlé conviendra mieux de la sorte que la seconde.
Deuxièmement, si la mesure que nous venons de décrire est meilleure que l’autre, la raison en est que le chant choral ne clausule pas aussi souvent en a-la-mi-re qu’avec l’autre mesure, car dans la clausule sur a-la-mi-re le post-sol (10) est trop haut, comme nous le verrons plus loin (chapitre 3).
Troisièmement,
la première mesure que nous venons de décrire est la meilleure
à cause de certains nouveaux registres ou tuyaux, comme les courtauds
ou les cromornes et les trompettes, comme on les fait à présent,
lesquels dans l’autre mesure deviennent trop aigus ou trop graves, et
ne reçoivent pas leur juste proportion, comme en cette dernière.
Si l’on pouvait monter ou rabaisser les jeux des orgues d’un ton afin
qu’ils soient accordés à la hauteur convenant au chœur,
cela serait d’un grand avantage tant pour les organistes que pour les
chantres. Comme j’ai entendu dire, on aurait construit, il y a quelques
années un positif de ce type, mais de jeux d’orgues entiers je
n’en connais qu’un seul qui, avec son positif de dos, ses deux claviers,
son pédalier et tous ses registres qui sont nombreux et étranges
soit susceptible d’être monté ou baissé d’un ton;
et cela aussi souvent que l’on veut ou que l’exige le chœur ou tout autre
chant; il s’agit de l’orgue sur lequel je joue chaque jour. De tels jeux
sont particulièrement pratiques, voire indispensables ad cantum
mensurabilem, là où l’on dispose d’une chapelle et de
chantres; il arrive en effet que deux messes ou plus, de même que
le magnificat, soient composés à partir d’un seul et même
ton, d’une seule ligne ou d’un seul espace interlinéaire, et demandent
cependant, l’une, d’être chantée un ton ou une note plus
haut que l’autre. Ainsi, il arrive que les deux messes en sixième
ton par exemple soient composées en c-sol-fa-ut et que le
contraténor bassus demeure dans l’une des messes en c-fa-ut
sans redescendre plus bas, et que dans l’autre messe le contraténor
bassus descende d’un ton ou de plus, par exemple en fa in b-mi ou
en a-re; là précisément où cela est
trop bas pour les basses, de sorte que leur voix perd en force par rapport
aux autres, il est donc nécessaire d’exécuter le chant en
question un ton plus haut. Mais dans la mesure où la première
messe, ou le contraténor bassus d’un autre chant, atteint le c-fa-ut
sans descendre plus bas et que l’on décide de la jouer sur
un jeu à partir du c-sol-fa-ut, l’autre messe demande à
être transposée en d-la-sol-re; on trouvera alors
les syllabes fa en d-la-sol-re, mi sur la touche noire du
post-ut ou cis, re en b-fa-b-mi en b dur, et
l’ut en a-la-mi-re; mais les organistes qui ne se sont pas
exercés à cela n’y parviennent que difficilement, voire
pas du tout. Mais dans la mesure où il est possible de monter le
jeu d’un ton, comme nous l’avons dit plus haut, l’organiste joue à
partir du c sol-fa-ut et cependant les tuyaux sonnent en
d-la-sol-re.
Le troisième
chapitre enseigne comment, troisièmement, il s’agit de prêter
une attention particulière et de s’appliquer à faciliter
aux organistes l’usage des jeux; on veillera à ce que le clavier
manuel présente 24 touches naturelles (claves naturales), quatre
fa et quatre la, c’est-à-dire trois octaves et une
tierce majeure (du fa 1 au la 4); les touches ne doivent pas être
trop espacées ou trop larges comme les faisaient parfois les anciens,
ou trop petites ou trop étroites comme on en trouve sur certains
jeux, comme si des enfants devaient y jouer elles seront bien plutôt
d’une mesure telle que l’organiste puisse exécuter quatre ou cinq
sons et plaquer une octave. Cette octave sera d’une longueur égale
au double du trait porté ci-contre (2 fois 99 mm – presque 20 cm).
On veillera également à ce que les touches possèdent
une longueur correcte, car si elles sont trop courtes, lorsque l’on joue
d’une main deux ou trois sons, et plus particulièrement sur les
touches noires, la planche qui limite le clavier
(13) est trop proche et incommode fort l’organiste.
Il est donc nécessaire que les touches noires et les touches blanches
dépassent la planche d’une bonne longueur. On trouvera ci-contre
les longueurs qu’elles doivent présenter. Le plus petit trait indique
de quelle longueur la touche noire (feinte) s’avancera devant la planche
(68 mm), le trait le plus long donne la dimension de la touche naturelle
(103 mm). Les touches noires doivent également ne pas être
trop minces ou trop basses afin qu’en les touchant elles ne s’enfoncent
pas en dessous du niveau des autres, mais demeurent au-dessus, afin de
ne pas entraîner dans leur course les touches voisines et les faire
sonner. On ne fera pas un clavier trop dur ou trop résistant, mais
au contraire aussi doux et souple que cela sera possible. On se servira
à cet effet de rouleaux d’abrégé (Weflen) de
petite dimension, de même de soupapes (Ventil) longues et
étroites, en bois de sapin, bombées des deux côtés
vers l’arrière et munies d’un rebord acéré; le vent
ne parviendra pas à les maintenir aussi fortement fermées
que celles qui sont larges.
De même les
ressorts de soupape (Schern) ne doivent pas être trop courts,
sinon ils rendent le clavier dur et résistant. On veillera également
à accrocher les vergettes (Zug) aux soupapes de manière
à ce qu’elles s’ouvrent aisément sans que toutefois les
touches ne s’enfoncent trop; lorsqu’elles sont accrochées à
l’avant des soupapes, les touches doivent descendre plus bas que lorsqu’elles
sont accrochées plus en arrière. On veillera également
aux fers d’abrégés (Ermlein der Wellen); dans la
mesure où les trous dans lesquels sont accrochées les vergettes
se trouvent à proximité des abrégés, le clavier
devient d’autant plus dur et plus résistant; et plus on les éloigne
des abrégés, plus celui-ci gagne en légèreté
et moins il demande d’effort; de même on veillera à la manière
dont on suspendra les vergettes aux touches, car des longues suspendues
à la verticale des touches et des vergettes légères
en bois de sapin, contribuent à rendre aisé le jeu du clavier
en ce que les touches ne descendent pas trop bas ou ne sont pas trop dures,
comme cela arrive lorsqu’on ne veille pas à ces choses-là;
il est en effet très important de pouvoir jouer de cet instrument
et d’exécuter les traits comme il est aujourd’hui en usage, ce
que les organiers feraient bien de prendre en considération afin
de rendre les jeux propres à l’usage auquel ils sont destinés,
Il faut y jouer avec les doigts, le clavier doit donc ne pas être
dur, raide ou sec, comme si l’on frappait les touches avec des
maillets ou des marteaux de tonneliers.
Chaque chose doit répondre à sa fonction; un couteau qui
ne coupe pas ou un cheval qui ne marche pas sont inutiles car ils ne répondent
pas à l’usage pour lesquels ils ont été fabriqués
ou créés. Ainsi ces organistes, quel que soit le talent
dont ils ont été dotés par Dieu et par la nature
et qu’ils ont développé par la diversité de leur
travail, ne viennent pas à bout de pleins jeux groupés (Blockwerck)
d’une facture aussi maladroite, et doivent le plus souvent abandonner
ce [jeu] d'artiste qui leur est agréable et nécessaire,
et qui procure également aux autres du plaisir et de la joie, et
dont l’ignorance d’organiers incompétents les prive. Si les outils,
grâce auxquels ces organiers gagnent leur pain leur étaient
tout aussi inutiles que le sont leurs orgues pour les organistes, ils
changeraient d’avis et mettraient plus de soin à la tâche.
Pour bien réaliser librement au pédalier un contraténor bassus il est à mon avis nécessaire de disposer d’une douzième à partir du fa sous le gama-ut jusqu’au c-sol-fa-ut, c’est-à-dire de douze touches naturelles y compris les demi-tons intermédiaires (de fa 1 à ut 3); sur un tel pédalier on pourra réaliser bien des choses, on peut jouer non seulement une voix dans le haut ou dans le bas, mais aussi deux ou trois voix simultanément; cela sonne tout à fait pleinement et magnifiquement avec les autres voix ; mais il est tout aussi agréable d’écouter deux voix au pédalier, puis de nouveau au clavier, et ainsi de suite selon l’intelligence et le savoir-faire de l’organiste; cela comme une modification étrange mais plaisante pour l’oreille. Et quoique certains estiment que les deux demi-tons inférieurs du post-fa et du post-gama-ut sont inutiles, pour la raison évoquée plus haut, on ne les omettra pas; c’est comme si l’on se gâtait une bonne échelle en lui ôtant deux degrés. Ceux qui partagent cet avis et en parlent ainsi se trompent; j’ai dit et montré à certains d’entre eux combien ces touches en question servent bien le chant choral et d’autres bonnes consonances. Mais le fait que ce n’est pas à la portée de tout un chacun de s’en servir, cela ne doit pas justifier leur absence et permettre de laisser un jeu tout entier incomplet; ce serait comme si quelqu’un désirait une maison mais qui, pour cette raison qu’il lui importerait peu de conserver des fruits, des grains ou du vin, se refuserait à construire une cave ou un grenier. Car celui qui succédera au propriétaire de cette maison et qui, lui, aura à se servir de la cave et du grenier ou de la huche pour y serrer ses provisions, aura alors à se dédommager de la maladresse du précédent propriétaire, car la maison ne sera pas parfaite.
En outre les touches du pédalier ne doivent pas être trop minces ou trop fragiles car elles risqueraient facilement de se briser, comme cela se produit parfois; elles seront donc solides, d’un bon bois, de sorte que si quelqu’un, comme cela se produit quelque fois lorsque la banquette est trop à l’étroit, devait marcher sur le clavier, les touches n’en souffrent pas.
De même, les touches en question ne doivent être ni trop courtes ni trop longues, mais d’une mesure convenable de sorte qu’une touche, depuis la planche par où elle passe jusqu’au liteau qui repose sur elle à l’arrière, ait cinq fois la longueur portée ci-contre (5 x 61 mm = 30,5 cm).
De même, veille à ce que ces touches ne soient ni trop étroites ni trop larges comme on les trouve en beaucoup d’endroits, mais d’une mesure moyenne, utilisable par chacun et qui permette de tenir deux sons d’un seul pied. Donc, que la largeur de trois touches, y compris les deux intervalles qui les séparent, ait la dimension portée ci-contre (185 mm).
En outre, les touches et les intervalles qui les séparent n’auront
pas la même largeur mais les touches seront plus étroites
et pas aussi larges que les intervalles; l’organier veillera à
cela et à toutes les choses de même ordre et donnera à
chaque chose sa mesure.
De même, l’espace compris entre le panneau (Wellenbrett)
(15) au bas duquel passent les touches du pédalier
et le banc qui en forme la limite arrière, ne sera pas trop étroit;
on laissera environ un espace de deux pieds afin que l’on puisse mettre
les pieds l’un derrière l’autre et les croiser, aussi bien dans
l’exécution des traits (lauff werck oder gerede) au pédalier.
De même, l’avant
des touches noires ne doit pas se dresser vers le haut, mais descendre
horizontalement; elle dépassera la planche (Brett) du cinquième
de la longueur des touches longues représentée plus haut
(61 mm); elles ne seront pas aussi hautes que Iongues ; cela sert volontiers
à renforcer la précision du contraténor bassus.
De même, le b-dur ou mi in b-fa-b-mi qui se trouve
au haut du pédalier sous le c-sol-fa-ut ne doit pas être
une touche longue comme son octave b-dur au bas du clavier; mais
elle sera courte et élevée comme les autres touches noires;
ainsi le b-fa-b-mi ou b-mol demeurera tel que nos prédécesseurs
l’ont utilisé, ce qui convient également aujourd’hui à
chacun, car jusqu’à présent il n’y avait que peu d’orgues
qui disposaient de touches au delà du b-fa-b-mi-b-mol; mais
si le b-mol du haut, celui dont nous parlons, est en position
de touche noire et le b-dur on position de touche naturelle, à
la manière de son octave inférieure, ainsi que je l’ai trouvé
sur certains jeux, l’organiste trouvera cela tout à fait impropre
et risquera de commettre souvent des erreurs. Afin d’éviter ce
genre de choses et de s’épargner une trop grande attention ou de
changer ses habitudes, la forme habituelle de cette pièce est la
meilleure.
De même, les claviers manuels doivent être placés suffisamment haut au-dessus de celui du pédalier afin que l’organiste ne butte pas avec ses genoux contre le clavier. Car lorsqu’il y a deux claviers et que celui du dessous est trop bas, l’organiste n’a guère de place, surtout lorsqu’il a de longues jambes; il n’est guère commode d’indiquer quelle hauteur il doit y avoir entre le pédalier et les claviers ou encore la hauteur que doit avoir le siège, étant donné que les personnes sont les unes plus grandes, les autres plus petites. Cependant je veillerais à ce que la distance séparant le clavier supérieur des touches du pédalier comporte six fois la longueur portée ci-contre (6 x 153 mm = 91,8 cm). Si donc ils sont à cette distance l’un de l’autre, cela devrait convenir, à mon avis, à un homme de taille moyenne. Mais un jeu ne comporterait-il qu’un seul clavier, on rabaissera dès lors quelque peu ce dernier.
Lorsqu’il y a deux claviers et que le clavier supérieur se trouve environ à hauteur de hanche ou de ceinture lorsque l’organiste est assis, je pense que cela est correct, car lorsqu’il faut tenir les mains au-dessus du niveau des coudes, le jeu est plus difficile et plus dur que s’il faut les tenir à cette même hauteur ou plus bas.
De même, le banc sera assez haut afin que l’organiste puisse laisser pendre et balancer ses pieds au-dessus du pédalier; car lorsque le banc est trop bas, de sorte que les pieds reposent sur le pédalier, il doit les soulever à chaque note; il ne parviendra pas à exécuter beaucoup de traits (gerede oder lauff werck) au contraténor bassus.
De même, si les touches du pédalier reposent dans certains jeux à deux ou trois doigts au-dessus du sol, et si le liteau (die Leyst) qui passe à l’arrière au-dessus des touches est aussi d’une certaine épaisseur et d’une certaine hauteur, la hauteur du banc ne doit pas alors être mesurée à partir du sol ou du liteau, mais à partir des touches du pédalier cinq fois la longueur portée ci-contre (5 x 132 mm = 66 cm).
De même, le banc ne doit pas être cloué, mais on doit pouvoir le rapprocher ou l’éloigner du clavier au gré de chacun. Car dans certains jeux, parmi ceux qui disposent de deux ou trois claviers, le clavier supérieur pénètre à tel point dans le jeu qu’il est difficile à atteindre et par là ne répond pas aux exigences d’un bon jeu.
De même, on disposera du feutre ou du cuir sous les claviers afin d’étouffer leurs claquements et leurs heurts; il arrive en effet que les touches des claviers et du pédalier ainsi que les abrégés et les vergettes couvrent les sons des tuyaux de leur tintamarre et plus précisément lorsque l’on joue sur des registres faibles. Il vaut mieux réserver cela pour la Semaine Sainte avec ses crécelles de bois que pour l’orgue. De même les claviers ne doivent pas faire de mouvement de va et vient de sorte que l’on risque de coincer ses doigts; mais il faut qu’ils demeurent en place et que l’on enfonce également entre les touches une pointe ou un fil de fer afin que les touches ne s’immobilisent les unes les autres. Par ailleurs on évitera ainsi qu’en attaquant des tierces ou des quintes, les touches intermédiaires ou adjacentes soient enfoncées et bloquées par celles-ci de sorte qu’elles sonnent avec elles et dénaturent de leurs sons les autres, comme cela arrive fréquemment sur de nombreux jeux.
Il est également pratique et agréable de disposer les claviers et le pédalier correctement les uns au-dessus des autres et de les répartir proportionnellement; car, quoique le pédalier ne présente que 12 touches, à savoir la moitié des claviers, il s’étend toutefois beaucoup plus loin que les claviers à cause des intervalles ; il est donc nécessaire de veiller à ce qu’aucun de ces claviers ne déborde trop du côté droit ou du côté gauche, mais qu’ils soient disposés de manière égale afin que l’organiste soit assis aussi commodément que possible et qu’il n’ait pas à se courber, à se pencher sur le côté, à rechercher ou avoir recours à quelque autre expédient. J’ai trouvé en effet il y a vingt ans aux Pays-Bas (16) un jeu où le pédalier était tellement décalé par rapport aux claviers, que lorsqu’on jouait aux claviers et que l’on désirait encore y joindre le pédalier, il manquait encore une quarte par rapport à la disposition traditionnelle, de sorte qu’ils sonnaient, [l’un] plus haut, [l’autre] plus bas et ne concordaient donc pas comme il se devait, Mais l’organiste de l’endroit était habitué à cet état de chose et habile [à s’en servir] alors que d’autres disaient en le critiquant qu’il le voulait ainsi et non autrement à cause des étrangers afin d’avoir cet avantage sur eux. Lorsque la touche inférieure du clavier manuel, à savoir le fa sous le gama-ut. se trouve à la hauteur de l’a-re du pédalier — ou entre l’a-re et le gama-ut — et que la touche supérieure du clavier, à savoir a-la-mi-re, se trouve à la hauteur du b-fa-b-mi du pédalier — ou entre b-fa-b-mi et a-la-mi-re —, il me semble que les claviers sont alors correctement disposés l’un au-dessus de l’autre et se prêtent à l’organiste des deux côtés, aussi bien vers le haut que vers le bas.
Le quatrième chapitre traite des tuyaux. Ceux-ci ne doivent pas être minces ou fragiles, mais d’une épaisseur et d’une solidité suffisantes pour résister au temps. De plus, pour des principaux particulièrement solides, comme pour les autres tuyaux, on choisira plutôt l’étain que le plomb. Certains utilisent le plomb pour les fournitures (Hintersatz) parce qu’il est moins coûteux, tout en pensant que ces mêmes tuyaux produiront des sons plus doux que ceux en étain; mais la différence est minime; de plus, le plomb n’est pas aussi résistant et aussi stable que l’étain, car au contact de l’humidité il s’oxyde facilement et perce par endroits. En outre il est mou et tendre, de sorte que les rats et les souris en les attaquant avec leurs dents ou en les renversant leur causent plus de dégât qu’à ceux en étain. C’est pour cette raison et pour d’autres encore que l’on n’aura aucun avantage à utiliser seulement du plomb pour les tuyaux. Certains font un alliage, moitié plomb, moitié étain, soit plus, soit moins, chacun selon son idée; mais à mon avis, l’on prendra moins de plomb et plus d’étain, voire même de l’étain pur, ce qui est encore mieux et plus solide, assurément ce métal est plus dur à travailler et à couper, surtout quand il est nécessaire de diminuer ou de corriger les tuyaux lorsqu’on les accorde; c’est la raison pour laquelle les organiers préfèrent travailler et couper le plomb ou du plomb mélangé plutôt que de l’étain pur. Il ne faut pas tolérer de telles considérations, mais veiller plutôt à l’intérêt de l’église et à ceux qui en supportent les charges financières.
Mais on peut également rendre l’étain plus dur et plus solide qu’il ne l’est par nature; s’il peut répondre au présent usage, je n’en sais rien; le plus sûr, à mon avis, est un bon étain anglais, un étain d’alluvion ou d’Oberstdorf; fréquemment utilisés et en grande quantité, ces derniers ont fait leurs preuves.
On s’appliquera de même à bien entonner les tuyaux afin qu’ils émettent le son correct qu’ils doivent rendre; qu’ils ne passent pas à la quinte ou à l’octave; qu’ils ne sonnent pas en sifflant, ne murmurent pas en sonnant à moitié ou même ne soient totalement muets. Mais lorsqu’on attaque une touche du doigt, si rapidement ou si approximativement cela soit-il, ils parleront pleinement et ne manifesteront nulle défaillance.
Par ailleurs les organiers donnent à leurs tuyaux une certains taille (Mensur), aux uns une taille plus courte (kurz), aux autres une taille plus longue (lang), que ce soit le cinquième, le sixième, le septième, ou n’importe lequel des intermédiaires, ou plus, ou moins, selon le bon plaisir d’un chacun (17); la taille (Mass) longue sonne de manière plus douce que la taille courte. Cependant la taille courte répond plus rapidement que la longue. Je conseillerais donc ceci, comme je l’ai souvent prôné et comme j’ai ordonné de le faire, à savoir que le principal (Principal) dans un [plein-] jeu, ce registre que certains appellent copeln ou flûtes, soit composé de manière à ce que, lorsque la fourniture, la cymbale et tous les autres ont été retirés et que les principaux parlent tout seuls, chaque chœur [répondant] au clavier possède deux tuyaux égaux; [présentant] toutefois deux tailles (Mensur) différentes, l’une un peu plus courte que l’autre. Ainsi le tuyau long communique au tuyau court sa douceur et le tuyau court vient en aide au tuyau long afin qu’ils sonnent simultanément; on entendra ainsi la justesse avec laquelle joue l’organiste, ce qui, autrement, était à peine audible ou compréhensible, dans la mesure où les organiers se sont seulement appliqués à construire des tuyaux d’une taille (Mass) longue, mais sans avoir su les disposer correctement. C’est ainsi qu’il arrive souvent qu’une touche au clavier ou au pédalier mette le temps d’un Ave Maria à faire parler correctement le tuyau, voire même qu’elle n’y parvienne pas. Et cela encore dans les jeux qui viennent d’être construits, vérifiés, montés et déclarés comme étant corrects, de sorte que c’est à faire pitié que de voir avec quelle insignifiance et quelle légèreté on veille aux biens spirituels.
CINQUIEME CHAPITRE.
Le cinquième
chapitre traite des registres. Il n’est pas recommandable de monter trop
de registres, précisément ceux qui sonnent à peu
près de la même manière; on accordera par contre toute
son attention à ceux que l’on entend et dont on reconnaît
distinctement le timbre. Huit ou neuf registres bien composés et
bien distincts les uns par rapport aux autres sauront procurer un grand
plaisir à l’oreille.
Tout d’abord, le principal certains l’appellent koppeln ou flûtes.
On trouvera ensuite une octave d’une taille (Mass) longue, ou lorsque
le jeu est très grand, une double octave.
Pour le troisième registre, une taille courte et large (kurz
weit Mass) que certains nomment cor de chamois, également une
Octave au-dessus du principal ou dans un grand jeu une double octave.
Une cymbale ne doit pas être aussi importante que certains la font,
de sorte que l’on entende pratiquement les octaves et les quintes comme
autant de registres différents. [Les chœurs] seront petits [et]
scintillants (scharf schneiden) afin qu’on ne perçoive pas
trop facilement la nature des sons qui les composent; ainsi leur timbre
s’associera à tous les registres. Ensuite une fourniture (Hintersatz).
Ensuite, sixièmement, les courtauds (Rauschpfeïffe),
une sorte de chalumeau (Schalmey). Ensuite, septièmement,
un claquebois (hultze Glechter) (18);
il s’agit d’un jeu étrange et d’une sonorité bizarre, plus
particulièrement dans les graves (in gravibus), où,
à mon avis, il sonne comme ces pots sur lesquels frappent les jeunes
compagnons avec des cuillères.
Le huitième lorsque le cornet (Zink) est correctement fait,
il sonne effectivement ainsi que j’ai pu l’entendre, presque comme l’instrument
de ce nom (il s’agit de tuyaux à anche).
L’on fait également un registre qui ressemble, paraît-il,
aux flûtets (Schwegeln = galoubet (19));
je laisserai à d’autres le soin de juger de la pertinence de
cette ressemblance; mais, certes, il peut arriver chaque jour que l’on
modifie ou que l’on améliore quelque chose.
Il y a un autre registre actuellement en usage que l’on devrait à
mon sens incorporer à tout plein-jeu d’orgue; il s’agit de celui
qui a été fabriqué avec très grand art pour
notre très excellent Seigneur, l’Empereur Romain, il y a à
peine cinq ans (20); ce petit
instrument ressemble à un positif, une régale ou une super-régale;
sa sonorité est charmante et étrange à l’ouïe;
et ses tuyaux causent la plus grande surprise; mais celui qui ne les connaît
pas est incapable d’en imaginer la forme, la proportion (Proportz)
ou la taille (Mensur); le savoir-faire progresse de jour en
jour et se propage. Les enfants d’Adam ne chôment pas.
Mais quant à savoir comment sont faits les tuyaux dont je viens de parler et ceux que nous évoquerons plus loin, je n’en dirai rien ici par complaisance envers les organiers afin que l’on ne m’accuse pas de dévoiler les secrets de leur art et de les divulguer en en tirant un profit ou de récolter ce que d’autres ont semé, Ils jouissent à bon droit de leur travail, leur art et leur adresse.
Au pédalier
l’octave s’associe bien avec le principal; mais que le principal puisse
être retiré lorsqu’on voudra faire sonner l’octave seule
ainsi que la fourniture.
Ceci vaut également pour la trompette (Trompete) ou le trombone
(Posaune). Certains mettent aussi au pédalier une cymbale
et une petite octave, ce qu’ils appellent une seizième (Sedetzlein);
à mon avis, ces deux n’ont rien à faire ici.
Il est bon que l’on puisse tirer au clavier et au pédalier chaque
registre indépendamment l’un de l’autre. La raison c’est pour que
l’on puisse jouer n’importe quel chant composé à voix égales
(mit gleichen Stimmen) aussi bien au clavier qu'au pédalier,
car celui-ci ne conviendrait à aucun orgue où le pédalier
serait plus grave d’une octave ou davantage que le clavier; les bons intervalles
et consonances seraient inversés et modifiés; des quintes,
par exemple, se transformeraient en quartes, des tierces en sixtes. C’est
pourquoi il est nécessaire de [pouvoir] retirer les principaux
afin de laisser au chant sa spécificité (Art) et
cela n’est possible que si les principaux du clavier et les octaves du
pédalier vont ensemble (21)
ou que, avec d’autres registres, le pédalier ne soit pas à
une octave en dessous du clavier, mais qu’ils aient des sons identiques.
Il est également bon de tirer tous les registres [indépendamment
les uns des autres] afin que l’organiste puisse faire entendre chaque
registre l’un après l’autre, ainsi qu’il le jugera, ou comme il
plaira à d’autres. Il sera alors tout à fait amusant d’entendre
deux registres ensemble, comme les cymbales avec les principaux ou d’autres
dont on a parlé plus haut.
Certains jeux présentent au clavier divers sons que l’on peut registrer
individuellement; mais il n’en va pas de même au pédalier.
Je connais en effet un jeu de facture honnête, construit non sans
grands frais dans une riche et somptueuse abbaye; la fourniture ne peut
pas être retirée au pédalier, ce qui constitue un
défaut majeur; il s’agit là d’un oubli grossier dont on
se dispenserait bien au prix de cent gulden.
On peut associer les
registres selon de très nombreuses manières et les varier,
produisant ainsi à l’écoute des sonorités insolites.
Aussi n’y a-t-il aucun registre qui s'accorde mal avec les courtauds et
les trompettes, et d’autant plus particulièrement que la fourniture
tranchera nettement et proprement et ne se présentera pas comme
une grande fourniture (Mixtur); associée aux deux registres
dont on a parlé plus haut, à savoir les courtauds et les
trompettes.
Il y a un registre en chacun des chœurs de quintes et de tierces aux sonorités
grossières (groben quinten und terzen); il est impossible
d’y faire sonner le moindre intervalle (Concordantz), car quels
que soient les touches ou les chœurs que l’on fait sonner ensemble, ils
produisent des dissonances et sonnent mal, ce qui va tout à fait
à l’encontre de la musique et n’a aucune valeur ainsi qu’en jugera
n’importe qui ayant du bon sens.
Ils font également un registre d’un tuyau par chœur qui sonne à
une quinte au-dessus du principal ou du ton normal du jeu; celui à
qui cela plaît en louera les avantages! Je parle en connaissance
de cause : on fait de nombreux essais, un jour ceci, le lendemain cela.
Il est aisé d’apprendre aux frais d’autrui lorsqu’on n’a pas à
se soucier de son salaire et que l’on dispose de suffisamment de matériau.
On trouve certaines personnes qui méprisent les autres, se glorifient
et font étalage de leur personne et qui, cependant, la première
occasion venue, n’agiront pas différemment des autres. A gaspiller
de l’argent, il vaut mieux le dépenser pour les Saints que pour
de tels artisans.
Il en va de même pour les positifs. Ils en mettent deux ou trois
dans un jeu l’un à l’arrière, l’autre à l’avant,
le troisième dans le jeu; [cela] ne sert à rien d’autre
qu’à prolonger le temps de [travail] et à augmenter la somme
des dépenses inutiles ; beaucoup de sauce et peu de poisson.
Un bon positif de dos (Positif zu rück) me suffira avec pour
registres, par exemple, des principaux en bois ou avec des tuyaux en étain,
mais intonés à la manière de bois, à quoi
s’ajoute un petit cor de chamois, une bonne petite cymbale d’un timbre
pur et une petite fourniture; chaque registre doit pouvoir être
tiré isolément et servir à part; quant aux autres
registres du jeu, la petite fourniture du positif sonne par exemple particulièrement
bien avec les courtauds. De même, les tuyaux en bois au positif
associés à l’octave au clavier sonnent de manière
très étrange mais agréable à l’oreille, que
les voix égales soient rapprochées ou éloignées
les unes des autres. Certains prétendent sur ce point que les courtauds
et les trompettes ne sont pas stables ou ne tiennent pas ; ce n’est pas
là mon avis, mais je pense qu’ils dureront longtemps si on leur
donne à chacun leur taille et leur proportion (Proportz) correctes.
Je peux montrer des courtauds et des trompettes qui sont restés
pendant neuf ans environ dans un jeu et ont été joués,
sans qu’entre temps la chaleur ou le froid ne les aient altérés;
bien au contraire, ils sonnent à ce jour aussi parfaitement qu’au
premier. S’il arrive occasionnellement que dans un jeu deux ou trois de
ces tuyaux s’altèrent, l’organiste, sachant ce qu’il en est, saura
aussitôt y remédier. C’est pourquoi l’on ne dédaignera
pas les registres en question car ils réjouiront l’oreille par
la nouveauté, la splendeur, l’enjouement et l’originalité
à la gloire de Dieu; leur facture et leur entretien sont aisés.
Enfin lorsque l’on tire les registres, il est plus facile de les tirer vers le haut, vers le bas ou de côté que en avant vers l’organiste, ceux qui dépassent de la console (Corpus) d’une longueur d’empan doivent être tirés avec difficulté et force, ne contribue en aucune manière au ménagement [de l’orgue].
Le sixième chapitre traite de la fourniture (Mixtur) ou Iocatz; il revient à chaque organiste de considérer la hauteur et la largeur ou la grandeur de l’église et de régler en conséquence la puissance de la fourniture tout en tenant compte de la grandeur ou de la petitesse du jeu; dans le petit jeu dont la mesure a été donnée au second chapitre, seize, dix-sept ou dix-huit tuyaux environ sur le chœur supérieur suffiront à mon sens dans une grande église et seront suffisamment audibles, par ailleurs la mixture doit nettement trancher, non pas à l’aide de quintes ou de tierces que l’on devra à peine entendre et qui contreviennent à l’homme de bon sens pour lequel elles sonnent avec plus de laideur que de gaieté. Elles ne produisent rien d’agréable, mais gâtent au contraire beaucoup de bons intervalles (Species) et accords (consonantzen) par leur criaillerie; on remarquera cela de la manière suivante lorsqu’on touche une autre quinte c-fa-ut et g-so/-re-ut chacun comportant lui-même déjà une quinte, celle-ci étant d-la-sol-re pour g-sol-re-ut, il résulte donc une dissonance d’une neuvième ou d’une seconde avec le c-fa-ut du bas. Les tierces produisent des dissonances analogues en associant l’e-la-mi au c-fa-ut, la quinte en e-la-mi, à savoir b-fa-b-mi, sera la septième de c-fa-ut. Et ce n’est pas seulement le cas pour les quintes telles qu’elles ont été faites par les anciens et telles qu’on les trouve encore sur certains jeux, mais aussi pour celles qui sont à l’octave supérieure, à la douzième même si elles ne sonnent pas aussi fort ou dur que les précédentes; on tâchera toutefois de les éviter car, aussi petites soient-elles, on les entend, que ce soit au clavier et au pédalier. Il ne faut pas non plus surcharger d’autres grands tuyaux qui rendent le jeu rauque et grossier et le font grogner comme des pourceaux. Au contraire, à l’aide de petits tuyaux qui seront correctement proportionnés, on fera une bonne fourniture tranchant en douceur et quoique celle-ci puisse également comporter de petites quintes, on ne devra cependant pas les entendre; elles contribuent au contraste et à la puissance.
Au septième chapitre il est dit que chaque chœur doit être par lui-même pur et régulier, mais aussi que les chœurs, les uns par rapport aux autres, du bas jusqu’en haut, doivent être correctement proportionnés; ils ne doivent pas se couvrir les uns les autres, l’un devant sa puissance à de bons tuyaux, le chœur d’à côté devant sa faiblesse à ses mauvais tuyaux ou aux trois ou quatre tuyaux qui lui font défaut d’où il résultait que tous ne sont donc pas en excellent état. Quelquefois on trouve des chevilles enfoncées en avant des tuyaux, dans les trous de la laye; ceci est presque aussi laid et constitue un grand défaut que lorsque les chœurs ne sont pas égaux, en un endroit, en haut, dans le déchant (Discant), ou en bas, ils sont plus forts ou plus faibles. De même, le pédalier et le clavier doivent nettement se distinguer l’un de l’autre.
De même dans chaque registre on comparera les chœurs afin qu’il n’y ait pas un tuyau qui sonne librement et fort et que l’autre I'on ne l’entende à peine de moitié, comme on l’a dit plus haut.
De même, il est nécessaire que chaque touche, sur l’ensemble du clavier et registre, ait son propre chœur et ne soit pas une fiction comme dans certains jeux lorsqu’un ou plusieurs registres ne peuvent descendre plus bas que le c-fa-ut ou b-mi, et que les touches plus basses parlent à d’autres registres ou même demeurent muettes; ceci est le fait d’une mauvaise facture et il est maladroit de la part des organiers d’estropier et de mutiler ainsi un jeu car, comme le dit le philosophe, un élément difforme modifie profondément le corps tout entier en lui donnant une forme disparate. Quelles sont alors la correction et l’harmonie d’un jeu auquel manquent de nombreux membres?
Le huitième
chapitre traite de l’accord des orgues et indique le moment auquel il
convient de le faire, la manière dont chaque chœur doit être
accordé dans les aigus ou dans les graves, la manière dont
on y réalisera les intervalles ou les accords, à savoir
l’unisson, la quinte, l’octave, la quarte, la sixte, la tierce, au moyen
desquels s’effectue toute la musique vocale ou instrumentale. (Consulter
une version simplifiée de ce tempérament).
Mais il est inutile d’exposer ici comment se divisent et se nomment
selon la perfection ou l’imperfection les intervalles ici considérés;
nos autores et les musiciens leur ont consacré suffisamment
de pages. Quand bien même l’on tient à introduire ces intervalles
en question, chacun dans sa perfection et sa totalité, — et c’est
bien ainsi qu’ils sonnent le mieux à l’oreille, lorsqu’on s’en
sert isolément —, une fois assemblés deux par deux ils ne
concordent cependant jamais, tandis que chacun d’eux est parfait par lui-même;
prenons par exemple une quinte entière c-fa-ut et g-sol-re-ut
: si la tierce qui en forme le milieu s’accorde bien avec le
g-sol-re-ut comme tierce imparfaite ou tercia minor semi-ditonus
elle formera par contre avec c-fa-ut une tierce parfaite ou
tercia major ditonus qui ne sera pas bonne, à savoir trop
haute; car lorsque les quintes sont justes, les tierces comme celles que
nous venons d’évoquer sont alors trop hautes, épouvantables
et dures.
Tu pourras expérimenter cela de la manière suivante prend
f-fa-ut, ensuite quatre quintes les unes à la suite des
autres, la dernière donnera donc a-la-mi-re, à savoir
une tierce parfaite ou une double dixième et une double Sixte trop
hautes par rapport à f-fa-ut et c-sol-fa-ut.
Si tu ne composes ensuite que des tierces justes, les quintes seront
alors trop hautes; prend quatre tierces l’une à la suite de l’autre,
c-fa-ut, e-la-ml, g-sol-re-ut, b-fa-b-mi, d-la-sol-re, tu verras
alors l’état des quintes; et il en va ainsi de même avec
les autres.
De même, si
l’on superpose trois tierces parfaites, chacune étant bonne en
elle même, le dernier son sera à l’octave du premier, mais
toutefois trop bas et pas assez haut, comme par exemple c-fa-ut, e-la-mi,
post-sol (sol#) ou fa in a-la-mi-re (la b), et c-sol-fa-ut. Si l’on
prend par ailleurs une quinte parfaite et sur cette même quinte
une quarte bonne en elle-même, cette dernière sera alors
trop haute par rapport à la première et [l’octave ainsi
obtenue ne sera] pas une bonne octave; ainsi c-fa-ut, g-sol-re-ut,
c-sol-fa-ut : c-sol-fa-ut est trop haut par rapport au c-fa-ut
de l’octave inférieure.
Si l’on monte ensuite de quatre quartes comme par exemple gama-ut,
c-fa-ut, f-fa-ut, b-fa-b-mi, post-re (ré #) ou fa in e-la-mi-post
(mi b), le même post-re sera à une sixte ou à
une double sixte, mais trop basses, par rapport à g-sol-re-ut,
ou à gama-ut.
Mais comme les intervalles sont bons lorsque chacun est pris pour
soi, et ne peuvent s'accorder les uns les autres ou se supporter mutuellement,
il faut donc les amputer chacun et les réunir afin que l’un contribue
à supporter l’autre comme il est décrit ci-dessous de sorte
que l’on puisse les utiliser les uns avec les autres et que les dissonances,
celles que les organiers appellent le loup, soient autant que possible
réparties et disposées là où elles causeront
le moins de désagrément.
Car il n’y a pas d’orgue ou de positif, quelle que soit la nature de ses
tuyaux — qu’ils soient en métal, en bois, en papier, en toile ou
en verre —, ni même d’autres instruments de musique ayant des cordes
métalliques ou en boyau, comme les clavicordes, clavicymbalums,
symphonies, luths, harpes, etc. .. quel que soit le nom qu’ils portent,
et qui présentent tous des demi-tons, qu’il soit possible d’accorder
intégralement et parfaitement en tout point. C’est pourquoi aujourd’hui,
comme sans aucun doute avant nous, on verra la nécessité
d’une application et d’un travail intenses afin de venir à bout
de ce manque et de ce défaut. Il y a douze ans, par exemple, on
a construit un jeu qui possède des demi-tons doubles (doppel
Demitonien) aux claviers et au pédalier. La cause en fut que
les demi-tons habituels étaient soit trop hauts, soit trop bas;
les autres, ceux que l’on appelait semi demi-tons (halb Semitonien)
ou encore ignoten, devaient remédier à cela à
l’aide de leurs tuyaux et de leurs chœurs exceptionnels; mais ce fut en
vain, ils étaient inutilisables. C’est pourquoi il a fallu à
nouveau démonter tout cela, et ce ne fut pas une modeste somme
qu’il fallut engager pour réparer cette sottise ! En construisant
l’orgue dont on vient de parler, les deux organiers en question crurent
apporter quelque chose de neuf, et en tirer de la gloire face à
d’autres maîtres, quoique ces derniers eussent cependant déjà
essayé et recherché de nombreuses possibilités; mais
tout leur savoir-faire demeurait impuissant; il en fut là comme
des organistes qui désirent acquérir une nouvelle méthode
et se familiariser avec une nouvelle pratique, ce qui, à mon sens,
ne donne rien. Mais puisque tout cela est exposé sans attaque personnelle
et que l’on doit pourtant pouvoir se servir des orgues, je me suis appliqué
à donner aux organistes une instruction et un enseignement, ce
qui, à mon avis, est tout à fait nécessaire et indispensable,
au sujet de l’accord des jeux et de leur tempérament, comme suit.
Mais cela ne s’adressa pas seulement aux organiers, mais aussi aux organistes.
Certains peu instruits ou peu expérimentés en la matière
devraient acquérir de l’adresse, de montrer cela aux organiers,
de les aider et les assister de leurs conseils en vue d’une parfaite réalisation
des jeux (22).
Ainsi, commence sur
f-fa-ut au clavier et prend sa quinte ascendante c-sol-fa-ut
(23); cette dernière, ne l’accorde pas
trop haut ou tout à fait juste, mais abaisse-là (in die
niedere schweben) (24) autant
que l’oreille pourra le tolérer; (et) cependant qu’à l’usage
une telle quinte ne retienne pas facilement l’attention; mais, lorsque
l’on fait sonner les touches ou les chœurs des quintes en question, et
qu’on les maintient un moment, il faut que l’on entende que cela sonne
de manière instable avec des tremblements, résistent et
tendent, tant bien que mal, à se fondre l’un dans l’autre.
Lorsque le c-fa-ut est accordé, accorde alors sa quinte
ascendante g-sol-re-ut de la même manière et de même
la quinte au-dessus de g-sol-re-ut, à savoir d-la-sol-re.
Tu disposes ainsi de quatre chœurs et de trois quintes. Mais cesse
après cela de monter plus haut par quintes afin que les tuyaux
ne deviennent pas trop petits [et] qu’on les entende encore bien distinctement
chacun. Alors recommence à nouveau à l’octave inférieure
de d-la-sol-re, celle que nous venons d’accorder en dernier et
accorde-la de manière Juste. Ensuite la quinte ascendante de d-sol-re,
à savoir a-la-mi-re, et laisse-la flotter aussi bas
que possible.
De même pour la quinte suivante au-dessus, à savoir e-la-mi;
accorde ensuite e-la-mi à son octave inférieure
juste. Quant à sa quinte ascendante mi in b-fa-b-mi ou b-dur
(si bécarre ou "b carré"), elle sera également
accordée plus bas à la manière des autres quintes
dont nous venons de parler.
Lorsque les touches ou les chœurs en question sont ainsi accordés,
donne alors à chacun son octave ascendante et descendante de manière
à ce qu’elles soient accordées juste et bien (das sie
gantz und woll jnn stehen), et tu disposeras alors de toutes les touches
diatoniques (claves naturales). Mais il faut avant toutes choses
que les octaves soient sonores et s’accordent parfaitement les unes avec
les autres.
Mais le fait que l’on doive forcer les quintes contre leur nature et les
accorder plus bas qu’elles ne le souhaitent, cela n’est pas sans raison,
car si on les laissait entières et justes, les tierces seraient
trop fortes (zü vil starck) et trop hautes; afin de prévenir
cela, il est nécessaire d’affaiblir les quintes et de les accorder
plus bas; car [de] chaque chœur accordé de manière juste
et parfaite à sa quinte inférieure, comme par exemple d’
e-la-ml à son ditonus ou à sa tierce parfaite
inférieure, à savoir c-sol-fa-ut, [on obtient alors]
un intervalle trop grand. Il en va ainsi pour tous les autres.
Quoique les tierces parfaites ne soient pas bonnes, mais qu’elles soient
toutes trop hautes, il est cependant nécessaire de veiller à
soigner l’accord des tierces c-fa-ut - e-la-ml, f-fa-ut -
a-la-mi-re et g-sol-re-ut - b-dur, autant toutefois
qu’elles se toléreront réciproquement compte tenu de leurs
quintes, la raison en est qu'on les utilise beaucoup plus souvent que
les autres; mais les tierces dont on vient de parler seront d’autant meilleures
que l’intervalle du post-sol à l’e-la-mi et au b-dur
sera mauvais. Mais cela a moins d’importance que les tierces dont
nous venons de parler ainsi que nous ajouterons plus loin au sujet du
post-sol.
Voyons à présent
ce qu’il en est des demi-tons, des bémols ou des feintes (Semitonien
oder b mollen oder Conjuncten) quelle que soit leur dénomination.
Commence sur le f-fa-ut que nous avons précédemment
accordé. Prend sa quinte inférieure en b-fa-b-mi, c’est-à-dire
le b-mol ou fa in b-fa-b-mi et accorde-le suffisamment haut
vers le f-fa-ut, de telle manière que la quinte ne soit
pas juste, mais que tout en tremblant (schwebent), elle soit tirée
vers le haut autant que le permettra sa tierce supérieure d-la-sol-re.
les quintes sous b-fa-b-mi, comme le post-re puis le post-sol
s’accordent le plus haut et le mieux avec les tierces intermédiaires
à savoir g-sol-re-ut et c-sol-fa-ut, (tierces) qui,
autrement, sonneraient très désagréablement là
où les quintes tirées vers le haut
(25) et que nous venons d’évoquer ne leur viendraient
pas en aide.
Lorsque le b-fa-b-mi est ainsi accordé, prend alors sa quinte
inférieure, fa in e-la-mi ou post-re, ou encore dis
(ré #), quel que soit le nom qu’on lui donne; on la haussera
également vers b-fa-b-mi ainsi qu’ils été
dit de la quinte précédente et donne ensuite à ce
post-re, son octave ascendante juste.
Donne ensuite à ce même post-re sa quinte descendante
vers fa in a-la-mi-re, ou post-sol ou gis (sol #); non
pas trop haut, mais, à titre d’essai au moment de la vérification,
plus petite que la quinte juste. Cela profite à l’e-la-mi et
au b-dur dans la clausule en a-la-mi-re; il n’en reste pas
moins que le post-sol ainsi accordé ne donne pas une tierce
juste ou une sixte parfaite avec la quinte [formée par l‘]
e-la-mi et le b-dur lorsqu’on clausule en a-la-mi-re; par
exemple lorsqu’on veut clausuler ou parvenir à perfection et tenir
un repos, ainsi qu’on le dit communément, il faut que précède
une sixte parfaite ou sixte majeure d’une quinte et d’un ton. On tolérera
cependant cela plutôt ici qu’ailleurs, étant donné
qu’il s’agit d’une clausule et qu’il n’est pas indispensable que le post-sol
du déchant soit tenu aussi longtemps que les autres sons; on
pourra au contraire, dans une telle clausule dissimuler le déchant
au début par une petite pause (Peusslein) ou par une diminution
droite (gerader Diminutz), une petite mesure (Tectlein), un
passage (Leufflein), un petit trait (Risslein), une fioriture
(Floratur) selon le nom que tu voudras lui donner, afin que la
dureté souvent remarquée des clausules passe inaperçue,
comme sait le faire un organiste adroit ; il est impossible de faire cela
dans les autres accords comme post-sol - post-re - c-sol-fa-ut,
car on ne s'en sert pas comme d’une clausule vers post-ut, mais
on en dispose ailleurs et on l’exécute à l’orgue au titre
d’un de ces accords de 3 ou 4 voix simultanées que donne le contrepoint.
C’est pourquoi il
est nécessaire que [les sons] soient tempérés et
accordés de sorte que l’on puisse s’en servir selon que l’exige
la musique car les demi-tons n’ont pas été inventés
ou faits en vain. Mais certains sont d’un autre avis et prétendent
qu’il vaut mieux ajuster le post-sol à l’e-la-mi et
au b-dur pour clausuler en a-la-mi-re, que de l’ajuster
au c-sol-fa-ut et au post-re. Cela m’étonne beaucoup
de leur part qu’ils affaiblissent ainsi la musique et lui ôtent
sa spécificité propre, à savoir la douceur des accords
justes et ceux étranges.
Sans les demi-tons, il est impossible de [les] faire [sonner] aussi agréablement
et de les assembler les uns à la suite des autres, ce qu’ils finissent
bien par avouer. Et il ne fait également aucun doute que même
si pour leur part ils ne savent pas faire cela, ils prennent cependant
plaisir comme tout autre homme, à écouter une belle mélodie
jouée par un autre organiste à l’aide des demi-tons; ils
admirent et en font des louanges plutôt que de la mépriser
et de le critiquer. J’ai eu beaucoup d’entretiens à ce sujet et
j’ai pris conseil auprès des plus grands et des plus célèbres
musicos speculativos et practicos de notre époque que je
ne cesse de vénérer ; et j’en ai rencontré
beaucoup qui furent de mon avis; de même certains des organistes
et organiers qui, il y a des années partageaient un autre avis
et qui me contredisaient violemment, ont reconsidéré à
présent leurs positions et modifié leurs opinions; ils se
sont rangés à mon avis et c’est ce que manifestent les orgues
qu’ils ont construits depuis ce temps là. Toutefois il se trouve
encore bien certains qui ont eu honte d’avoir partagé l’autre avis;
mais, pour avoir erré aussi longtemps et tardé à
reconnaître leur erreur, ils ne démordent pas de leur opinion;
l’organier cédera à ces derniers en s’appliquant à
accorder le jeu de la manière dont on le lui aura demandé;
et lorsque tout sera bien en place, son travail s’arrêtera là.
Poursuis et reprend sur b-fa-b-mi, mi ou b-dur ; il s’ensuivra alors le reste des demi-tons. Ainsi donne à b-dur sa quinte ascendante mi in f-fa-ut, c’est-à-dire post-fa, ou encore fis, et abaisse-la légèrement afin que la tierce [que forme le post-fa] entre d-sol-re et a-la-mi-re ou encore que la sixte parfaite [avec l’octave inférieure d’] a-la-mi-re renforcée de la quinte [descendante] d-sol-re soient utilisables et ne soient pas trop hautes; conformément au fréquent usage de la clausule en g-sol-re-ut,tandis que l’on utilise et apprécie rarement le d-sol-re dans la quinte b-dur et post-fa; [accorde ensuite] assez justement post-fa à sa quinte supérieure, fa in d-la-sol-re [ou] post-ut, ou encore cis, afin que l’on puisse l’utiliser avec a-la-mi-re et e-la-mi, comme une clausule habituelle en d-la-sol-re. Et quoique le post-ut en question soit trop bas par rapport à sa quinte supérieure post-sol, cela n’a pas d’importance car on ne l’utilise pas, à moins de jouer intégralement per fictam musicam; c’est-à-dire sur toutes les touches noires, ce qui est sans nécessité; et les compositeurs n’écrivent aucun chant intégralement en notes étrangères. A moins que l’un d’eux cependant se mette, par curiosité ou par goût de l’étrange, à progresser per fictam musicam, le premier ton en b-fa-b-mi, par exemple, ou le cinquième en e-la-mi etc. .. L’organiste cependant n’est pas tenu pour autant de le jouer selon ces notes, mais pourra au contraire le transposer vers le haut ou vers le bas afin d’éviter l’usage des demi-tons qui sont les plus dissonants, a savoir post-ut et post-sol.
C’est encore ici le lieu d’examiner en quelle période de l’année il convient d’accorder les orgues. Les organiers répondent à cela qu’il est préférable de les accorder en été plutôt qu’en hiver à cause du froid, car lorsqu’on enlève les tuyaux ils se réchauffent entre les mains de sorte qu’ils changent de son et deviennent plus aigus. Lorsqu’on les replace ensuite sur les sommiers, il faut attendre qu’ils aient refroidi pour entendre leur sonorité exacte; de plus, il est bon de mettre des gants de cuir pour saisir les tuyaux, froids par nature, afin que le métal ne reçoive aucune chaleur, comme celle des mains. De même, il arrive fréquemment en hiver, lorsqu’on essaie un tuyau en soufflant à l’intérieur, que l’humidité par le pied du tuyau parvienne jusqu’à l’embouchure où elle gèle et modifie le son de sorte qu’il faut le sécher au-dessus du feu ou autrement. De même les courtes journées d’hiver ne permettent pas de travailler beaucoup, à moins d’utiliser des chandelles. C’est pour toutes ces raisons et pour d’autres encore qu’il est plus commode et plus avantageux d’accorder en été. Mais je ne saurais dire si les jeux accordés en hiver ou en été seront d’autant plus résistants; je connais en effet des jeux accordés en hiver qui pour l’instant tiennent encore leur accord, mais j’en connais également de semblables qui ont été ainsi accordés en été.
Le neuvième chapitre traite de la laye (Laden) ; elle sera faite dans du bon chêne dont le bois sera brillant, bien travaillé, sans nœuds, d’une belle espèce, vieux et sec et dont la madrure ressemblera presque à une toile faite de poils de chameau ; certains parlent en effet d’un bois de chêne " glacé " (gespigelt) ; on utilisa également du noyer pour faire les layes quoique le chêne jouisse d’une plus grande considération.
Ainsi, on extrait le cœur ou l’aubier; on retournera alors le bois en le superposant aubier contre écorce, et plus on en superpose, mieux cela sera; lorsque de ces morceaux il y en a trois ou plus, on pourra encore les inverser selon la longueur de telle sorte que le bois ne se trouve nulle part réassemblé de la manière dont il se présentait à l’origine, et on les réunira à l’aide d’une bonne colle d’arquebusier; on creusera proprement les trous de chape (sauber zellirn); les gravures (Zellen) et les autres trous seront imbibés avec une bonne quantité de colle. D’autre part le sommier, les registres et les soupapes seront bien ajustés de sorte qu’en s’assemblant ils reposent bien et de manière précise les uns sur les autres ainsi que savent le faire les maîtres organiers eux-mêmes ou le bon menuisier; il est nécessaire et bon que l’on fasse cale de cette manière. De même les registres (Registet) ne seront pas trop minces au point que l’on soit obligé de les contraindre avec force à rester droits et à garder leur forme originelle; au contraire, d' une épaisseur de quatre doigts, et s’ils sont taillés dans la matière d’un beau bois de chêne, ils resteront alors droits, coulisseront facilement — à condition que la pression exercée par le haut et destinée à bien les appliquer ne soit pas trop forte —; et ainsi, puisqu’ils ne se tordront pas, il sera d’autant plus facile et plus aisé de les tirer. (26)
De même, les soupapes seront en sapin, d’une forme allongée et étroite comme nous l’avons vu au troisième chapitre; elles seront cependant plus larges et plus longues que les gravures; et I'on veillera à ce qu’elles les recouvrent partout puisqu’en été elles rétrécissent et se font plus étroites à cause de la sécheresse, afin qu’elles recouvrent toujours les gravures et qu’elles ferment avec précision.
De même, dans la mesure où l’on construit et prépare les soupapes, ainsi que les registres, le sommier et le clavier, en fonction du climat, afin qu’ils ne s’étirent, ne se fendent ou ne se tordent, il sera particulièrement bon [de savoir] comment il convient de préparer le bois ainsi que me l’a enseigné une éminente personne — que la Grâce de Dieu soit avec elle — afin qu'il ne se modifie pas sous l’action de la chaleur, de l’humidité ou de la sécheresse; et ils conservent ainsi naturellement leur forme primitive comme les carreaux d’arbalète que l’on tire également par temps humide ou par temps de pluie. J ai également fait essayer cette sorte de bois ainsi préparé et j’ai constaté qu’on peut facilement le coller et que les pièces fendues tiennent, sans colle, par simple assemblage de leurs parties; selon l’avis d’artisans expérimentés, cela serait cependant moins solide, comme me l’a fait savoir le menuisier ou coffretier d’un prince; cependant la manière dont il faut préparer une telle pièce de bois et les instruments qu’il faut utiliser, feront encore ultérieurement l’objet d’un autre imprimé.
On veillera également à ce qu’il n’y ait pas de difficulté à tirer les registres et cela sans que le vent puisse s’échapper de l’un vers l’autre car lorsqu’on repousse un registre, il ne faut pas que certains tuyaux ou chœurs continuent de sonner tandis que l’on maintient la touche enfoncée. On veillera de même à ce que le sommier soit suffisamment long et large afin de donner aux tuyaux et aux chœurs une place afin qu’ils ne soient pas fichés à l’étroit les uns sur les autres de sorte que, lorsqu’il faut les améliorer, on puisse plus facilement les ôter et les remettre en place. De même il arrive souvent que lorsqu’ils sont disposés aussi près les uns des autres, jusqu’à se toucher, ils changent de son, deviennent tremblants et produisent un son aigre comme celui des violes ou des trompettes marines ou celui que l’on obtiendrait en chantant à travers un peigne. Cela arrive aussi parfois lorsque le métal des tuyaux est trop mince.
De même les registres doivent être suffisamment espacés afin que leurs tirants (Stangen) ne soit pas trop à l’étroit, ne se frottent les uns aux autres, ou ne s’entravent ; il en va de même des vergettes et des abrégés.
De même le sommier sera suffisamment spacieux à l’intérieur afin que l’on puisse y accéder sans difficulté, ainsi que l’exige toute réparation des ressorts ou des soupapes et des boursettes (Secklein); il peut arriver par exemple qu’une poussière vienne se glisser entre une soupape et le sommier de sorte qu’elle ne se ferme plus; c’est la raison pour laquelle le chœur en question continue de sonner. il arrive également qu’un ressort se brise, se détente ou s’échappe.
De même le sommier
ne doit pas être encollé avec du cuir ou autre chose puisqu’il
faut alors l’arracher et le recoller à nouveau; au contraire on
le fermera à l’aide de petits verrous en fer ou de taquets en bois
que l’on pourra ouvrir au moment même où cela sera nécessaire
et le refermer à nouveau.
Dans la mesure où la planchette ou la petite porte du sommier sera
garnie à l’intérieur en haut et en bas de cuir, le vent
ne pourra pas sortir; ainsi n’a-t-on aucunement besoin de colle; il suffit
que tout soit en ordre et à sa bonne place; voilà en outre
ce que j’ai pu observer sur plus d’un orgue et c’est l’un des plus grands
défauts c’est lorsque les sommiers ne sont pas fixés assez
solidement et ne sont pas stables. Par ailleurs on s’accorde à
dénoncer comme un de ces fâcheux avantages le fait que dans
certains jeux, aussitôt que les soufflets se mettent an action,
les tuyaux sonnent par eux-mêmes de leur mieux et se font entendre
sans l’aide de l’organiste, que celui-ci le veuille ou non. Mais il arrive
aussi qu’un jeu sonne pour des raisons moins importantes auxquelles il
est facile de remédier. Par exemple lorsque les vergettes sont
trop à l’étroit, qu’elles entrent mutuellement en contact
ou se bloquent ou encore les tringles des vergettes (Drähte der
Züge) en dessous des claviers; il en va de même en haut,
lorsque les abrégés entrent mutuellement en frottement,
ou lorsque les tringles ne sont pas partout correctement coudées
et écartées les unes des autres. Il en va de même
des abrégés et de leurs fers [qui n’ont] pas assez de place,
ou que les vergettes entrent en frottement avec les tirants des registres.
Il arrive également que le clavier se distende et se bloque à
cause de l’humidité de l’air, ou bien que quelque chose tombe et
qu’elles ne fonctionnent plus librement. J’ai également déjà
vu une table d’abrégés tordue et courbée par le temps
de sorte que certains abrégés ne fonctionneraient plus correctement,
à quoi il fut facile de remédier. De nombreuses causes peuvent
aussi contribuer à ce qu’un jeu braille, fasse beaucoup de bruit
et qu’on aille jusqu’à penser qu’il est en ruine, alors que l’on
peut facilement remédier là ces défauts dans le mesure
où l’organiste peut facilement accéder; c’est ce que les
organiers feraient bien pour commencer de prendre en considération;
ils construiront le sommier et le buffet (Corpus) de telle manière
qu’on puisse l’ouvrir de l’arrière, de l’avant, des côtés,
d’en haut et d’en bas, qu’on puisse aussi accéder facilement aux
claviers lorsqu’une tringle du clavier ou des vergettes se brisent en
bas ou en haut, ou qu'elles se dilatent de sorte que les touches descendent
et deviennent inégales ou encore que les soupapes ne s’ouvrent
pas suffisamment.
Il est facile de remédier à cela; même pendant que
l’on chante dans les offices divins, et avant que l’organiste ne se remette
à jouer; de temps à autre il est nécessaire de faire
appel à un organier pour réparer un jeu; ce que bien souvent
l’organiste pourrait faire si le jeu était bien conçu et
si on pouvait l’ouvrir selon ce que nous venons de dire.
De même, il est également tout à fait nécessaire de disposer le jeu de manière à ce que les rats et les souris ne puissent y pénétrer; lorsqu’ils ont accès aux sommiers ils rongent les tuyaux, les renversant en les tordant et en les arrachant de leurs trous. Si quelque chose tombe ensuite dans les trous, cela peut facilement se glisser dans une soupape de sorte que ça hurlera et sifflera; il sera alors malaisé de se servir de ce jeu. J’ai trouvé pour ma part entre autres choses, de la paille, de la corde à filets, des cordes de luth, de petits copeaux et d’autres choses que les rats avaient portés et tissés à l’intérieur du jeu entre les tuyaux. Ce sont là des hôtes importuns auxquels il convient de refuser la porte.
De même les volets qui protègent le devant du jeu et les tuyaux de la poussière, des insectes et d'autres choses, ainsi que des chauves-souris et des oiseaux qui, en s’introduisant dans l’église, s’installent sur les tuyaux, ou volent dans les embouchures, les salissant, ne seront ni trop lourds ni trop massifs afin qu’ils ne s’affaissent pas; de même, s’ils pèsent trop lourd, ils s’ouvriront et se fermeront difficilement; ils seront au contraire aussi légers que possibles afin qu’ils se meuvent en douceur et qu’ils ne se cognent ni ne s’entrechoquent, qu’ils ne déplacent ou ne heurtent les tuyaux.
Le dixième chapitra traite du vent dont chaque jeu doit être abondamment pourvu; car lorsqu’il n’y a pas suffisamment de vent, les tuyaux ne donnent pas la plénitude de leur son car ils ne sonnent que si le vent est fort et constant. Un jeu de la dimension de celui qui a été décrit plus haut au second chapitre, nécessite bien cinq ou six soufflets, chacun de neuf ou dix pieds de long et de trois pieds de large et [fait] de fortes planches de trois pouces, de telle manière qu’une fois rabotées et travaillées elles présentent encore une épaisseur de trois doigts; le bois de pin conviendra mieux que le sapin ou le chêne; les planches de trois pouces se prêtent également bien au travail, car elles sont solides et résistantes, elles ne se fendent pas aussi facilement que le sapin sous l’action des pointes lorsqu’on y cloue le cuir. De même, pour les soufflets, on choisira de préférence un cuir de bœuf souple. Ça monte et ça descend facilement; il se replie correctement et il est toutefois résistant; il aura cependant un où deux tans de plus que les autres cuirs et il ne sera pas trop plamé (dégraissé à l’aide de chaux); les tanneurs sauront les préparer de cette manière-là.
Il est plus avantageux de poser les soufflets de telle manière que le vent parte vers le haut car lorsqu’on le force à descendre, c’est contraire à sa nature qui est d’être une chose légère. il est nécessaire que les soufflets soient étanches et entièrement de bois et de cuir. De même on veillera à l’étanchéité du canal qui conduit l’air des soufflets vers le sommier. Que les soufflets fonctionnent en douceur, qu’ils ne gémissent ni ne distribuent l’air par à-coups de sorte que les tuyaux ne cesse de faire entendre à quel instant les soufflets s’abaissent ou remontent; au contraire que le vent alimente les tuyaux de manière continue et sens aucune variation. Pour vérifier cela, procède de la manière suivante : tiens sur le jeu tout entier un accord de 6 ou 7 touches simultanément au clavier et au pédalier et aussi longtemps qu’il faut à quelqu’un pour réciter deux ou trois Pater noster; tu entendras alors parfaitement si le vent vient de manière régulière et en quantité suffisante.
il est également bon et nécessaire que les planchettes ou les petites portes des soupapes au bas des soufflets qui reçoivent et enferment le vent, soient ajustées de telle manière qu’elles ne se tordent pas mais qu’elles restent droites et ferment correctement; car dans la mesure où un jeu sera réglé pour recevoir un vent d’une bonne puissance et qu’il le perd tout à fait ou en partie, son volume sonore baissera et risquera ainsi d’être promis à la ruine. C’est pourquoi l’on enduira également les soufflets pour [les protéger] des rats et des souris, afin que les soufflets demeurent entiers et intacts; mais je remets à une autre fois la manière dont on fabriquera cet enduit.
Certains construisent des chambres spéciales pour les soufflets afin de les mettre à l’abri des rats. Mais cela n’est pas toujours très efficace. Certains sont d’un autre avis, celui de laisser les soufflets à l’air libre sans les enfermer; les rats seraient alors moins tentés de les attaquer et de leur causer des dommages; car, disent-ils, c’est le propre même et la manière d’être de l’animal que d’exciter son désir et de travailler secrètement à pénétrer dans un lieu fermé plutôt que dans un lieu libre et ouvert, ce que je serais également porté à croire. Je connais précisément un jeu dont les soufflets reposent sur une voûte, à l’air libre, ni cloisonnés ni enfermés; c’est ainsi qu’ils ont reposé prés de 20 ans sans que les rats ou les souris les aient attaqués. Cependant je ne saurais dire si l’on doit cela à ces derniers ou bien à l’enduit ; mais je conseillerais cependant pour commencer, de passer sur les soufflets un enduit adéquat pour [les protéger de] ces détestables animaux; mais on les enduira tous les trois ou quatre ans non pas seulement à cause des rats mais également à cause du cuir afin qu’il demeure souple et solide, qu’il ne devienne pas trop dur et trop résistant ou qu’il ne se déchire et qu’il s’y forme des trous; cela arrive souvent et c’est au grand détriment du jeu; car si le jeu a été réglé pour un important volume d’air, et si ce dernier diminue, comment subsisterait son effet?
De même ceux qui foulent les soufflets ou qui les lèvent des mains, selon l’usage local, veilleront à les comprimer prudemment et d’un mouvement régulier et à les laisser remonter en douceur; cela ne doit pas se faire par à-coups; les comprimer brutalement et les laisser remonter rapidement, car ainsi, comme toutes les choses auxquelles on fait violence et dont on se sert sans ménagement, ils ne se conserveront pas longtemps.
De même, un
jeu d’une facture récente doit être rénové
et révisé après un ou deux ans et si on l’entretient
de la sorte, il subsistera longtemps et demeurera en bon état.
Il n’est pas bon ni plus avantageux, ainsi que certains le prétendent,
de ne jouer que rarement sur les jeux afin de leur assurer une vie plus
longue. Il faut au contraire en jouer chaque jour ainsi qu’il se doit
et en jouer sans ménagement; on les conservera ainsi en meilleur
état, qu’en les délaissant tout à fait. C’est pourquoi,
même dans les périodes du Carême et de l’Avent où
l’on doit faire taire l’orgue, on les essayera cependant de temps en temps;
on les examinera en outre afin de prévenir toute défectuosité,
contre la rouille, la poussière, les toiles d’araignées,
peut-être aussi les rats et les souris, et autres choses encore
qui donneraient à de nombreuses pièces d’un jeu l’occasion
de disfonctionner et de tomber en ruine; en effet, étant en repos,
tout cela y prend bien mieux racine que lorsqu’il reste en usage.
A moins toutefois qu’on ne fasse pas d’un jeu un usage convenable ou correct,
comme cet organiste qui a perdu la raison et a été d’une
telle maladresse que, lui ou quelqu’un d’autre, après l'avoir gratifié
de transports trop violents, fit qu’un registre ou l’autre aurait été
forcé et se serait brisé; j’ai entendu dira que cela se
serait passé quelque part; toutefois je ne l’ai pas vu. S’il en
a effectivement été ainsi, il me semble qu’un tel organiste
ferait mieux de dormir ou de fendre du bois que de jouer de l’orgue, et
cela profiterait également au jeu.
Mais il n’est pas nécessaire de s’étendre plus longuement,
sur ce sujet. Que l’organier ou l’organiste doué d’un peu de bon
sens se serve du présent opuscule pour son profit afin de s’appliquer
à prendre soin de celui dont il sera responsable et qui lui aura
été confié.
Lorsqu’il s’agit de construire ou d’examiner, lui et d’autres avec lui, ceux qui le secondent, gagneront ainsi estime et reconnaissance, ce qui fait souvent défaut; mais il s’ensuit le contraire lorsque par malheur l’on manque d’expérience en la matière et que l’on aborde ces [tâches] en ignorance. J’en ai connu qui ne savaient pas emboucher un tuyau, ou faire toute autre chose se rapportant [à la facture d’orgue], et cependant la présentation adroite leur a valu d’être pris au service de princes et d’autres maîtres de talent; ces derniers ont commencé à construire les jeux en toute liberté et en grande pompe, mais ne les ont pas terminés de la même manière; lorsqu’ils firent examiner leur œuvre, il s’avéra que c’était un échec et qu’ils en avaient réalisé moins que ce dont ils s’étaient vanté et qu’ils avaient commencé à réaliser. C’est pourquoi certains d’entre eux ont pris congé avec une mince gloire et un piteux salaire; pour sûr, il n’aurait été que justice s’ils avaient eu à rembourser les frais et dommages qu’ils ont causé alors qu’ils en auraient eu les moyens; mais peut-être réserveront-ils cela pour le jour du Jugement Dernier. Sans compter que les jeux étaient à tel point endommagés qu’il fallut les confier derechef aux mains de nouveaux maîtres. Je n’ai pas rencontré cela seulement chez les laïcs mais aussi chez des clercs, et à la vérité trois, chacun appartenant à un ordre différent; ces derniers ont causé un véritable désastre en matière de facture d’orgue, ce qu’il me serait loisible de montrer auprès des cours princières, des abbayes, des paroisses et des couvents. Dieu veuille qu’il n’y ait plus jamais personne pour témoigner à ces incapables une confiance aveugle, [et que] chaque [organier] s’interroge sur lui-même pour savoir s’il possède une connaissance suffisante de ce dont il tente précisément de persuader ses supérieurs en les abusant sur la grande gloire et les avantages qu’ils en retireront — sinon cela échouera comme aura échoué ce qui aura été entrepris jusqu’ici —; au contraire, on gardera grand ouverts les yeux de la raison. Et on apprendra à être disciple avant de se proclamer maître afin que personne ne soit égaré ou abusé par son ignorance, Il faut être à mon avis de peu d’honnêteté pour se permettra sans aucune expérience aussi témérairement et abusivement de telles choses, alors qu’un autre s’appliquera longuement par un patient exercice à apprendre [son métier] et à l’approfondir; car si l’on réussit là, c’est grâce à une pratique constante. Il y a beaucoup d’organiers clercs ou laïcs, mais on en trouve peu qui aient fait preuve de leur maîtrise; et il ne faut pas s’étonner que maint jeu soit en mauvais état si l’on ne s’enquiert pas auprès d’un organiste de talent sur la personne que l’on prend à son service; en effet, il n’est pas toujours bon de faire confiance à des étrangers sur la simple foi de leur propos sans aucune preuve et de les engager sur le simple renom de leurs jeux.
Celui auquel [l'on]
fera confiance, manifestera la volonté de tenir ses engagements
et de les honorer; il tolérera auprès de lui la présence
de gens raisonnables, à la fois pour sa renommée personnelle
et pour offrir une garantie de son travail mais que l’on se méfie
de ceux qui parlent ainsi "vous n’avez nul besoin d’un organiste; il suffit
de ma personne pour vous servir et mon travail sera correct ". Il me semble
qu’il y a à s’enquérir à leur sujet, car il arrive
enfin que l’on ne commence à prendre conseil et à éprouver
des remords qu’une fois que l’on s’est disputé au sujet de l’affaire.
Cela n’est pas seulement le fait de gens totalement ignorants, mais aussi
de ceux qui passent pour être des maîtres, mais qui redoutent
et craignent de faire examiner leur travail; ils prétendent que
leurs jeux sont faits de telle manière qu’ils ne sauraient recevoir
de sanction de personne; et s’ils acceptent volontiers que les meilleurs
organistes viennent les examiner, ils proposent que l’on s’épargne
ces frais, sous prétexte que cela est sans nécessité;
enfin lorsqu’ils quittent les lieux, ils s’imaginent avoir fait du bon
travail; mais ils feraient bien de savoir que jamais des artifices trompeurs,
de méchantes ruses et la duperie n’ont su protéger ou sauver
qui que ce soit; mais au contraire que la vérité finit toujours
par surgir lorsque, par la suite, de nombreuses personnes entendent et
jugent les jeux ce qui échappera à l’un, l’autre le remarquera;
en outre celui qui travaille dans le droit chemin compte de nombreux maîtres
qui consentiraient certainement à prononcer des louanges et à
encourager si leur travail ne les en retenait pas.
Lorsqu’on leur signale ou reproche les imperfections ou les défauts
d’un jeu, ils prétendent qu’on leur est hostile et qu’on aurait
mieux fait de le confier à d’autres; [ils affirment] qu’ils ont
fait les jeux de sorte que les organistes ont tout lieu d’en être
satisfaits, enfin qu’on les a rémunérés et qu’on
leur a donné congé.
Lorsqu’on demande alors à un organiste comment il se fait qu’il
ait laissé échapper des défauts aussi grossiers,
celui-ci dira pour sa défense: " je n’ai pas entendu procéder
ici à de tels examens, je ne l’ai auparavant ni pratiqué,
ni su; j’ai également signalé cela à mon maître
et lui ai conseillé d’envoyer quelqu’un d’autre ayant de l’expérience
en cette matière; ils n’ont pas suivi mon avis, mais celui de l’organier
et l’ont cru; quant à moi, j’ai fait mon travail ". C’est ainsi
qu’un aveugle en conduit un autre et que l’on fait de petites économies
et de grosses dépenses à moitié gâchées.
Ce que l’on considère comme un gain ne l’est pas toujours. Il ne
fait aucun doute que, lorsque quelqu’un a entrepris de se faire construire
une maison ou quelqu’autre édifice, il ne confiera pas sa construction
uniquement au charpentier et au maçon; mais en recueillant également
par ailleurs l’avis d’autres spécialistes de la construction il
évitera les dégâts et les railleries. Il est également
nécessaire et raisonnable de veiller à tout cela lorsqu’on
monte un orgue, surtout lorsque plus de quatre, cinq, six cents, voire
mille ou deux mille florins ont été investis dans un jeu
et qui proviennent généralement des biens sacrés
de l’Eglise donnés par la volonté de Dieu afin que tout
cela soit dépensé à profit et loyalement acquis;
car il n’est jamais très heureux que des gens d’un esprit aussi
large, laissent passer tant de défauts, ne considérant pas
d’où provient [cet argent] ou comment il a été acquis,
ainsi que l’expérience le prouve plus d’une fois. Voilà
sincèrement et ouvertement mon avis.
Voudrait-on engager un maître réputé et le charger
de construire un jeu et de le réaliser, respectueux de sa propre
personne et sachant ce qui est nécessaire? Il sera néanmoins
bon de tenir à ses côtés un organiste connaissant
la matière et doué d’une expérience, qui, à
la manière d’un maître d’œuvre, saura donner des conseils
et veiller à ce que le jeu soit mené à bon terme.
Il arrive en effet souvent que l’on néglige certains points et
que l’on ne se rende pas compte que ce qu’il est nécessaire et
facile de faire au début, deviendra plus tard difficile, voire
même impossible à réaliser. Deux penseront toujours
à plus de choses qu’un [seul] et plus particulièrement lorsque
l’un d’eux utilise le jeu et sait s’en servir. Il faut être une
lavandière bien attentive pour n’avoir jamais égaré
le moindre lange.
C’est également le cas pour toutes les autres choses où
c’est être coupable que de sous-estimer hardiment, de négliger
et d’estimer sciemment ne pas avoir à l’examiner. Les chiens qui
ont la rage sont les premiers à être mordus. Il n’y a aucune
raison de penser qu’un organier, aussi adroit soit-il, puisse parachever
un jeu sans les directives et les conseils d’un organiste expérimenté;
et tous les défauts et impropriétés d’un jeu comme
on en trouve actuellement, pourront être prévenus dans la
mesure où l’organier sera lui-même également un organiste
de renom. Mais je n’ai pas encore rencontré ou vu quelqu’un qui
réunisse ces deux talents; puisque l’art s’est tant développé
de notre temps il s’accompagne d’une pratique très élaborée.
Mais là où deux ou plusieurs connaisseurs agiront honnêtement,
en suivant [les conseils] les uns des autres, travaillent non pas à
leur propre avantage, mais à celui du jeu et de sa facture, ils
feront un travail utile. Certains sont soupçonnés — soupçon
qui, à mon avis n’est pas fondé —, d’entretenir mutuellement
une entente secrète en ce que, lorsqu’on sollicite un organiste
de donner son avis, [l’organier] mijote deux bouillons dans une seule
marmite; lorsqu’un tel jeu est achevé, mais sans qu’il puisse en
recevoir la garantie, il arrive que celui-ci presse l’organiste de rendre
honneur ainsi que de reconnaître et juger celui-ci comme bon. Quoi
qu’il en soit, qu’ils agissent malhonnêtement ou honnêtement,
que les maîtres-d’œuvre fassent construire les jeux de telle sorte
que les précautions qu’ils auront prises les excusent. Je pense,
sans vouloir être malveillant, que ces derniers, de par leur imprudence,
de même que les organiers et organistes par leur ignorance et leur
prétention à faire, à examiner et à juger,
se sont plus employés à endommager les églises que
n’importe quelle guerre; cela m’a souvent fortement bouleversé
et m’a déterminé à écrire cet opuscule simple
et d’une compréhension facile. Je ne tiens pas à en retirer
de la gloire et une renommée personnelles, car je reconnais ma
maladresse et suis le premier à me mettre en retrait; je l’ai écrit
au contraire pour l’utilité commune des factures (gebew) souvent
citées, et si ce n’est entièrement, du moins en partie,
afin d’en réduire les frais inutiles; je n’agis contre personne,
et n’ai pas l’intention [d’amputer ce traité] de ce qu’il comporte
de droit, à moins que [cela se fasse] pour la raison évoquée
plus haut. J’en prends Dieu à témoin. Nous ne cherchons
ici-bas gloire et louange que pour accroître notre talent afin de
pouvoir l’exercer éternellement dans l’Au-Delà.
(2) En allemand Stimme. La langue de Schlick ne distingue pas entre " voix" succession de sons composant une partie d’une structure polyphonique et " sons " émission ponctuelle résultant de l’abaissement d’une touche du clavier. (retour)
(3) C’est-à-dire l’ensemble des tuyaux qui parlent sur une même touche. (retour)
(4) Ce genre de décoration ornait notamment certains tuyaux de façade de l’orgue de la cathédrale de Strasbourg. (retour)
(5) Les hauteurs sont identifiées à l’aide de la clef (A B C D E F ) et de l’ensemble des syllabes de solmisation correspondantes :
a la-mi-re =
la 3
g sol-re-ut = sol
f fa-ut = fa
e la-mi = mi
d la-sol-re = re
c sol-fa-ut = do
b fa-b-mi = si bémol 2; mi ou b dur = si
2
a la-mi re = la
G sol-re-ut = sol
F fa-ut = fa
F Ia-mi = mi
D sol-re = re
C fa-ut = ut
B mi = si bémol 1
A ré = la
Gama ut = sol (retour)
(6) On distinguait Tetracorde gravium : Gama — C; T. finalium : D — G; T. Acutarum : a — d; T. Superacutarum : d—g; T. excellentium : aa — dd. (retour)
(7)
1er ton : dsolre (ré)
2’ ton : A re (la)
3’ ton : e la mi (mi)
4’ ton : H mi (Si)
5’ ton : f fa ut (fa)
6’ ton : c fa ut (do)
7’ ton : g sol re ut (sol)
8’ ton : d sol re (ré) (retour)
(8)
mi in d-sol-re = ré bémol
mi in b-fa-b-ml = si bémol
mi in e-la-ml = mi bémol
fa in f-fa-ut = fa diése
post-sol
post-gama-ut = sol diése (dans les cadences sur la)
post-ut = do diése (dans les cadences sur ré)
post-fa = fa diése (dans les cadences sur sol) (retour)
(9) Ces pièces figurent parmi les nombreuses séquences qui ont disparu lors de la réforme du missel sous Pie V (Bulle " Quo primum tempore " du 19 juillet 1570). (retour)
(10) Cf. note 8. (retour)
(11) Cf. chapitre III.
(12) Le clavier s’étend du fa 1 au la 4.
(13) Cette planche correspond à ce que nous appelons le fronton ou encore au panneau qui bouche la fenêtre du clavier. (retour)
(14) Le pédalier s’étend du fa 1 à l’ut 3.
(15) L’usage du terme demeure obscur. Cependant la suite du texte ne permet aucun doute puisqu’il s’agit bien de la détermination de la longueur apparente des touches du pédalier. On trouvera au paragraphe suivant le terme moins précis de Brett. (retour)
(16) A. Schlick séjourna en 1490-91 aux Pays-Bas tandis qu’une épidémie de peste ravageait alors la ville de Heidelberg. (retour)
(17) Par taille courte/longue il faut entendre respectivement taille large et taille étroite. Les rapports numériques mentionnés 1/5. 1/6 et 1/7 désignent le rapport entre la largeur de la plaque par rapport à la longueur pour la Fistula authentica, c’est-à-dire le plus grand tuyau d’un registre. Il s’agit à d’une détermination proprement médiévale de la taille des tuyaux: Cf. H. KLOTZ, Uber die Orgelkunst.... p. 16. (retour)
(18) Cet instrument est encore attesté sous le nom de Strohfiedel. Il correspond à ce que nous appellerions aujourd’hui xylophone. Dans un rapport d’expertise à Spire. Schlick signalait en 1506 que les trompettes et le claquebois ne sont pas parfaitement accordés dans le grave (I. RUCKER, Die deutsche Orge / am Oberrhein um 1500, Fribourg 1940, p. 1 541. (retour)
(19) Cet instrument est également connu en France sous le nom de galoubet. Si Schlick semble rejeter l’emploi de ce registre ici, il le recommandera cependant en 1515 pour l’église de Haguenau (H. KLOTZ, op. cit., p. 62). (retour)
(20) Peut-être s’agit-il de l’instrument (gravure de Weidnïtz, 1519) dont joua Hofhaimer à Augsbourg lors d’une messe célébrée an présence de l’Empereur (cf. H. KLOTZ, op. cit., p. 911. (retour)
(21) Nous traduisons littéralement. C’est-à-dire qu’ils sonnent à l’unisson, comme le précise la suite du texte. (retour)
(22) Cette question du tempérament que propose Schlick a suscité une littérature importante tendant pour l’essentiel à l’assimiler à un tempérament égal. Toutefois comme Schlick n’indique aucune mesure précise, divers accords demeurent possibles parmi lesquels l’accord au tempérament égal ne représente qu’une possibilité, et vraisemblablement ici la moins probable, dans la mesure où il exige le plus fort abaissement de la quinte. Cf. H. HUSMANN, Zur Charakteristik der Schlickschen Temperatur, in AfMw XXIV, 1967, p. 253-265. (retour)
(23) C-f-fa-ut dans le texte. (retour)
(24) Schweben : vibrer, trembler, onduler, flotter... Au sujet de l'emploi technique de ce terme, M. Praetorius signale Das wort Schweben aber ist ein Orgelmacherischer Terminus, und wird von inen gebraucht / wenn aine Concordantz nit reine stehet : Ist aber bey inen / und daher bey vielen Organisten so sehr ublich / dass es schwerlich abzuschaffen. Dannenher ichs in künfftigen auch (wiewolgantz ungern) gebrauchen mussen / nur das dabey gefasst / hoch oder niedrig. Dann schweben sol so viel heissen / wie unrein / das ist / entweder zu hoch oder zu niedrig gestimmet / sie derivirens aber daher ; Wann man in den Orgeln / sonderlich dia Octaven, Ouinten und Quarten einzihen und stimmen wil / so schwebt der Resonantz und klang in den Pfeiffen / und schlägt gleich eim Tremulant etliche Schläge Je näher rnan es aber mit dem einstirnmen zur reinigkeit und accort bringt / je rnehr verleurt sich die Schwebung allmehlich / und werden der Schläge immer weniger / biss, so lang dz die Octava oder andere concordanten recht eintreten. (op. cit., p. 151). (retour)
(25) Il s’agit toujours de quintes affaiblies puisque les intervalles considérés étaient des intervalles descendants. (retour)
(26) il est peu probable qu’il s’agisse là des registres tels que nous les entendons aujourd’hui et tels que Schlick a déjà pu les connaître, mais de registres d’un type plus ancien connus en Allemagne sous le nom de Oberschleifen; cf. H. KLOTZ, op. cit. p. 101 et K. BORMANN, Arnold Schlïcks vier Finget dicke Registetschleife, in A O 31. 1 967, p. 1197 ss. (retour)