 ABéCéDaire
de l'orgue:
ABéCéDaire
de l'orgue:

 A
Poitiers on peut passer l'orgue de l'église
Notre-Dame si l'on veut se priver d'un bel instrument à jouer Bach
et de l'admirable architecture qui l'abrite, on peut passer aussi le superbe
Wenner de Saint
Hilaire.
A
Poitiers on peut passer l'orgue de l'église
Notre-Dame si l'on veut se priver d'un bel instrument à jouer Bach
et de l'admirable architecture qui l'abrite, on peut passer aussi le superbe
Wenner de Saint
Hilaire. ![]()
A Sainte Radegonde
![]() il y avait un
Robert Boisseau, issu d'un vieil Anneessens dont le recours à
la console électrique et le métal de la tuyauterie(*) ont
été un écran entre le projet et la réalisation,
instrument qui a disparu et remplacé maintenant par un orgue neuf qui
a été construit par le fils et le petit fils de Robert Boisseau
dans l'esprit de ce que désirait leur père et grand-père.
il y avait un
Robert Boisseau, issu d'un vieil Anneessens dont le recours à
la console électrique et le métal de la tuyauterie(*) ont
été un écran entre le projet et la réalisation,
instrument qui a disparu et remplacé maintenant par un orgue neuf qui
a été construit par le fils et le petit fils de Robert Boisseau
dans l'esprit de ce que désirait leur père et grand-père.
Ce Robert Boisseau a été l'objet du premier enregistrement d'orgue sur
disque microsillon. Robert répugnait à montrer cet orgue
au fonctionnement capricieux.
(*) En 1948,
il a fait ce qu'il a pu avec le peu qu'il avait.
Par contre l'orgue de la Cathédrale de Poitiers est
incontournable. C'est un pur Clicquot, le petit frère de celui
de Saint Nicolas des Champs
à Paris. ![]()
Il a été terminé en 1791, c'est à dire après la révolution française,
preuve que les idées de cette dernière ont eu un peu de mal à progresser
vers l'ouest.
Commencée peu après la moitié du XIIe siècle, la Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers révèle une remarquable unité d'ensemble.
Depuis 1681, la cathédrale de Poitiers n'avait
plus d'orgue de tribune, le chef-d'oeuvre de Crépin Carlier
ayant disparu dans les flammes.
 En
1770 le Chapitre entreprend toute une campagne d'embellissement. La construction
d'une nouvelle tribune sur toute la largeur du mur occidental est terminée
en 1777. En 1787 un marché est passé avec François-Henri
Clicquot aux termes duquel ce dernier s'engage à construire
"un grand seize pieds" de 44 jeux, quatre claviers manuels et
un pédalier de 28 marches, deux tremblants et neuf soufflets. Conjointement
avec celui de Clicquot, un marché est passé avec le menuisier
Fabre, un Poitevin, pour la confection du buffet.
En
1770 le Chapitre entreprend toute une campagne d'embellissement. La construction
d'une nouvelle tribune sur toute la largeur du mur occidental est terminée
en 1777. En 1787 un marché est passé avec François-Henri
Clicquot aux termes duquel ce dernier s'engage à construire
"un grand seize pieds" de 44 jeux, quatre claviers manuels et
un pédalier de 28 marches, deux tremblants et neuf soufflets. Conjointement
avec celui de Clicquot, un marché est passé avec le menuisier
Fabre, un Poitevin, pour la confection du buffet.
Comme on touchait presque au but, Clicquot meurt à Paris le 24
mai 1790. L'achèvement du travail se fit sous la direction de son
fils Claude-François qui présenta l'orgue le 4 juin 1791.
(7 mars 1791, lit-on ailleurs ?)
L'instrument passa sans encombre le cap de la révolution et même
l'autorité municipale révolutionnaire versa à l'organier
et aux menuisiers sculpteurs ce qui leur restait dû.
La cathédrale était vouée au culte de la Jeunesse.
En 1803 on donne 45 francs à un dénommé Schmitt pour
avoir réparé l'orgue et joué un "Te Deum".
Après une intervention de Dallery père en 1812 qui
se limita au déplacement de la 2e Trompette et à une réparation
des soufflets, après une intervention de Henry en 1835, facteur
d'orgue Bordelais, qui porta encore une fois sur les soufflets, sur la
mécanique et sur quelques tuyaux d'anches abîmés par
un "soi-disant facteur d'orgue" des projets de "modernisation"
sont présentés. L'un par Henry en 1837, l'autre par Merklin
en 1858, tous deux sans suite.
Pourtant l'orgue était soumis aux intempéries depuis 1838
suite au démontage de la rosace qui ne fut reposée que vers
1860. L'organiste se plaignait de cette situation qui l'obligeait à
ne se servir que du Positif.
En 1882, Aristide Cavaillé-Coll signe un devis de "modernisation",
mais l'argent manque toujours.
Le 17 août suivant, on inaugure pourtant un "orgue venant
de subir une importante réparation". A défaut de
plus de précision sur le travail effectué, on peut conclure
qu'il s'agit du remplacement de la soufflerie cunéiforme par une
soufflerie à plis parallèles compensés et la pose
d'un pédalier "à l'allemande" par la maison Merklin.
Par la suite seul un entretien très suivi par la maison Debierre
a été effectué.
En en 1926, Jean Binetti puis Robert Boisseau prennent en charge
l'entretien de l'instrument. En 1928 un ventilateur électrique
est posé. En 1953 Robert Boisseau remet les Bourdons dans leur
état d'origine (ils auraient été mis "à
calottes mobiles" par Dallery * ) et recule l'abrégé
de pédale afin de faciliter le jeu de l'organiste.
( * Pour ma part, je pense plutôt à
Merklin dont c'était l'habitude, afin de faciliter la mise au tempérament
égal).
| Positif, Ut1 à Ut5 (avec 1er Ut#) |
Grand-Orgue (id) | Récit, Sol2 à Ut5 | Écho | Pédale, Ut1 à Ut3 La0 à Ut3 pour les anches |
| Montre 8' Second 8' Prestant Doublette Plein-Jeu VII Bourdon 8' Nasard Tierce Grand Cornet V Trompette Clairon Cromorne |
Montre 16' Montre 8' Second 8' Prestant Doublette Fourniture V Cymbale IV Bourdon 16' Bourdon 8' Grande Tierce 3'1/5 Nasard Quarte de Nasard Tierce Grand Cornet V 1e Trompette 2e Trompette 1er Clairon 2e Clairon Voix Humaine |
Flûte 8' Cornet V Trompette Hautbois |
Bourdon 8' Flûte 8' Trompette |
Flûte 16' (bouchée) Flûte 8' (ouverte) Flûte 4' Bombarde Trompette Clairon |
Donc, c'est un pur Clicquot, à l'intervention de Dallery
près qui décala la deuxième trompette du grand orgue vers l'aigu afin
de la faire sonner en bombarde de 16 pieds, et de Merklin qui s'est contenté
de poser une soufflerie neuve, de tout accorder en "tempéré" en pinçant
ou en évasant les tuyaux coupés au ton et de remplacer le
pédalier "à la française" par un pédalier "à l'allemande".
C'est tout, faute d'argent.
Heureuses les paroisses pauvres qui n'ont pas eu les moyens de moderniser
leur orgue.
 Contrairement
à ce que l'on voit souvent écrit, et ce même dans le devis de Clicquot
qui, en fait, précise que "la tribune peut contenir un
grand seize pieds", l'orgue de Poitiers n'en n'est pas un mais
un "seize pieds ordinaire" tel que l'estime Dom Bedos.
Contrairement
à ce que l'on voit souvent écrit, et ce même dans le devis de Clicquot
qui, en fait, précise que "la tribune peut contenir un
grand seize pieds", l'orgue de Poitiers n'en n'est pas un mais
un "seize pieds ordinaire" tel que l'estime Dom Bedos.
La différence réside dans le fait qu'un "grand seize pied" possède
un clavier dit "de bombarde" (le troisième clavier y comporte un jeu de
bombarde 16 et un de trompette 8 (ou plus), en gravures intercalées avec
celles du clavier de Grand Orgue) tel que celui de St Nicolas des champs (![]() ).
Le "seize pied ordinaire" ne possède pas ce clavier de
Bombarde. Le "16 pieds ordinaire" désigne néanmoins
un orgue qui possède une Montre de 16' réelle au clavier
de Grand-Orgue.
).
Le "seize pied ordinaire" ne possède pas ce clavier de
Bombarde. Le "16 pieds ordinaire" désigne néanmoins
un orgue qui possède une Montre de 16' réelle au clavier
de Grand-Orgue.
Le décalage de la 2e trompette par Dallery n'aura pas suffit à en faire
"un grand 16' " au sens propre du terme.
Jean Albert VILLARD, (photo
à la tribune de Nemours ![]() ),
son feu titulaire, et Robert BOISSEAU ont veillé jalousement sur cet instrument
afin de le mettre à l'abri de dangereux projets parisiens qui ont coûté
la vie - ou tout au moins leur authenticité - à tant d'instruments
de cathédrales.
),
son feu titulaire, et Robert BOISSEAU ont veillé jalousement sur cet instrument
afin de le mettre à l'abri de dangereux projets parisiens qui ont coûté
la vie - ou tout au moins leur authenticité - à tant d'instruments
de cathédrales.
En effet, les orgues de cathédrales appartiennent à l'État et non
aux Communes comme ceux des églises paroissiales.

Il a été restauré en 1994 par Jean-Loup Boisseau et
Bertrand Cattiaux mais, malheureusement, on veut toujours trop en faire.
Toute la tuyauterie a été nettoyée aux ultrasons, ce qui a retiré la poussière
dans les moindres recoins mais aussi les scories des micro-fissures et
des imperfections que le métal de cette époque pouvait comporter.
(C'est probablement dans le but de pallier à ces défauts
que Clicquot enduisait de vernis ses tuyaux, ce qui n'a pas été
le cas à Poitiers*).
(*) D'après Bertrand Cattiaux).
On a demandé à P.Y. Asselin de déterminer à quel tempérament il était
accordé "avant". Évidemment, il n'allait pas répondre "en mésotonique"
vu le prix que son expertise coûtait, mais trouva quelque chose de suffisamment
tarabiscoté pour que Jean Boyer estime que "- ... avant on ne pouvait
jouer que de la musique française, maintenant on ne peut plus rien jouer
du tout !"
Jean y a quand même joué du Bach le jour de l'inauguration.
Ecouter: ![]() ,
(1Mo)
,
(1Mo)
(Oui!
C'est du Bach! Étonnant, non?)
On y aurait retrouvé le tempérament décrit dans "l'Anonyme
de Caen",(![]() )
ce qui n'est pas bien compliqué, vu le flou de la description.
D'ailleurs, Jean Albert Villard s'était déjà livré
à cette expertise et en avait conclu: "... la partition
d'origine a été récemment recherchée en remettant
un jeu dans son état primitif (la Montre du positif); mais cela
s'est avéré inefficace, si peu de choses suffisant à
désaccorder un tuyau".
)
ce qui n'est pas bien compliqué, vu le flou de la description.
D'ailleurs, Jean Albert Villard s'était déjà livré
à cette expertise et en avait conclu: "... la partition
d'origine a été récemment recherchée en remettant
un jeu dans son état primitif (la Montre du positif); mais cela
s'est avéré inefficace, si peu de choses suffisant à
désaccorder un tuyau".
Finalement, tout est rentré dans l'ordre.
On peut voir
ICI (![]() ) la
description des Pleins-Jeux que Clicquot a placé dans cet orgue,
Pleins-Jeux qui ont marqué le tournant entre le 18e et le 19e siècle.
) la
description des Pleins-Jeux que Clicquot a placé dans cet orgue,
Pleins-Jeux qui ont marqué le tournant entre le 18e et le 19e siècle.
Je joins aussi un extrait sonore, un enregistrement
capté à l'intérieur du buffet, par dessus la tuyauterie (en 1971), sur
lequel on entend bien la disposition des tuyaux en "côté ut" et "côté
ut#". (Il s'agit ici de la Trompette).
C'est à dire ut, ré, mi, fa#, sol# et sib, à gauche - et, ut#, mib, fa,
sol, la et si, à droite.
![]() Fugue
sur Ave Maris Stella - Dandrieu - (822 Ko)
Fugue
sur Ave Maris Stella - Dandrieu - (822 Ko)
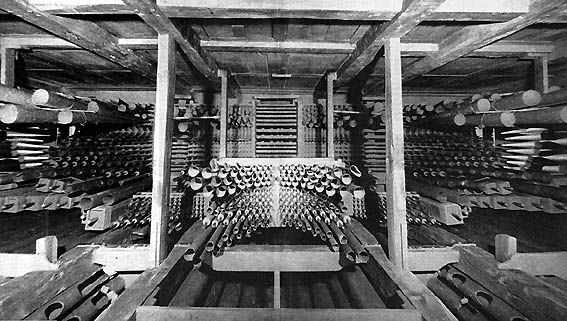
Une photo prise au dessus de la tuyauterie du Grand-Orgue par Alain Villain illustre cette disposition par tons (extraite de son court métrage "Un grand seize pieds"). On y voit la deuxième trompette encore décalée en Bombarde 16'.
![]() Un
autre enregistrement, capté
à l'intérieur du Positif cette fois, concerne le
Cromorne qui doit "bien crucher" selon le langage
des Facteurs d'Orgues. Ce terme de "crucher" ne se rencontre
effectivement que dans leur jargon. Est-ce en rapport avec le son particulier
de ce jeu qui semble provenir de l'intérieur d'une cruche ?
Un
autre enregistrement, capté
à l'intérieur du Positif cette fois, concerne le
Cromorne qui doit "bien crucher" selon le langage
des Facteurs d'Orgues. Ce terme de "crucher" ne se rencontre
effectivement que dans leur jargon. Est-ce en rapport avec le son particulier
de ce jeu qui semble provenir de l'intérieur d'une cruche ?