 UNE
HISTOIRE DU PLEIN-JEU
UNE
HISTOIRE DU PLEIN-JEU
IV.
LE PLENUM AU XVIe SIÈCLE EN FRANCE ET AUX PAYS BAS
L'orgue
des Pays-Bas et en Europe Centrale.
Ce qu'on appelait, aux Pays-Bas,
la sonorité "nouvelle" du Plein-Jeu (voir:
chap. I: l'orgue médiéval)
a dû aller longtemps de soi. On la décrivait vers 1500 comme
süss (douce), schneidend (mordante), zart (délicate).
Praetorius, lui, disait: lieblich (aimable) ou scharf
(aiguë).
Auparavant nous ne trouvions à côté des "Fourniture
et Cymbale" que les rangées du "Rechtwerk":
- Montre 8', Bourdon 8', Prestant.
Maintenant s'y ajoutent souvent la 12e (2'2/3) et la 15e (2'), parfois
une 19e (1'1/3) et même une fois les 22e (1') et 26e (2/3').
Dans le projet de H.L. Hassler pour l'église de la Cour
à Dresde (1612):
- Principal 8', Octave 4', 15e, 19e, 22e, 26e, Cymbale II.
Cette composition s'inspirait évidemment de la facture italienne.
L'ancien ensemble: 8', 4' et deux Mixtures de hauteurs différentes,
se rencontre encore souvent:
Brake, 1600: Principal 8', Octave 4', Mixtur IV, Scharf III
(Jean Scherer le vieux)
Dans la mesure où nous
connaissons le nombre de rangs des Mixtures, si peu souvent indiqué,
les Pleins-Jeux semblent, en gros, avoir comporté IX, X
ou XI rangs. Les facteurs des Pays-Bas donnaient souvent plus de rangs
encore à leurs plenums:
Zierikzee (1548) : 8' I/II, 4' I/II, 2' I/III, Mixture VIII/XVI,
Scharf IV/VIII (projet anonyme);
Würzburg (1614) : 16', 8', Mixture X, Scharf X (J.
Niehoff);
Groningue (1558) : 8', 4', Mixture X / XXI, Cymbale III (A.
de Mare, état de 1662);
Dantzig (1583) 16', 8', 4', 2' 2/3, 2' Mixture XXIV, Cymbale VIII
(Julius Antony).
Ailleurs aussi, nous trouvons parfois des Plenums encore plus riches:
Ulm (1576) : 8', 4', 2' 2/3, 2', Mixture V/VIII, Cymbale II
(T. Compenius) ;
Bückeburg (1615): 16', 8', 4', 2', Mixture VIII/XIV (E.
Compenius);
Hof (1602): 8', 4', 2' 2/3, 2', Mixture VIII, Cymbale II (T.
Compenius);
Lübeck (1623) : 16', 8', Rauschpfeife II, Mixture VI/X, Scharf
IV / VI (H. Scherer-le-jeune);
Innsbrück (1555) : 8', 4', 2', 2/3, 2', Hörnlein II,
Mixture V / X, Cymbale II (J. Ebert);
Bernau (1572) : 16', 8', 4', 2' 2/3, 2', Mixture XII, Cymbale III
(H. Scherer-le.vieux).
Remarquons que la plus petite des deux mixtures (Cymbale ou Scharf)
a tantôt peu de rangs (II / III), tantôt beaucoup (IV / VIII).
Le Hörnlein (Cornet) d'Innsbruck est à taille de Principal: c'est un exemple de Mixture à tierce. Ce jeu apparaît assez fréquemment dans le Sud de notre zone: Fribourg-en-Brisgau (1544), Uberlingen (1548), Weingarten (1555), Einsiedeln (1557), Augsbourg (1580), Messkirch (1598) et Salem. Il s'ajoute presque toujours aux deux autres mixtures (Mixtur ou Hintersatz et Zimbel).
Il faut aussi noter que les
Positifs de dos de facteurs comme Henri, Timothée,
Esaias Compenius, Hans Lange et Gottfried Fritzsche
ne comportent le plus souvent aucun Plenum complet:
Ils suivaient probablement l'exemple des instruments célèbres
de leur temps comme Bernau (1572) et Stendhal (1580), par
lesquels H. Scherer-le-vieux avait introduit les innovations de
la facture hollandaise dans celle d'Allemagne centrale.
Dans une bonne majorité des cas, les mixtures comportaient
à peu près le même nombre d'octaves que de quintes;
mais dans une assez forte proportion ce sont les octaves qui l'emportent,
et parfois même les quintes sont totalement absentes.
La composition de l'orgue de la Hofkirche dans le cloître des Franciscains
à Innsbruck (1555/61, J. Ebert de Ravensbourg), restauré
en 1969/70 par Ahrend, est la suivante:
- G.O.: 8', 8', 4' 2' 2/3, 2', Hörnlein, Hintersatz, Cymbale,
Trompette 8'.
- Positif accouplable: Flûte ouverte 4', Bourdon 4', Hörnlein,
Mixture, Cymbale, Tremblant.
- Brustwerk, joué par le clavier du GO.: Régale 8'.
- Pédale: tirasse du G.O.
Les mixtures ont la disposition suivante:
| G.O. | Mixture V / X: | |
| ut
1 ut# 2 fa# 2 ut# 3 fa# 3 ut# 4 fa# 4 |
2', 1'1/3, 1', 1/2' 2', 1' II, 2/3', 1/2' II 2' II, 1'1/3 II, 1' II, 2/3' 2' III, 1'1/3 II, 1' II, 2/3' 4', 2'2/3, 2' III, 1' 1/3 II, 1' II 4' II, 2'2/3 III, 2' III, 1'1/3 II 4' III, 2'2/3 III, 2' IV |
|
| Cymbale II | Hörnlein II: | |
| ut
1 ut# 2 fa# 2 ut# 3 fa# 3 ut# 4 fa# 4 |
1/3',
1/4' 1/2', 1/3' 2/3', 1/2' 1',2/3' 1'1/3, 1' 2', 1'1/3 2'2/3, 2' |
1'1/3,
4/5'. 2'2/3, 1'3/5 |
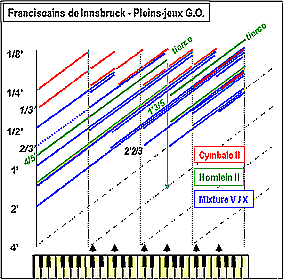
| Positif | Mixture III / V |
| (clavier au fa 1) | |
| fa 1 la 2 la 3 mi 4 |
2',
1'1/3, 1' 2', 1'1/3, 1, 2/3' 2' II, 1'1/3 II, 1' 4' II, 2'2/3, 2', 1'1/3 |
| Cymbale II | |
| fa 1 la 2 la 3 mi 4 |
2/3',
1/2' 1', 2/3' 1'1/3, 1' 2',1'1/3 |
| Hörnlein II | |
| fa 1 la 2 la 3 mi 4 |
2/3,
2/5' 1'1/3, 4/5 2'2/3, 1'3/5 |
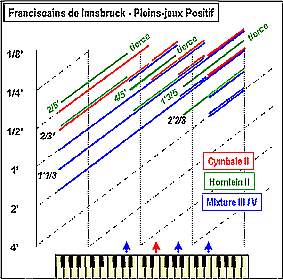
Ce type de Cymbale est
celui qui a servi de point de départ à la Cymbale
française classique, et doit donc être celui des
Pays-Bas au XVIe siècle, tandis que la Fourniture
est encore mixte, à la fois progressive et avec une reprise d'octave
en Fa 3.
Au Positif, structure analogue, mais la Cymbale est légèrement
ascendante.
Quant aux Hörnlein, ce sont des Sesquialteras
à reprise d'octave encore proches de la Cymbale à Tierce
d'Arnaut: à la 3e octave elles ont la hauteur du Cornet,
dont elles sont peut-être les ancêtres.
Il s'ensuit que Cornet et Mixture du Positif, à partir de LA 3, évoquent la résultante de 8', bien que ce clavier ne compte pas de 8'.
Déjà en 1511, Arnold Schlick demandait que la Mixture se composât essentiellement d'octaves avec peu de quintes et seulement aiguës. Le remarquable facteur de l'orgue de Saint- Vivien à Rouen en 1515, Peirs de la Estrada, n'avait, selon le témoignage de Valeran de Héman en 1608 et de Claude de Villers en 1659, mis que des octaves dans la Fourniture comme dans la Cymbale de son orgue. N'ont pas de quinte du tout les deux mixtures de l'orgue de la basilique de Maria Thalkirchen (facteur inconnu, vers 1630), aujourd'hui au Deutsche Muséum de Munich.
On lit dans Praetorius:
"on s'est beaucoup attaché depuis une cinquantaine d'années
à la Lieblichkeit, spécialement aux Pays-Bas plus qu'ici".
Il désigne par là une poussée vers l'aigu, ce que
prouve son passage à propos de l'orgue de la cathédrale
de Halberstadt (1361), où il explique que les Manuels, à
cause du petit nombre de leur touches, ne pouvaient atteindre dans le
dessus à la Lieblichkeit.
C'est avec la même acception que Praetorius appelle l'orgue
de Saint-Jean de Lunebourg (Niehoff-Johannsen, 1551) "ein
trefflich. Werk... gar hell und scharf " : un excellent ouvrage..,
clair et aigu. Praetorius donne des indications plus précises
sur la petite mixture ou Scharf, comme l'ont appelée
les facteurs Néerlandais depuis des années et ils n'ont
pas tort car c'est un jeu vraiment scharf (aigu), certains y incluant
"kleine subtile und junge Pfeiflein" (des tuyaux très
petits et aigus), dont le plus gros a 3 pouces de long.
Il faut remarquer au passage que 1/4' (3 pouces) correspond à ut
6, non à fa 5; de même trouve-t-on fréquemment 12'
ou 6' où il faut lire 16' et 8', et dans le cas présent
Praetorius devait penser réellement ut 6 (1/4') : à
côté de 3 octaves, un unique rang de quinte. Praetorius
nous décrit encore une autre mixture sans aucune quinte: "3
ou 4 petits tuyaux à l'unisson et une petite octave mais pas de
quinte et qui vont d'une octave à l'autre".
Ces mixtures citées par Praetorius auraient donc été du types suivant:
| ut
2 ut 3 ut 4 |
1/2' II, 1/3', 1/4' 1' II, 2/3', 1/2' 2' II, 1'1/3, 1' |
1/2'
III (+ I), 1/4' 1' III (+ I), 1/2' 2' III (+ I), 1' |
Dans ces exemples, nous venons
d'étudier le nombre de rangs des mixtures et la répartition
entre quintes et octaves. Il faut pour finir ajouter un mot sur le plafond
que ces jeux atteignent.
Le Scharf de l'orgue d'Alkmaar (1511), nous l'avons vu,
plafonne dans le haut du clavier au 1/10';
dans les mixtures de notre période, on relève des plafonds
au 1/4' (Maria Thalkirchen, Mixture), 1/8' (Wilten),
1/10' (Innsbruck, Mixture et Cymbale du Positif),
1/12' (Ulm, mixture du Positif) ou 1/16' (Schluderns, Cymbale-Quinte).
On trouve aussi des dispositions ascendantes avec plafond d'abord au 1/6',
puis au 1/8' (Vienne, Mixture du Positif), ou 1/8' puis
1/16' (Pommsen, Mixture), 1/6', 1/8' puis 1/12' (Altenbruch,
Mixture du G.O.) et 1/8', 1/12' et 1/16' (Vienne, Mixture
du G.O.).
En France.
Il existe dans nos connaissances
actuelles des structures de Plenum en France une grave lacune :
le XVIe siècle. Les documents, déjà assez rares en
général, ne donnent aucune précision et ne permettent
pas d'établir de certitudes: un trou d'un siècle entier
à quoi s'ajoute le fait historique que l'orgue français
du XVIe siècle doit à peu près tout à l'orgue
des Pays-Bas et non à l'orgue français du XVe siècle.
Aussi peut-on se contenter pour ce dernier du peu que nous savons: 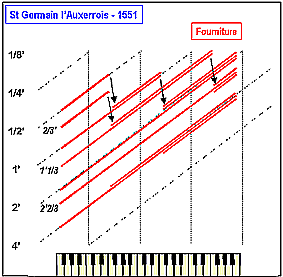
les Fournitures y sont d'abord encore progressives en apparence.
Ainsi à Saint-Germain-l'Auxerrois (1551):
Fourniture VII à IX (pas de jeu de 2'), d'où:--->
On aurait à peu près la même chose pour la Fourniture
III à V de Saint-Jean-en-Grève.
En fait ce ne sont nullement
des progressions médiévales mais bien des parties hautes
de Fourniture d'Arnaut à nombre de rangs fixe, sauf
la nécessité de compenser dans l'aigu un affaiblissement
dû aux doublures. Il n'est donc nullement étonnant de trouver
aussi des Fournitures à nombre de rangs réellement
fixe:
1537 Châlons: Fourniture V; Alençon,
Fourniture VII;
1549 Chartres Fourniture VI.
Outre la Fourniture,
le Plenum comprend (peut-être?) la Cymbale, toujours présente
mais jamais définie : Saint-Étienne (Troyes) 1550
bien argentée; Saint-Germain-L'Auxerrois (Paris)
1551: II rangs; Chartres: III rangs.
Dans la seconde moitié du siècle deux Cymbales I
à une octave l'une de l'autre semblent plutôt provenir du
type méridional (Ripieno). La seconde reprend d'octave en
octave.
 C'est tout ce que nous savons du type français du Nord, qui était
aussi celui des grands buffets Renaissance de Normandie (Rouen,
Cathédrale & Saint-Maclou; Caudebec (photo), etc.) sinon
que ce Plenum sera condamné à la fin du siècle
comme inégal et sombre par les partisans du Plenum des Pays-Bas.
C'est tout ce que nous savons du type français du Nord, qui était
aussi celui des grands buffets Renaissance de Normandie (Rouen,
Cathédrale & Saint-Maclou; Caudebec (photo), etc.) sinon
que ce Plenum sera condamné à la fin du siècle
comme inégal et sombre par les partisans du Plenum des Pays-Bas.
Ce Plenum des Pays-Bas
(voir au début) résulte d'une évolution qui remonte
au début du XVe siècle: dès 1522, Fourniture
et Cymbale sont à nombre de rangs fixe. Souvenons-nous que
Dijon est en Bourgogne et que Arnaut de Zwolle porte un
patronyme plutôt flamand.
La fourniture et la cymbale à reprise d'octave de
ce dernier auraient été menées à leur terme
logique: le développement prévisible de l'ensemble Fourniture-Cymbale,
une fois éliminées les Quintes graves et les Tierces,
sûrement sous l'influence de plus en plus exigeante de la musique
polyphonique.
Comment ce schéma de base se comportait-il en montant le clavier?
le jeu à l'orgue d'une polyphonie complète à voix
strictement égales s'accommodait mal, quoi qu'on pense, des Fournitures
progressives.
Le Ripieno avec son nombre fixe de rangs répondait mieux
à cette égalité.
La solution pour obtenir un
Plenum vraiment égal fut de rejeter le principe de reprise de tous
les rangs au plafond.
Elle consista à faire reprendre chaque rangs sur la même
note que le rang supérieur arrivé seul au plafond.
Dès lors, une fois ce rang aigu choisi (1/2' par exemple), les
autres évoluent parallèlement, à la quarte ou à
l'octave inférieures avec départ au 2/3', 1', 1'1/3, etc.
Le saut d'octave qui se fait pour tous les rangs à la fois se situe
naturellement chaque fois qu'une octave est parcourue au clavier pour
conserver intensité et tessiture.
Le jeu est alors parfaitement horizontal et les reprises, le clavier
commençant alors au Fa, tombent naturellement en Fa 2 et
Fa 3.
Plus tard, au cours du XVIe siècle, l'extension du clavier à
ut 1 (et à ut 5) sera un ravalement (et un complément aigu)
sans reprise, ce qui rend alors l'apparence du jeu un peu moins horizontale:
première reprise : Ut 1-Fa 2;
deuxième : Fa 2-Fa 3
troisième : Fa 3-Ut 5.
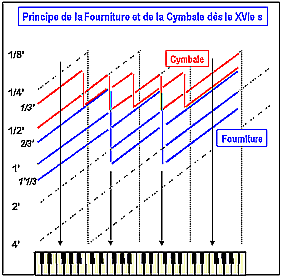 C'est
le schéma définitif des Fournitures françaises
classiques.
C'est
le schéma définitif des Fournitures françaises
classiques.
Cette évolution des
Fournitures pourrait bien avoir été précédée
de celle des Cymbales dont elle aurait même subi l'influence; ce
sont en effet les Cymbales qui ont dû conduire à la notion
de reprise sur note.
Très tôt, sans doute dès l'incorporation de la Cymbale
mutation dans le Plenum, la Tierce de la Cymbale III d'Arnaut
fut rejetée (ou séparée), sans parler d'une
autre évolution de la Cymbale à tierce hors du Plenum
vers le Cornet et la Sesquialtera.
Le schéma de cette Cymbale II à reprise au plafond
peut se lire (et se lisait surtout au sommier) comme un schéma
à reprise sur note, mais cette fois de quinte en quarte
au lieu de l'octave. (Là encore les prolongations à l'ut
sont des ravalements et des compléments sans reprise).
Le grossissement se fait par rangs parallèles de plus en plus graves
: 1/4', 1/3', 1/2', 2/3', 1', etc.
Ainsi doivent être nés les deux types de mixtures
classiques (Fourniture à reprises d'octave, Cymbale
de quinte en quarte) qui permettaient, en restant indépendants
l'un de l'autre, de reconstituer soit le Plein-jeu : Principal, Fourniture,
Cymbale, soit le jeu de cimbales : Principal, Cymbale.
A l'intérieur de ce principe il y a place pour bien des différences
de détail (selon le vaisseau à remplir par exemple), mais
tel sera le schéma général du Plenum de Titelouze
et de Mersenne et jusqu'à Dom Bedos (photo de fond d'écran).