|

Une petite
histoire de l'Orgue
L'hydraule
L'orgue antique
L'orgue portatif
Evolution de l'orgue
Mécanisme de l'orgue
Principe des jeux de l'orgue
Retour
Accueil
 Orgue,
du latin "organum". Mot un peu vague que l'on pourrait traduire maintenant
par "machin", "truc", "bidule", "appareil",
"instrument" ... Il a aussi donné, en français,
le mot "organe" et le verbe "organiser". Orgue,
du latin "organum". Mot un peu vague que l'on pourrait traduire maintenant
par "machin", "truc", "bidule", "appareil",
"instrument" ... Il a aussi donné, en français,
le mot "organe" et le verbe "organiser".
Dans l'ancien testament, organum désigne l'ensemble des instruments de
musique à vent, (Ougab, en Hébreu).
L'orgue en tant que tel n'existait pas encore!
Il aurait été inventé par un certain Ctésibios que certains
considèrent comme un physicien grec d’Alexandrie, 3 siècles avant
JC.
Pour ma part il m’a été rapporté qu’il s’agissait plutôt d’un garçon
coiffeur qui s’étonnait que le contrepoids du miroir qui était en face
du client sifflait en modulant chaque fois qu’il en ajustait la hauteur.
Ce contrepoids était dans un tube percé d’un trou pour laisser échapper
l’air quand il y coulissait comme un piston.
En fait, Ctésibios a
bien été ingénieur, il a bien inventé l'hydraule
(Organa hydraulica, c'est à dire : instrument hydraulique), mais
de là à ce qu'il soit l'inventeur de l'orgue ..... car depuis
de nombreux siècles on utilisait des instruments constitués
de plusieurs tuyaux assemblés que l'on soufflait à la bouche.
La Flûte de Pan (Syrinx) en est le plus célèbre.
Bien des siècles avant l'ère chrétienne on trouve
l'orgue à l'état embryonnaire en Judée, en Chine
et en Grèce. Mille ans avant l'ère chrétienne, la
chine connaissait le Tcheng, (ou Khon); C'est l'orgue à bouche
composé de 7 à 36 tubes de bambou dans lesquels l'air est
mis en vibration par une anche de roseau. Une anche libre; c'est aussi
un peu l'ancêtre de l'harmonica.
En fait le nom d'Orgue ne sera adopté que pour
les instruments pneumatiques, c'est à dire avec des soufflets,
les orgues hydrauliques ayant toujours été appelés
"Hydraule", Hydraulos en grec (Aulos qui fonctionne avec de
l'eau), hydraulis ou hydra en latin. Ils ne sont hydrauliques que parce
que la pression de l'air qui alimente les tuyaux est obtenue dans une
cloche en bronze renversée sur une cuve pleine d'eau. On remplit
d'air la cloche à l'aide de pompes à pistons (invention
de Ctésibios, peut-être bien à la suite de son observation
des miroirs avec contre-poids à coulisse!) et c'est la différence
de niveau d'eau qui produit la pression d'air.
(Voir aussi, dans l'abécédaire,
A comme Acquincum).
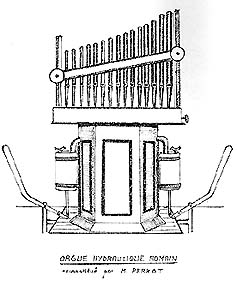 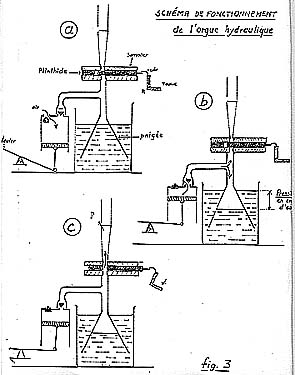
- Hydraule, reconstituée
par J. Perrot. (Doc GAM)
.
L'hydraule
L'orgue antique
L'orgue portatif
Evolution de l'orgue
Mécanisme de l'orgue
Principe des jeux de l'orgue
Haut
de page
L'orgue
antique et l'orgue médiéval.
L'orgue
avait sa place dans les cérémonies officielles, les festins,
les jeux, et n'était pas admis à l'église. Pas moins
que les autres instruments de musique, d'ailleurs. Le rite orthodoxe ne
les admet toujours pas.
Dans le rite catholique, il n'a été admis qu'a partir du
XIVe siècle, mais resta interdit dans le Primat des Gaules (Lyon)
jusqu'à la révolution française. En fait, il s'est
installé dans les églises subrepticement à partir
du Xe siècle, mais il était interdit de s'en servir à
la messe.
"L'organum" qui est le style de musique religieuse de l'époque
se passait donc du son de l'orgue! Il était exclusivement vocal.
L'orgue que l'empereur de Byzance, Constantin
Copronyme, offrit à Pépin le Bref en 767 ne fut pas installé
durablement à Compiègne comme on le pense mais fut probablement
envoyé au palais d'Aix la Chapelle où il participait aux
fêtes royales. L'orgue de Charlemagne était-il celui-ci ou
un autre ? Nous ne le savons pas. Cet orgue resta l'exception et disparut
! Très richement orné, il a dû être tout simplement
pillé.
En 826, Louis le Débonnaire, fils
de Charlemagne, dut alors faire appel à un prêtre, Georges
de Venise, pour construire le premier orgue de construction occidentale.
Probablement sur le modèle des orgues de la Grèce antique.
Mais pas hydraulique. C'était un orgue à deux soufflets,
à plusieurs jeux, dont les tuyaux étaient dorés.
Il n'était évidement pas voué au service religieux
mais toujours aux festivités du palais d'Aix la Chapelle.
Ce furent des religieux qui se chargèrent
de la facture d'orgue au cours des siècles suivants.
Cela parait étonnant puisque cet instrument ne servait pas à
l'église, mais rappelons nous que seuls les religieux détenaient
le savoir à cette époque. Les élèves du prêtre
Georges et leurs successeurs répandirent la facture d'orgue au
nord des alpes, loin de Rome, ce qui explique la présence de cet
instrument dans des abbayes germaniques bien avant le XIVe siècle
au point que le Pape Jean VIII dut faire appel en 873 à l'Archevêque
de Freising, en Bavière, pour avoir un orgue et un organiste dans
le but d'enseigner la musique à Rome.
Ce n'est qu'au début du Xe siècle que l'orgue apparut dans
des chapelles de couvents où exercaient des moines facteurs d'orgues.
Le premier orgue monumental fut construit à l'abbaye de Winchester
vers 950. C'était un orgue que l'on disait avoir 10 rangs de 40
tuyaux. Du moins c'est ce qu'on croyait à la lecture du poème
de Woltran qui le décrit; il semble qu'il n'en n'est rien. Il aurait
possédé 4 rangs de tuyaux, ce qui était déjà
pas mal pour l'époque. Les touches du clavier étaient à
la verticale des tuyaux, il fallait deux organistes pour les actionner.
Voir "A
propos de l'orgue de Winchester".
L'orgue va alors se méler peu
à peu aux cérémonies religieuses, au point qu'on
a occulté son rôle profane et festif jusque tout récemment.
Tout d'abord dans le but d'enseigner la musique. Il accompagnait le travail
des chantres mais restait interdit à l'office.
 Orgue
antique de l'Abbaye de Royaumont (restitution). Orgue
antique de l'Abbaye de Royaumont (restitution).
Les processions
extérieures pouvaient toutefois être accompagnées
par des orgues à main, dits "orgues portatifs",
que l'on jouait portés en bandoulière ou assis, posés
sur la jambe.
 Musée des Augustins, Toulouse.
Musée des Augustins, Toulouse.
L'hydraule
L'orgue antique
L'orgue portatif
Evolution de l'orgue
Mécanisme de l'orgue
Principe des jeux de l'orgue
Haut
de page
Evolution
de l'orgue.
Au
XIVe siècle, des inventions vont permettre la construction d'orgues
monumentaux :
- Les soupapes et le sommier à
gravures qui permet d'avoir des touches de clavier beaucoup plus
légères à enfoncer par rapport aux tirettes à
coulisses utilisées jusque là.
- L'abrégé, système de transmission mécanique
qui permet au clavier de commander l'ouverture de soupapes qui ne sont
plus à la verticale de la touche. Les claviers vont pouvoir avoir
la dimension qu'on leur connait toujours et être actionnés
avec les doigts, non plus à coup de poing ou à poignée
comme encore les claviers de carillons.
- Les registres coulissants, règles en bois perforées
qui vont permettre de faire sonner les rangs de tuyaux individuellement
(jeux) au lieu de les avoir par "paquets" sur deux ou trois
sommiers communiquant par des conduits pouvant être bouchés
par une soupape (Sperreventil). C'était le système de
"Blockwerk" qui ne permettait que trois plans sonores:
les fonds, les fonds + les principaux et les fonds + les principaux
+ les plein-jeux.
Voir "Histoire du Plein-Jeu" - L'orgue
médiéval.
- Le buffet, meuble en bois, qui, en plus d'être décoratif,
permet au son d'acquérir une certaine rondeur et qui évitait
de recouvrir l'instrument avec une tenture qu'il fallait retirer à
chaque usage.
- La multiplication des claviers, après avoir expérimenté
la liaison d'un orgue médiéval et d'un orgue positif
(posé au sol) placé dans le dos de l'organiste. Aujourd'hui
ce petit orgue séparé du grand corps et qui est toujours
placé dans le dos de l'organiste s'appelle toujours "positif",
non seulement par rapport à son origine, mais en plus parce qu'il
parait posé sur le sol au bord de la tribune.
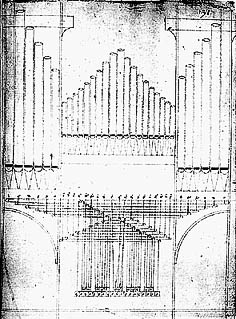 Traité
d'Arnaut de Zwolle
Traité
d'Arnaut de Zwolle  - XVe siècle.
- XVe siècle.
L'hydraule
L'orgue antique
L'orgue portatif
Evolution de l'orgue
Mécanisme de l'orgue
Principe des jeux de l'orgue
Haut
de page
Mécanisme
de l'orgue.
Schéma
d'un mécanisme parmi d'autres, tant il peut y avoir de variations
en ce domaine. Ce qui nous montre que l'orgue est une véritable
machine. C'est le seul instrument de musique avec lequel le musicien n'est
pas l'auteur du son mais l'air sous pression qu'il introduit dans les
tuyaux en ouvrant une soupape. Le seul ? Enfin, presque, puisque les synthés
(Claviers) modernes fonctionnent avec le même principe. D'un côté,
on envoie de l'air à des tuyaux; de l'autre, on envoie du courant
à un circuit.
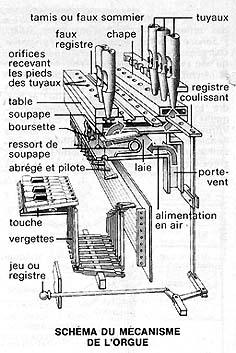 Petit Larousse Illustré 1980
Petit Larousse Illustré 1980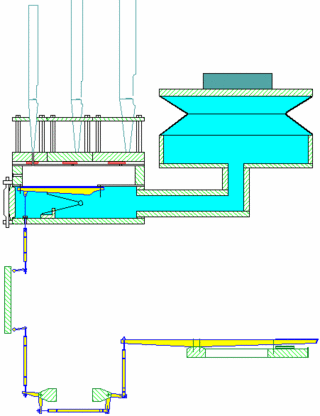 Forum:
http://monde-orgue.cultureforum.net Forum:
http://monde-orgue.cultureforum.net
 "Abrégé"
"Abrégé"
"Instrument
magnifique et totalement indifférent, neutre, de tous les instruments
le moins musical, ses claviers n'étant qu'une succession de leviers
aboutissant à des clapets, introduisant l'air dans des tuyaux qui,
d'un coup, comme frappés de stupeur, vomissent tout net tout le
son dont ils sont capables, le prolongent, cubique, l'arrêtent,
tout net, comme un automate inepte fait un geste".
(Pierre Vidal - Bach et la machine orgue - Stil éditions).
 Orgue de Mende
Orgue de Mende  Orgue Riepp, de Dole
(Jura)
Orgue Riepp, de Dole
(Jura)
L'hydraule
L'orgue antique
L'orgue portatif
Evolution de l'orgue
Mécanisme de l'orgue
Les jeux de l'orgue
Haut
de page
Principe
des jeux de l'orgue.
Les différents
jeux de l'orgue composent un ensemble sonore évolutif en fonction de leurs
associations qui fait de cet instrument le premier synthétiseur de l'histoire.
Les jeux non imitatifs de l'orgue constituent l'essentiel
de la vrai synthèse sonore, par ajout de sons harmoniques au son
fondamental:
fonds, principaux, mutations, ainsi que la "fourniture" et la "cymbale"
(le
"plein-jeu") qui sont déjà des "mélanges" prêts à l'emploi
et qui sont une survivance du "Blockwerk" médiéval.
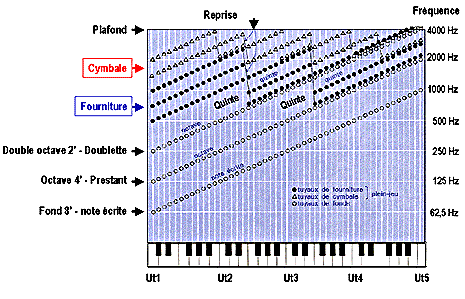
In: "La Recherche" N° 64 - James Lequeux

Le mélange des jeux de l'orgue procède
par synthèse additive ou synthèse soustractive.
Synthèse additive:
Bourdon 8 (son fondamental qui correspond à la note écrite)
+ Prestant 4 (ou autre "4") - première harmonique: à l'octave
+ Nazard 2 2/3 - 2e harmonique: à la quinte
+ Doublette 2 - 3e harmonique: suboctave
+ Tierce 1 3/5 - 4e harmonique (à la tierce de la doublette)
+ Larigot 1 1/3 - 5e harmonique: quinte
+.+.+...
La synthèse soustractive consiste à
retirer des jeux entre le registre le plus grave et le plus aigü
:
par exemple Bourdon 8 + Larigot 11/3. Il manque le 4', le 2'2/3 et le
2 pieds.
On a à faire à une synthèse soustractive si on retire des harmoniques
intermédiaires. On obtient des "mélanges creux".
C'est là que réside en fait l'originalité de l'orgue, instrument de synthèse,
créant dès le XIVe siècle des sons nouveaux et originaux.
Les jeux composés - notamment ceux de Fourniture
et de Cymbale - sont constitués de plusieurs rangs de tuyaux
aigüs parlant ensemble. Des "reprises" sont aménagées
afin que le son ne dépasse pas un plafond de fréquence.
Bien sûr, ces jeux ne sont jamais utilisés seuls.
Les numéros: 8, 4, 2, ... indiquent la longueur -
en pieds - du corps sonore du tuyau correspondant au premier "ut"
(C1) du clavier. Donc, la hauteur du son de chaque jeu.
Ceci explique par ailleurs le diapason des orgues anciens, le pied
étant une mesure de longueur différente d’une région à l’autre. Comme
c’est Berthe (au grand pied) qui avait le pied le plus grand*,
l’orgue ancien français est le plus bas; près de 1 ton sous le diapason
actuel. Le "Pied du Roi" qui était utilisé
en France est égal à 324,84 millimètres. De plus,
les premiers claviers commençaient sur un Si ou un Fa. D'où
un certain flottement qui a pu durer jusqu'à ce que les claviers
commencent tous sur le Do1.
* (Un seul, l'autre était bot!)
Les fractions indiquent les tuyaux ne sonnant pas
à l'octave, mais à la quinte ou à la tierce, suivant
les rapports de Pythagore.
1' 1/3, quinte du 2;
1' 3/5e, tierce du 2, etc.
La progression de la dimension des tuyaux de chaque octave suit un rapport
logarithmique. Pour chaque octave ils ont une longueur égal à
la moitié de la précédente:
16', 8', 4', 2', 1', 1/2', etc.
Maintenant, avec le diapason moderne et malgré le système métrique, ces
dimensions sont un peu plus plus petites mais on parle toujours de pieds
pour simplifier le propos.
  Le
Bourdon, qui est un tuyau bouché, sonne à l’octave inférieure par
rapport à un tuyau ouvert de même dimension. Pour éviter toute confusion
les ouvrages anciens parlent de "Bourdon 4' sonnant 8". Ce qui
signifie que le corps sonore mesure 4 pieds mais qu’il donne une note
de même hauteur qu'un tuyau ouvert de 8 pieds (note écrite).
Maintenant on dit "Bourdon 8" bien que le premier d'entr'eux ne
fasse physiquement que (environ) 4 pieds. Le
Bourdon, qui est un tuyau bouché, sonne à l’octave inférieure par
rapport à un tuyau ouvert de même dimension. Pour éviter toute confusion
les ouvrages anciens parlent de "Bourdon 4' sonnant 8". Ce qui
signifie que le corps sonore mesure 4 pieds mais qu’il donne une note
de même hauteur qu'un tuyau ouvert de 8 pieds (note écrite).
Maintenant on dit "Bourdon 8" bien que le premier d'entr'eux ne
fasse physiquement que (environ) 4 pieds.
Les tuyaux bouchés ne donnent que des harmoniques impaires alors
que les tuyaux ouverts peuvent fournir toutes les harmoniques, que l'on
appelle alors "partiels" :
(Voir la "loi
des tuyaux")
|
Tableau des harmoniques
|
| Niveau harmonique |
Note correspondante |
Rapport harmonique |
|
Fondamental 1
harmonique 2
harmonique 3
harmonique 4
harmonique 5
harmonique 6
harmonique 7
harmonique 8
harmonique 9
harmonique 10
etc.
|
Ut
1
Ut 2
Sol 2
Ut 3
Mi 3
Sol 3
Si bémol
3 (-)
Ut 4
Ré
4
Mi 4
|
Octave 2/1
Quinte 3/2
suboctave 4/2 (2/1) - Quarte
du sol2, 4/3
Tierce majeure 5/4 - Sixte
du sol2, 5/3
Quinte 6/4 - Tierce mineure du mi3, 6/5
7/4
3e Octave 8/4 - (2/1)
Ton majeur de
l'ut4, 9/8 (seconde)
Tierce majeure 10/8 - Ton mineur du
ré4, 10/9
|
C'est cette suite harmonique qui est à la base
de la gamme de Zarlino dont l'invention serait due à Aristoxène.
Elle repose sur la suite naturelle des harmoniques d'un
son dans lequel on voit que les notes y apparaissent dans un désordre
déroutant.
Zarlino a bâti sa gamme par imbrication des 3 accords parfaits Fa-La-Do-Fa,
Do-Mi-Sol-Do, et Sol-Si-Ré-Sol.établis sur la base de quintes
et de tierces pures de la gamme naturelle. Il en résulte l'accord
de la gamme diatonique. (Voir "Zarlino
et la gamme").
La valeur de chaque intervalle se calcule
en faisant le rapport du rang harmonique des notes considérées.
Par exemple une quinte est égale à 3/2 puisqu'elle se trouve
entre l'harmonique 3 et l'harmonique 2.
Et ainsi de suite, la tierce = 5/4, la seconde = 9/8e, la quarte = 4/3,
... , mais aussi la sixte, entre les harmonique 5 et 3, aura un rapport
de 5/3 ainsi que la septieme qui est égale à 15/8e puisque
cet intervalle se rencontre entre le SI de rang 15 et l'UT de rang 8.
Le timbre - caractérisé par la richesse
harmonique - de chacun des jeux conditionne le timbre des différents mélanges
de l'orgue.
L'orgue a aussi très tôt cherché à imiter des
sons d'instruments dont nombres ne sont plus utilisés actuellement :
Bombardes, Trompettes, Cromorne, Cornet, Nazard ... et d'autres, monstrueux,
dont l'existence a été assez éphémère,
du genre Kéraulophone, Tibia, Clarabella, Stentor, Dermogloste...
Le Nazard (ou Nasard) était une grosse
flûte donnant un fort partiel de quinte. Dans l'orgue, c'est un
rang à la quinte que l'on ajoute à la fondamentale :
8' + 2' 2/3
Le Cornet, sensé imiter le Cornet à
bouquin, est un jeu composé de 5 rangs de tuyaux et qui est utilisé
seul, en récit.
Il est composé de la fondamentale et de ses 4 premières
harmoniques. (Fondamentale + Octave + Quinte + Double octave + Tierce).
 Même
si le terme de Trompette évoque quelque chose de connu, encore
faut-il considérer que celles-ci reproduisent un son différent des vrais
trompettes modernes, mais assez proche de celles du 17e siècle. De même
le Hautbois évoque plutôt le "Hautbois du Poitou" que l'instrument
d'orchestre actuel. Même
si le terme de Trompette évoque quelque chose de connu, encore
faut-il considérer que celles-ci reproduisent un son différent des vrais
trompettes modernes, mais assez proche de celles du 17e siècle. De même
le Hautbois évoque plutôt le "Hautbois du Poitou" que l'instrument
d'orchestre actuel.
Avec le Cromorne, le Clairon et la Voix-Humaine,
ce sont des jeux composés de tuyaux à anche battante.
C'est l'anche qui donne la note, le tuyau qui les surmonte n'étant
destiné qu'à leur fournir le timbre. Ce ne sont que des
résonateurs. Donc, la dimension de ces tuyaux ne correspond pas
obligatoirement à celle des tuyaux de flûte fournissant la
même note. Mais la hauteur du son émis est toujours caractérisée
par celle du tuyau à flûte correspondant : Bombarde
16, Trompette 8, Clairon 4, etc.
Les jeux imitatifs sont plus tardifs et n'ont pas
évolué d'une façon tangible depuis leur apogée, au 17e siècle, alors à
leur perfection technique.
L'orgue du 21e siècle reste à inventer!
Le 20e ne nous a offert que des retours "néo" quelque chose.
Peut-on trouver maintenant ce qui ne l'a pas été depuis
150 ans? Tout au moins en facture classique?
L'évolution moderne serait plutôt orientée vers l'application de l'électricité.
Produire un son à partir de circuits électriques existe depuis que le
circuit lui même existe. Dès l'avènement du tube amplificateur utilisé
en radio, des chercheurs ont détournée la fonction amplificatrice du dit
tube pour le transformer en générateur de son.
Naquît ainsi l'oscillateur. Un oscillateur par note au départ,
puis seulement pour une seule octave en obtenant les octaves par "effacement"
du son fondamental et, successivement, de ses partiels.
Avec des filtres on modifie le spectre harmonique du son afin d’avoir
des timbres différents, par synthèse soustractive.
Il y a eu aussi l'électricité au service des instruments
acoustiques. (Nous opposerons "acoustique" = sons réels et "électronique"
= sons générés par un circuit électrique). Parmi ceux-ci, les plus célèbres
sont les "Ondes MARTENOT".
Les autres n'ont pas eu grande fortune, pas plus d'ailleurs que les "orgues
électroniques"*, exception faite de l'orgue "HAMMOND". Peut-être parceque
ce dernier n'a pas tant cherché à imiter l'orgue à tuyaux qu'à créer quelque
chose de nouveaux (grâce à ses "diffuseurs LESLIE" et à ses tirettes "harmoniques").
* (Appelés vulgairement "Electronium")
D'un autre coté, l'enregistrement et la numérisation
des sons dans les "orgues numériques"* permet des imitations plus
fidèles que les synthèses électroniques. Cependant, les réalisations sont
comparables à un simulateur de vol : "On a les sensations mais
on ne décolle pas" !
* (Appelés vulgairement "Numerium", voire
"Numerdium" quand leur sonorité est trop pourrie!)
Toutefois, l'association des sons acoustiques et de sons numériques
donne des résultats convaincants, surtout si ces derniers ne cherchent
pas systématiquement à reproduire des sons acoustiques existants.
Ce qui l'est moins est que le ton des tuyaux varie avec la température
ambiante, pas celui des sons numériques.
Le modernisme actuel s'orienterait plutôt vers un certain gigantisme
et une gestion du fonctionnement de l'instrument par des systèmes
numériques. Dans quel état seront ces derniers dans quelques
années, quand l'électronique "ne suivra plus"
et que l'organiste sera bien embêté parce qu'il ne pourra
rien faire pour sortir un son de son biniou ? Lui réparera-t-on
un orgue passé de mode pour lequel "on" demandera une
somme faramineuse ?
Pour ma part, l'avenir devrait rester à la simplicité, celle
qu'on peut toujours dépanner soi-même, quitte, à l'instar
de l'orgue de l'église Saint-Eustache, à avoir une console
mécanique doublée d'une console numérique qui offre
des possibilités insoupçonnées. Si cette dernière
tombe en panne, la console mécanique autorisera toujours son service.
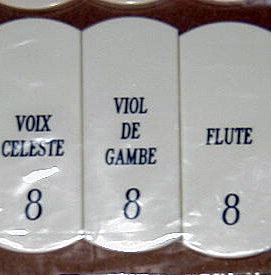
(Retour
haut de page)
Retour
Accueil
MàJ décembre 2007
|

